La Cour d’appel du Québec s’est prononcée récemment sur les critères de qualification du contrat de travail, permettant de distinguer celui-ci du contrat de service, dans l’affaire Bermex international inc. c. L’Agence du revenu du Québec[1].
Il s’agit d’une décision d’intérêt puisque la Cour confirme l’utilité d’avoir recours, pour déterminer si elle est en présence ou non d’un contrat de travail, aux critères traditionnels émanant de la commonlaw quant au degré d’intégration du travailleur à l’entreprise.
Il s’agit de l’appel d’une décision de la Cour du Québec qui a rejeté la contestation de quatre entreprises à l’égard d’avis de cotisation émis par l’Agence de revenu du Québec (« l’Agence »). Le statut du principal administrateur et dirigeant des entreprises appelantes était au cœur du litige pour déterminer s’il existait un lien de subordination réel faisant de ce dirigeant un salarié plutôt qu’un travailleur autonome.
Les faits :
Les appelantes sont composées de trois entreprises œuvrant dans le domaine du meuble et de l’entreprise qui les dirige (le « Groupe »).Le principal administrateur et dirigeant des entreprises appelantes se décrit comme consultant en gestion-conseil pour le compte de celles-ci.
À la suite d’une vérification fiscale des quatre entreprises, l’Agence a conclu que l’administrateur n’avait pas le statut de travailleur autonome, mais qu’il était plutôt un salarié au sein des entreprises. Par conséquent, elle était d’avis que les honoraires de gestion qui lui étaient versés devaient être considérés comme des revenus d’emploi et, donc, qu’ils faisaient partie de la masse salariale des entreprises.
Pour les années 2003, 2004 et 2005, les honoraires de gestion lui ayant été versés étaient respectivement de l’ordre de 800 000 $, de 900 000 $ et de 900 000 $. Pour sa part, l’administrateur du Groupe a déclaré ces sommes à titre de revenus d’entreprise sur ses déclarations personnelles de revenus.
Les instances antérieures
Les entreprises ont contesté les avis de cotisation émis par l’Agence, mais ils ont été maintenus.
La Cour du Québec a également rejeté l’appel des contestations des avis de cotisation déposé par les entreprises. Elle a conclu que les cotisations bénéficiaient d’une présomption de validité[2] et que les appelantes avaient le fardeau de « démolir »[3] cette présomption, ce qu’elles n’ont pas réussi à faire.
Une énumération non exhaustive des faits saillants du jugement de la Cour du Québec est dressée ci-dessous :
- Il n’y a aucune entente écrite entre l’administrateur du Groupe et les entreprises pour son travail de consultant;
- Les services qu’il leur fournit représentent environ 85 % de son temps travaillé;
- Il agit comme consultant pour des besoins pratiques, quotidiens et à court terme;
- Il assiste aux congrès annuels de l’industrie à titre de président-directeur général;
- Il peut consentir des réductions aux clients;
- Il travaille principalement dans le bureau d’une de ces entreprises;
- Les entreprises lui fournissent une réceptionniste, les services de secrétariat, de photocopie et d’équipement, y compris les articles de bureau, les formulaires, les catalogues, les brochures et le papier en-tête;
- Son kilométrage et ses repas sont remboursés;
- Les entreprises assument les conséquences liées à ses erreurs de gestion;
- Ses services paraissent uniformes sans aucune nuance relative à la nature des activités de chacune des entreprises;
- Les sommes des honoraires sont uniformes d’un mois à l’autre et sont parfois facturées à l’avance, sans aucune révision postérieure en fonction du temps réellement travaillé[4];
- Il n’a produit aucun état financier en lien avec ces services.
Ainsi, le juge a conclu que plusieurs éléments mis en preuve et déjà retenus par la jurisprudence penchent lourdement à l’encontre de la qualification d’un contrat de service, notamment à la lumière du haut degré d’intégration de l’administrateur du Groupe dans les activités des entreprises.
Les prétentions des appelantes
Les appelantes ont soulevé plusieurs moyens d’appel.
Un des moyens d’appel était fondé sur la présomption de validité des avis de cotisation et le fardeau de preuve que doit rencontrer celui qui conteste de tels avis. Les appelantes soutenaient qu’elles s’étaient acquittées de leur fardeau et qu’elles avaient repoussé la présomption de validité des avis de cotisation en litige.
Les appelantes ont également plaidé que l’intention des parties aurait dû être prise en compte afin de déterminer la nature du contrat les liant. Elles ont allégué que l’administrateur du Groupe occupait un triple statut, soit celui d’employé, de PDG et de travailleur autonome, mais qu’en réalité il n’était qu’un travailleur autonome travaillant pour les entreprises liées.
Finalement, les appelantes ont prétendu que le juge avait erré en omettant de trancher la question de l’absence de lien de subordination entre les appelantes et l’administrateur du Groupe. Selon elles, en l’absence de ce lien, « l’analyse ne doit pas être poussée plus loin »[5]. Plus précisément, elles étaient d’avis que, dans la mesure où les entreprises sont contrôlées à 100 % par l’administrateur du Groupe, il est difficile de conclure à l’existence d’un lien de subordination entre les appelantes et son prétendu employé.
Enfin, les appelantes ont reproché au juge d’avoir importé en droit québécois le critère de l’intégration utilisé en commonlaw afin de déterminer s’il existait un lien d’emploi entre les parties.
La décision de la cour d'appel
- La présomption de validité des avis de cotisation :
La Cour d’appel confirme la position du juge de première instance. Elle conclut que ce dernier a appliqué le bon test en affirmant que les appelantes devaient « démolir » la présomption de validité avec une preuve prima facie démontrant en quoi les faits sur lesquels s’appuie la cotisation sont incorrects.
- L’intention des parties :
La Cour d’appel conclut, à l’instar du juge de première instance, que l’intention des parties de convenir d’un contrat de service ne se dégage pas clairement de la preuve au dossier.
- Le critère de l’intégration :
Les appelantes plaident que le critère fondamental qui distingue le contrat de travail du contrat de service est le lien de subordination et que la preuve ne démontrait pas l’existence d’un tel lien, bien au contraire.
Le juge de première instance avait conclu qu’un degré élevé d’intégration du travailleur aux activités du donneur d’ouvrage pouvait indiquer la présence d’un lien de subordination à l’entreprise. Selon cette analyse, un degré élevé d’intégration constitue un indice du lien de subordination[6] :
« Par références interposées, le juge considère pertinent le fait qu’une personne effectue un travail qui fait partie intégrante de la raison d’être de la société. Le lien de subordination pourrait ainsi se traduire par un degré élevé d’intégration du travailleur aux activités du donneur d’ouvrage; il s’agirait d’un indice du lien de subordination. »
Après avoir fait état de la position de deux auteurs québécois en matière de droit du travail et d’une décision de la Cour d’appel fédérale, la Cour d’appel donne son aval à l’utilisation, dans la recherche d’un lien de subordination juridique, du critère de l’intégration du travailleur à l’entreprise. La Cour d’appel confirme ainsi qu’il n’y a pas d’antinomie à ce sujet entre le droit civil et la commonlaw[7].
Le fait que l’administrateur du Groupe soit actionnaire des entreprises appelantes lui a permis une certaine liberté qui donne l’impression qu’il agit à titre de travailleur autonome. Il n’est pas surprenant qu’à titre de dirigeant, il gère son propre horaire, son travail et sa rémunération, tout comme le fait qu’il ne soit pas directement sous la supervision des appelantes. Cette liberté lui vient de son statut de dirigeant et non du contrat de service qu’il réclame. Par conséquent, rien n’empêche de conclure que dans l’exécution de ses tâches, il a le statut d’employé et non de travailleur autonome.
La Cour d’appel met notamment l’accent sur le fait que ce sont les sociétés appelantes qui ont assumé tout risque de perte et qui ont tiré profit des activités : « Or, une entreprise n’assume pas les erreurs d’un consultant externe »[8]. Il n’a apporté aucune « expertise nécessitant l’intervention d’une personne externe dans un domaine qu’il possède mieux que tout autre, il règle simplement les problèmes quotidiens de ses entreprises, comme il le reconnaît »[9].
La Cour ajoute qu’accepter la thèse des appelantes aurait pour conséquences absurdes qu’aucun lien de subordination ne peut exister entre une personne qui dirige une entreprise et l’entreprise elle-même et que toute entente liant un dirigeant à l’entreprise qu’il gère ne pourrait pas être de la nature d’un contrat d’emploi.
L’appel est donc rejeté.
Conclusion
La Cour d’appel reconnaît qu’il y a lieu de retenir une conception large du lien de subordination et, plus précisément, elle nous enseigne qu’il peut être utile d’analyser et de considérer le lien d’intégration d’une personne dans les activités d’une entreprise.
Le critère du « lien d’intégration » est surtout utile lorsqu’on est en présence de cadres supérieurs, de professionnels ou de travailleurs hautement spécialisés, puisque le critère classique de la subordination est souvent absent en pareille situation.
Rappelons qu’une mauvaise qualification du contrat de travail peut avoir des impacts financiers et juridiques importants tant pour l’entreprise que pour la personne concernée sur le plan fiscal et en matière de droit du travail. Il est donc essentiel de procéder à une bonne analyse du statut réel de la personne en cause.
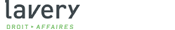
Source : VigieRT, octobre 2013.
| 1 | 2013 QCCA 1379. |
| 2 | En vertu de l’article 1014 de la Loi sur les impôts, L. R.Q., c. I-3. |
| 3 | Terme utilisé par le juge de première instance et repris par la Cour d’appel. |
| 4 | « C’est une uniformité étonnante en l’absence d’un contrat à forfait », a précisé le juge de première instance au par. 33 du jugement de la Cour d’appel. |
| 5 | Par. 44 du jugement de la Cour d’appel. |
| 6 | Par. 50 du jugement de la Cour d’appel. |
| 7 | Par. 53 à 56 du jugement de la Cour d’appel. |
| 8 | Par. 59 du jugement de la Cour d’appel. |
| 9 | Par. 60 du jugement de la Cour d’appel. |


