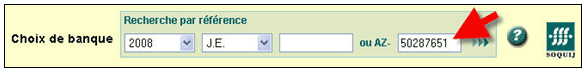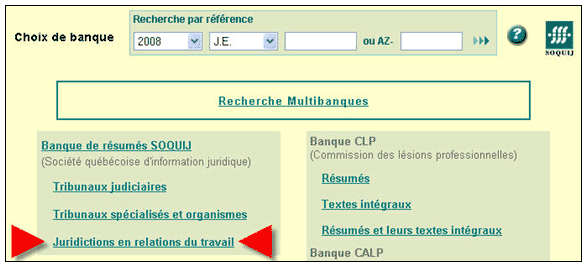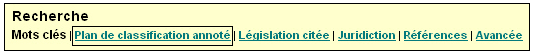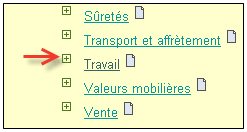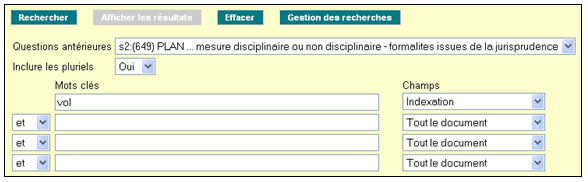Le mois dernier, nous avons expliqué l’importance de faire une distinction entre les mesures disciplinaires et non disciplinaires, puisque les règles applicables et la latitude de l’employeur et, en conséquence, la compétence de l’arbitre seront différentes. Nous avons ensuite illustré ces règles en fonction des manquements du salarié les plus fréquents, où l’arbitre a confirmé la mesure imposée.
Ce mois-ci, en fonction des mêmes manquements du salarié, nous vous donnons un aperçu de décisions où l’arbitre a annulé ou modifié la mesure imposée par l’employeur.
Il est à noter que l’application d’une clause de perte d’ancienneté et d’emploi sans avis ou motif valable, dans les cas où elle est invoquée par l’employeur, n’est pas automatique. Dans certains cas, une telle clause équivaut à l’imposition d’une mesure disciplinaire; elle doit donc recevoir une interprétation restrictive.
En matière de compétence de l’employé pour accomplir son travail, l’employeur partage une part de la responsabilité. Il doit en effet fournir une formation, une supervision et un suivi adéquats et faire connaître clairement ses attentes.
En ce qui a trait aux règlements d’entreprise ou politiques de l’employeur, les éléments suivants ont une conséquence sur la décision que rendra l’arbitre : le règlement doit avoir été porté à la connaissance des employés avant sa mise en vigueur, il doit avoir fait l’objet d’une discussion avec le syndicat, les employés doivent avoir été avertis des conséquences en cas de non-respect, il doit avoir été appliqué de manière uniforme dès son entrée en vigueur.
Pour ce qui est des manquements reliés à l’alcool ou à la drogue, l’obligation d’accommodement, la portée de l’entente de dernière chance et la situation qui prévaut au moment où la mesure est imposée sont des éléments pouvant faire en sorte que celle-ci sera annulée ou modifiée.
Il est à noter que la pharmacodépendance constitue une maladie au même titre que l’alcoolisme; l’employeur a donc une obligation d’accommodement à cet égard.
De façon générale, lorsque l’absence est justifiée par un « handicap », au sens élargi du terme, tel que reconnu par la jurisprudence, la prudence s’impose.
Enfin, avant d’entreprendre une filature, l’employeur doit avoir un motif sérieux de douter de l’honnêteté de l’employé. Sinon, cette preuve sera irrecevable.
MENU
|
L'employeur court le risque d'être induit en erreur lorsqu'il utilise le critère d'invalidité totale prévu au contrat d'assurance pour appliquer la clause de perte d'ancienneté et d'emploi, puisque son rôle est de gérer la relation d'emploi en fonction de la norme de l'explication satisfaisante; en l'espèce, même si le plaignant, absent en raison d'un trouble de l'adaptation, ne souffrait pas d'une maladie incapacitante au sens de la police d'assurance, son médecin estimait que le retour au travail était contre-indiqué pour sa santé et le succès de la thérapie.
Le plaignant travaillait à titre d'assembleur. À compter du 25 avril 2005, il s'est absenté du travail en raison de troubles d'anxiété. Le 20 mai suivant, le médecin désigné par l'assureur a conclu qu'il était apte au travail. L'assureur a reconnu son admissibilité à des prestations d'assurance-salaire pour la période allant jusqu'au 10 mai 2005. Le 4 juillet, l'employeur a ordonné au plaignant de se présenter au travail, compte tenu des conclusions de l'assureur relatives à l'absence d'invalidité. Deux semaines plus tard, l'employeur l'a avisé de sa fin d'emploi en application d'une clause de la convention collective prévoyant la perte d'ancienneté après deux semaines consécutives d'absence sans explications satisfaisantes. Le plaignant soutient avoir fourni une explication satisfaisante afin de justifier son absence. Il affirme qu'il faisait l'objet d'un suivi médical de la part de son médecin traitant et qu'il a remis à l'employeur des certificats médicaux établissant qu'il souffrait d'un trouble de l'adaptation et que le retour au travail était contre-indiqué pour la santé et le succès de la thérapie. Il était également engagé avec son médecin dans une demande de révision de la décision de l'assureur.
Décision
Au moment de mettre fin à l'emploi du plaignant, l'employeur s'est fondé sur la décision de l'assureur selon laquelle le plaignant n'est plus affecté d'une invalidité totale au sens du contrat d'assurance après le 10 mai 2005. L'employeur a ainsi refusé de considérer les certificats médicaux du médecin traitant recommandant un arrêt de travail en raison d'un trouble d'adaptation. Il s'en est essentiellement remis à la décision de l'assureur sans même consulter le rapport médical du médecin de ce dernier. Or, la décision d'un assureur refusant de reconnaître une invalidité au sens d'un contrat d'assurance ne signifie pas nécessairement que le salarié visé ne dispose pas d'une explication satisfaisante pouvant justifier son absence. L'assureur évalue la condition du salarié selon le critère d'invalidité totale prévue au contrat d'assurance. Il assume un rôle distinct de celui de l'employeur, qui doit gérer la relation d'emploi en fonction de la norme conventionnelle de l'explication satisfaisante. L'assureur peut conclure qu'un assuré n'a pas droit à des prestations parce qu'il n'est pas totalement invalide au sens de la police d'assurance. Dans un tel cas, l'employeur n'est aucunement lié par l'évaluation de l'assureur et il conserve entièrement sa discrétion pour apprécier et, éventuellement, reconnaître l'existence d'une justification valable pour s'absenter du travail. En l'espèce, l'employeur ne pouvait ignorer les certificats médicaux du médecin traitant reconnaissant une condition médicale réelle chez le plaignant et recommandant un arrêt de travail. Bien qu'il n'y ait pas toujours lieu de privilégier la version du médecin traitant, les conditions de ce dernier reposent en l'espèce sur l'historique de son patient et sur ses observations faites lors de nombreux examens. Aucun élément ne permet de douter de la fiabilité de ses recommandations relatives à l'arrêt de travail. Par ailleurs, le plaignant a été constant dans ses déclarations. Son témoignage ne comportait ni exagération, ni réticence, ni apitoiement sur son sort. Or, en l'absence d'une preuve de complaisance ou d'erreur basée sur de fausses informations données par le salarié, l'employeur ne peut choisir de ne pas tenir compte des certificats médicaux du médecin traitant recommandant un arrêt de travail. En l'espèce, il faut conclure que le plaignant avait une explication satisfaisante justifiant son absence. La fin d'emploi et annulée.
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 501 et Mabe Canada inc. (S.D.), SOQUIJ AZ-50493850
L'omission de l'employeur de respecter la procédure prévue à la suite du refus du plaignant de travailler pour des raisons de sécurité constitue un motif valable d'absence et il ne pouvait appliquer la clause de la convention collective prévoyant une perte d'ancienneté et d'emploi après trois jours d'absence consécutifs; le congédiement est annulé.
Le plaignant conteste une série de mesures liées à son refus de porter des lunettes de sécurité. Au mois de décembre 2006, le comité de la santé et de la sécurité du travail, formé de membres du syndicat et de l'employeur, a adopté un règlement rendant obligatoire le port de lunettes de sécurité. Auparavant, le plaignant portait ses lunettes personnelles et l'employeur tolérait une telle situation. Le 26 février 2007, le plaignant a demandé à l'employeur de lui remettre un formulaire afin d'obtenir, aux frais de l'entreprise, des lunettes de sécurité ajustées à sa vue. L'employeur a refusé au motif que le plaignant quittait son poste le mois suivant pour un congé sans solde de six mois. Le même jour, le plaignant s'est rendu chez un optométriste afin de subir un examen de la vue visant l'obtention de lunettes de sécurité avec prescription. Il réclame le paiement d’une heure et demie de salaire pour ce rendez-vous. Par la suite, le plaignant n'ayant pas encore obtenu de lunettes de sécurité avec prescription, l'employeur a exigé qu'il porte des verres de protection par-dessus ses lunettes personnelles prescrites. Le plaignant s'est absenté les 1er, 2 et 5 mars au motif qu'il ne voulait pas travailler avec les verres de protection exigés par l'employeur. Il a été suspendu pour une journée. Le 14 mars, l'employeur l'a avisé de son congédiement en application de la clause de perte d'ancienneté et d'emploi à la suite d'une absence injustifiée de trois jours consécutifs sans autorisation. Le plaignant prétend qu'il a exercé le droit de refus prévu à la convention collective, les lunettes que l'employeur exigeait qu'il porte lui causant de l'inconfort et nuisant à sa sécurité.
Décision
Il était coutumier dans l'entreprise de payer les lunettes de prescription satisfaisant aux normes de sécurité pour le poste en cause, lorsqu'elles étaient fournies par un optométriste. L'employeur a donc adopté une position abusive en refusant de fournir au plaignant le formulaire lui permettant d'obtenir de telles lunettes. Le fait que le plaignant quittait le travail en congé sans solde ne constituait pas un motif valable. Le grief contestant le refus de remettre le formulaire est donc accueilli. Quant à celui réclamant le salaire perdu à l'occasion de la visite chez l'optométriste, celui-ci est rejeté. En effet, l'obligation de l'employeur se limite à payer le coût des lunettes de sécurité et le plaignant a choisi de rencontrer son optométriste pendant ses heures de travail. Relativement à la suspension d’un jour, le plaignant a fait preuve d'insubordination en s'absentant sans motif les 1er, 2 et 5 mars 2007. Malgré le fait qu'il ne voulait pas travailler avec les lunettes que l'employeur l'obligeait à porter, il n'a pas officiellement exercé un droit de refus. En s'absentant, il a contrevenu à la règle « obéir d'abord, se plaindre ensuite ». Cependant, l'employeur ayant convenu d'appliquer une période de sensibilisation jusqu'au 1er mars 2007 relativement au port obligatoire des lunettes de sécurité, il a implicitement renoncé à discipliner les salariés à ce sujet. Le plaignant s'est toutefois absenté sans motif les 2 et 5 mars, et l'employeur était fondé à lui imposer une suspension d’un jour. Quant au congédiement, l'employeur ne pouvait appliquer de façon automatique la disposition concernant la perte d'ancienneté et d'emploi à la suite d'une absence injustifiée de trois jours consécutifs. L'application de cette clause équivaut à l'imposition d'une mesure disciplinaire; elle doit donc recevoir une interprétation restrictive. En l'espèce, le plaignant s'étant absenté pour exercer un droit de refus prévu à la convention collective, l'employeur devait démontrer, à la suite d'un examen sérieux du danger couru, que l'exercice du droit de refus par le plaignant n'était pas fondé. Or, il n'a procédé à aucun examen de la situation et n'a donc pas démontré que c'était le cas. La preuve révèle plutôt que le refus du plaignant reposait sur de réels motifs de sécurité. Comme la convention collective prévoit que le salarié qui exerce valablement un droit de refus est réputé être au travail, l'employeur ne pouvait conclure à une absence injustifiée et appliquer la clause de perte d'ancienneté et d'emploi.
TUAC, section locale 501 et Filochrome inc. (Roger Marcoux), SOQUIJ AZ-50490293
Le motif invoqué pour ne s'être pas présentée au travail dans les trois jours suivant un rappel — la plaignante ne savait pas que sa boîte vocale ne fonctionnait pas — doit être retenu; pour conclure que cela n'était pas probable, il aurait fallu une preuve technique.
La plaignante conteste le congédiement qui lui a été imposé pour ne pas s'être présentée au travail dans les trois jours ouvrables suivant son rappel à la suite d'une mise à pied. L'employeur soutient qu'il lui a fait parvenir un avis de rappel par la poste le 16 janvier 2007. Le 22 janvier suivant, il lui a envoyé un avis de congédiement invoquant l'application d'une clause de la convention collective prévoyant la perte d'emploi et d'ancienneté en cas d'omission de se présenter au travail dans les trois jours ouvrables suivant un rappel sans motif valable. La plaignante soutient que ce n'est que le 24 janvier 2007 qu'elle a pris connaissance de l'avis de rappel au travail qui lui a été envoyé par la poste. Elle explique que sa case postale est éloignée de son domicile et qu'elle ne s'y rend pas chaque jour. De plus, elle invoque la pratique passée selon laquelle l'employeur communiquait avec elle par téléphone afin de la rappeler au travail. Elle affirme qu'elle n'a reçu aucun appel de l'employeur. Il est possible que ce dernier lui ait téléphoné, mais elle prétend qu'elle éprouvait des problèmes de messagerie vocale.
Décision
La clause prévoyant la fin d'emploi automatique après trois jours d'absence sans motif valable doit être interprétée de façon restrictive à l'égard de l'employeur et libérale à l'égard du salarié. Cette clause ne peut trouver application si le salarié démontre l'existence d'un motif valable. En l'espèce, la plaignante a démontré l'existence d'un motif valable motivant son absence du travail lors de son rappel, au mois de janvier 2007. En effet, les explications fournies sont crédibles, et l'employeur n'a apporté aucun élément de preuve technique permettant d'en douter. Ainsi, la plaignante n'a pas eu connaissance de l'appel téléphonique de sa part parce que son service de messagerie ne fonctionnait pas. Par la suite, elle ne s'est pas rendue à sa case postale avant le 24 janvier 2007 puisqu'elle ne se doutait pas qu'elle allait être rappelée au travail et qu'elle n'avait pas l'habitude de vérifier son courrier chaque jour. L'employeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver que la plaignante était informée de l'avis de rappel au travail et qu'elle avait omis de se présenter au travail dans les trois jours ouvrables. Pour ces motifs, le congédiement est annulé.
Syndicat national (TCA-Québec) et Disque Améric inc. (Établissement de Drummondville), (Diane Salvail), SOQUIJ AZ-50445788
L'employeur connaissait la condition du salarié, dont le congé de maladie pour cause de dépression avait été plusieurs fois renouvelé; l'application de la clause de perte d'ancienneté après que le salarié eut oublié de transmettre un nouvel avis de prolongation constitue une décision abusive et le congédiement est annulé.
Le plaignant, cariste à l'usine de l'employeur, s'est absenté à compter du 14 juin 2006 en raison de troubles de l'adaptation et de dépression. Compte tenu de son refus de suivre une cure de désintoxication, la compagnie d'assurances a cessé de l'indemniser à compter de la fin du mois d'août suivant. Selon le dernier certificat médical remis à l'employeur, le plaignant devait être de retour au travail le 22 septembre 2006. Le 3 octobre suivant, comme il était toujours absent et que l'employeur n'avait pas reçu d'avis de prolongation de son arrêt de travail, il a été congédié en raison de son absence non signalée à partir du 25 septembre. La convention collective prévoit qu'un salarié perd son ancienneté s'il « s'absente plus de deux jours ouvrables consécutifs sans permission ou avertissement ». Le plaignant allègue qu'il avait un certificat de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2006 mais, à cette époque, il se sentait absent mentalement et il croyait l'avoir remis à l'employeur.
Décision
La motivation de l'absence du plaignant ne peut être contestée. En arrêt de travail prolongé depuis juin 2006, il a vu à plusieurs reprises les médecins reporter son retour au travail. De plus, l'assureur a cessé de l'indemniser à la suite de son refus de suivre une cure. L'employeur était au courant de tous ces événements et il a reçu un dernier avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 22 septembre avant de prendre sa décision de congédier le plaignant en application de la disposition de la convention collective. Une certaine jurisprudence reconnaît le caractère automatique de l'interprétation stricte qu'il faut donner à une telle clause. Par ailleurs, en l'espèce, la convention utilise le terme « avertissement », lequel signifie l'action d'informer, d'instruire, de prévenir, de renseigner ou de signaler. Or, l'employeur était informé de la maladie du plaignant puisqu'il avait reçu plusieurs certificats médicaux. Par contre, il n'était pas au courant de la prolongation de son absence jusqu'au 8 octobre 2006. Le plaignant aurait dû lui faire parvenir cet avis de prolongation et il n'y a aucune preuve médicale au soutien de son incapacité à le produire. Cependant, connaissant la situation, l'employeur aurait pu tenter de le joindre, bien que la convention collective ne l'y oblige pas. Dans le cas particulier du plaignant, il pouvait prévoir la possibilité de nouveaux prolongements d'arrêt de travail. La disposition de la convention sur laquelle s'appuie l'employeur pour justifier le congédiement sert à corriger des situations soudaines et exagérées. C'est le sens et la portée qu'il convient de lui donner. En l'espèce, la décision de l'employeur est très sévère et même abusive. La réintégration est ordonnée, avec remboursement du salaire perdu depuis le 7 décembre 2006, date de l'attestation de la capacité du plaignant à retourner au travail.
Contre-plaqué St-Casimir et Fraternité des forestiers et travailleurs d'usine, section locale 299 (Serge Laflamme), SOQUIJ AZ-50443312
Le congédiement d'un salarié à la suite d'une absence sans permission de plus de trois jours consécutifs est annulé; l'employeur ne l'ayant pas interrogé sur la raison de son absence, il ne pouvait juger si elle était « valable » ou non.
Au cours de l'été 2004, le plaignant, un salarié au service d'une entreprise de fabrication de meubles, a connu divers problèmes financiers qui l'ont forcé à s'absenter à plusieurs reprises. Vers la mi-août, l'employeur lui a donné une journée de congé pour lui permettre de régler ses problèmes. Il ne s'est toutefois pas présenté au travail les 30 et 31 août ni les 1er et 2 septembre suivants, et il n'a pas avisé l'employeur de ses absences. Le 3 septembre, il est retourné au travail. L'employeur a appliqué la clause de la convention collective prévoyant qu'un salarié perd son ancienneté s'il s'est absenté de son travail pendant plus de trois jours ouvrables consécutifs « sans permission ou raison valable ».
Décision
La situation dans Montréal (Ville de) (arrondissement Côte-St-Luc—Hampstead—Montréal-Ouest) c. Syndicat canadien des cols bleus regroupés de Montréal (C.A., 2006-03-21), 2006 QCCA 412, SOQUIJ AZ-50363025, J.E. 2006-746, D.T.E. 2006T-351 est différente du cas en l'espèce puisqu'un salarié qui n'avertit pas de son absence ne peut avoir obtenu la permission de s'absenter. S'il avertit et obtient la permission de s'absenter, il a forcément une raison valable. En l'espèce, il faut interpréter la clause applicable comme permettant au salarié d'échapper à la sanction de la perte de l'ancienneté s'il remplit l'une ou l'autre des deux caractéristiques prévues : avoir la permission ou avoir une raison valable. Par ailleurs, le règlement de l'entreprise prévoit l'obligation du salarié d'aviser le contremaître en cas d'absence. Manifestement, le plaignant a manqué à ce règlement, qu'il connaissait. L'employeur aurait pu décider de lui imposer une mesure disciplinaire pour sanctionner cette faute, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Par ailleurs, contrairement au règlement de l'entreprise, la clause prévoyant la perte d'ancienneté n'indique pas de qui le salarié doit obtenir la permission de s'absenter. Cependant, il faut obligatoirement qu'il s'agisse d'une personne en situation d'autorité chez l'employeur. Le plaignant prétend avoir obtenu cette permission du directeur d'usine, qu'il avait rencontré fortuitement le troisième jour de son absence. Toutefois, pour pouvoir prétendre qu'il avait obtenu une permission de s'absenter, il aurait fallu qu'il avise l'employeur d'une façon claire de son absence et des motifs de celle-ci. Quoiqu'il en soit, le plaignant a démontré avoir eu une raison valable de s'absenter. De plus, même si l'employeur connaissait ses problèmes financiers, il ne l'a pas questionné, lors de son retour au travail, sur la raison de son absence. Il ne pouvait donc pas juger du fait que la raison de l'absence était valable ou pas. Il a présumé qu'elle ne l'était pas. La réintégration est par conséquent ordonnée; l'arbitre conserve sa compétence pour déterminer si le plaignant a droit à une indemnité compensatrice et, le cas échéant, pour en fixer le montant.
Vitriers, travailleurs du verre, section locale 1135 et Meubles Laurier ltée (Martin Evers), SOQUIJ AZ-50416004
La suspension imposée au plaignant pour avoir omis de respecter une entente de dernière chance est annulée en raison de l'application d'une clause d'amnistie prévoyant que toute mesure disciplinaire est retirée du dossier après 12 mois à compter de la date de son imposition.
Le 9 février 2007, le plaignant s'est présenté au travail sous l'influence de l'alcool et il a été renvoyé chez lui. L'employeur a décidé d'appliquer la première sanction prévue dans l'entente de dernière chance signée le 8 février 2006, soit une suspension de 10 jours. Comme le plaignant s'est absenté pour cause de maladie jusqu'au 3 mai 2007, c'est à cette date que l'avis de suspension lui a été remis. Cet avis lui reproche de ne pas avoir respecté son engagement de ne plus se présenter au travail « sous l'effet de la boisson ». Le syndicat invoque l'article 9.06 de la convention collective, qui stipule que : « Toute mesure disciplinaire est retirée du dossier du salarié après une période de douze (12) mois, à compter de la date de son imposition et ne peut être invoquée contre lui par la suite ». Il soutient que, vu l'absence de mention expresse quant à la durée de vie de l'entente de dernière chance, le délai de 12 mois s'applique. L'employeur reconnaît que l'entente constitue une mesure disciplinaire adoptée en remplacement du congédiement qu'il souhaitait imposer en février 2006. Il prétend cependant qu'elle se substitue, dans le cas du plaignant, aux dispositions générales prévues à l'article 9 de la convention et s'applique pendant toute la durée de l'emploi de ce dernier.
Décision
Le 8 février 2006, le plaignant a accepté de son plein gré une entente de dernière chance constituant une mesure disciplinaire à la place d'un congédiement. Il s'agit sans contredit d'une mesure disciplinaire soumise aux dispositions de la convention collective figurant à l'article 9, dont l'article 9.06. Cette entente constitue toutefois une dérogation aux dispositions de l'article 9 énonçant la règle générale en matière de mesures disciplinaires. Elle doit donc être interprétée restrictivement. Ainsi, toutes les dispositions de l'article 9 s'appliquent à la mesure imposée le 8 février 2006, à moins que les parties ne les aient expressément exclues. Comme celles-ci n'ont pas indiqué la durée de vie de cette mesure disciplinaire, la clause d'amnistie s'applique. Or, la suspension contestée a été imposée pour un événement survenu le 9 février 2007, soit plus de 12 mois après l'imposition, le 8 février 2006, de la mesure disciplinaire que constitue l'entente de dernière chance. C'est donc à bon droit que le syndicat soutient que cette mesure disciplinaire avait alors cessé de produire des effets juridiques. Par conséquent, l'employeur ne pouvait l'invoquer au soutien de la suspension imposée pour les événements du 9 février 2007. Par conséquent, le Tribunal n'a pas à décider du caractère raisonnable de la suspension.
Syndicat des salariées et salariés de Power Battery (CSD) et Power Battery Iberville Ltd. (Mario Laliberté), SOQUIJ AZ-50512667
L'employeur, après avoir toléré pendant plusieurs années l'alcoolisme et la toxicomanie du plaignant malgré la violation par celui-ci d'une entente de dernière chance, l'a congédié au motif qu'il était « irrécupérable »; ce pronostic ne s'étant pas vérifié – le plaignant ayant cessé de consommer –, une mise à pied est substituée au congédiement.
Le plaignant occupe, depuis seize ans, des fonctions d'assembleur dans un environnement potentiellement dangereux où, à l'aide de ponts roulants, des poutres d'acier pesant jusqu'à 10 000 livres sont déplacées. En décembre 1998, comme il était fréquemment à son poste de travail sous l'effet de l'alcool, de médicaments ou des drogues dures, une entente a été signée entre les parties prévoyant son congédiement s'il ne respectait pas sa promesse de ne plus consommer. En septembre 2000, l'employeur a préparé un second projet de transaction puisque le plaignant n'avait toujours pas cessé. Toutefois, le syndicat a refusé de le signer, alléguant qu'il s'agissait d'un congédiement différé en raison des problèmes de consommation du plaignant. En 2007, l'employeur a procédé au congédiement au motif que le plaignant était « irrécupérable ». Il affirme avoir rencontré ce dernier à plusieurs reprises, avoir pris les mesures nécessaires pour l'aider, avoir toléré son absentéisme, avoir tenté de faire pression afin qu'il réagisse, avoir supporté le coût de plusieurs analyses, l'avoir accompagné à des cliniques et lui avoir donné l'occasion de suivre une thérapie autonome ainsi qu'une cure fermée.
Décision
L'employeur s'est opposé à ce que le syndicat interroge le plaignant sur des faits survenus après son congédiement, notamment sur la cure de désintoxication qu'il avait suivie. Or, le motif principal de congédiement invoqué par l'employeur est que le plaignant était « irrécupérable ». Dans ces circonstances, il ne peut empêcher le syndicat de prouver que celui-ci s'est amendé.
Quant au fond du litige, malgré une situation qualifiée d'extrêmement dangereuse depuis l'entente signée en décembre 1998, et bien que le plaignant ait continué à consommer, l'employeur s'est limité à faire des menaces de congédiement. Ce n'est qu'en juillet 2006 qu'il a procédé à cette mesure, qui a dû être annulée lorsque le médecin traitant du plaignant a reconnu un problème de santé justifiant une absence prolongée. Selon la preuve faite par les experts, il serait illusoire pour un employeur de continuer à reprendre au travail un salarié toxicomane dont la consommation n'est pas maîtrisée tant que celui-ci n'aura pas pris conscience de la gravité de sa condition ainsi que des limites imposées par celle-ci et qu'il n'aura pas pris des mesures de correction qui soient proportionnellement sérieuses. Ainsi, la procédure disciplinaire traditionnelle n'est plus la mesure appropriée lorsque le salarié ne maîtrise plus sa conduite. En faisant preuve de tolérance, l'employeur a fait perdurer chez le plaignant un sentiment de confort incompatible avec la motivation requise pour tenir sa toxicomanie en échec. En appliquant l'entente de décembre 1998, il aurait évité les risques importants pour la santé et la sécurité de ses travailleurs, en plus des risques sur la production de son usine. Quant à l'argument selon lequel le plaignant était « irrécupérable », il ne peut être retenu, car il a été démontré que, à la suite d'une cure fermée et de changements dans son environnement, son pronostic semble très prometteur. En effet, il n'a pas consommé depuis de nombreux mois et a considérablement modifié son comportement. Étant donné qu'il s'agit d'un problème de santé chronique d'un type particulier, il y a lieu de substituer une mise à pied au congédiement, c'est-à-dire d'imposer une absence sans solde du plaignant, celui-ci ne répondant plus aux exigences de disponibilité, de fiabilité et de compétence. Une perte d'ancienneté pourra de plus survenir après 48 mois d'absence, conformément à la convention collective. La réintégration sera conditionnelle à l'obtention d'une expertise médicale confirmant que le plaignant répond aux exigences de sa tâche et il devra se soumettre à des tests aléatoires de dépistage d'alcool et de drogue sous peine de congédiement.
Syndicat des travailleurs de Beauce-Atlas (CSN) et Fabrication Beauce-Atlas inc. (Martin Vachon), SOQUIJ AZ-55000330
On ne peut à l'avance donner à une entente conditionnelle de réintégration un caractère de « dernière chance » et limiter la compétence de l'arbitre pour apprécier la conduite du plaignant en cas de manquements liés à son alcoolisme sans enfreindre la Charte des droits et libertés de la personne.
Le plaignant travaillait pour l'employeur depuis vingt ans et occupait des fonctions de releveur de compteurs depuis environ quinze ans. Souffrant d'alcoolisme, il a suivi huit cures de désintoxication, de 1990 à 2006, dont le coût a été en grande partie supporté par l'employeur. En octobre 2000, une première entente de réintégration conditionnelle a été signée par les parties. En avril 2006, le plaignant a fait une rechute et a de nouveau amorcé une cure de désintoxication. Une nouvelle entente de réintégration conditionnelle ainsi qu'un protocole médical prévoyant notamment le congédiement immédiat en cas de non-respect ont été signés par les parties. Au mois de juillet suivant, le plaignant a contrevenu à ses engagements; l'employeur l'a congédié en août. Celui-ci prétend que l'arbitre est lié par ces ententes et qu'il doit décliner compétence, d'autant plus que la preuve des violations n'est pas contredite.
Décision
L'entente de « dernière chance » est un instrument extrêmement utile aux parties pour gérer des cas litigieux qui surviennent à répétition. Conçue à partir de la théorie du point culminant et de la progression des sanctions, elle peut éviter à un salarié de perdre son emploi tout en assurant à l'employeur que sa clémence ne lui sera pas un jour fatal. Selon la jurisprudence majoritaire, l'arbitre doit se conformer aux règles juridictionnelles que les parties y prévoient et qui, généralement, se limitent à vérifier si le salarié a respecté les dispositions de l'entente et à confirmer ou infirmer, selon les résultats de cette enquête, le bien-fondé du congédiement. Cependant, de plus en plus d'arbitres affirment qu'une entente de dernière chance ne peut porter atteinte à des droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne, qui est placée au-dessus de toutes les lois de par son caractère quasi constitutionnel et d'ordre public et qui, depuis l'arrêtParry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324(C.S. Can., 2003-09-18), 2003 CSC 42, SOQUIJ AZ-50192747, J.E. 2003-1790, D.T.E. 2003T-923, [2003] 2 R.C.S. 157, doit être considérée comme faisant partie de la convention collective. Ni l'arbitre, ni l'employeur, ni le syndicat ne peuvent faire abstraction des droits fondamentaux d'un salarié lorsqu'il est question d'une entente de dernière chance. Or, l'un de ces droits fondamentaux est ne pas subir de discrimination en raison d'un handicap. Comme il n'est pas contesté que la maladie peut constituer un handicap et que l'alcoolisme est reconnu comme une maladie, il faut conclure qu'une entente de dernière chance est une mesure discriminatoire si elle vise à sanctionner de façon automatique et irrémédiable par un congédiement l'inconduite et les manquements d'un salarié occasionnés par son alcoolisme. En l'espèce, en imposant au plaignant une perte d'emploi automatique en cas de manquement à des engagements conclus directement en relation avec son alcoolisme et en limitant le pouvoir de l'arbitre de vérifier si le plaignant avait réellement commis une faute justifiant son congédiement, les parties ont contrevenu aux dispositions de la charte. Ainsi, le tribunal doit examiner la nature et la gravité des incidents reprochés ainsi que la capacité du plaignant à fournir de façon normale sa prestation de travail dans le contexte des exigences imposées par l'employeur et de son état de santé. Or, bien que le plaignant souffre d'un alcoolisme profond, aucun reproche n'a été formulé quant à la qualité et à la quantité du travail accompli par celui-ci. En tout temps, il a fourni une prestation de travail assidue et ne s'est jamais présenté sous l'effet de l'alcool. De 2000 à 2006, il a eu une longue période sans rechute, sans absences injustifiées ni intervention dans son dossier et il a respecté les termes de sa première réintégration conditionnelle. La rechute de juillet 2006 – provoquée par une perte de maîtrise momentanée et non par l'insouciance ou la mauvaise volonté – de même que son absence injustifiée méritent une sanction sévère, mais non un congédiement. L'obligation d'accommodement de l'employeur devait durer jusqu'à ce que les manquements du plaignant soient considérés comme excessifs. Ainsi, l'absence du plaignant depuis le 11 juillet 2006 sera considérée comme un congé sans rémunération et le retour au travail devra se faire après un examen médical ainsi qu'un dépistage de drogue et d'alcool, qu'il devra passer avec succès sous peine d'être déclaré inapte à exécuter sa prestation de travail. De plus, les ententes conclues continueront à s'appliquer, sauf en ce qui concerne les paragraphes contrevenant à la charte.
Syndicat des employées et employés de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP/FTQ) et Hydro-Québec (Richard Viens), SOQUIJ AZ-50466477
L'arbitre n'a commis aucune erreur manifestement déraisonnable en décidant que, malgré sa politique de « tolérance zéro » en ce qui concerne l'alcool, l'employeur n'aurait pas dû renvoyer le plaignant chez lui parce qu'il n'avait pas démontré qu'il était « sous l'influence de l'alcool » ; il avait conclu que l'odeur d'alcool, jumelée à la rougeur des yeux ainsi qu'à la fatigue du plaignant, ne permet pas d'affirmer que celui-ci était sous l'effet de l'alcool ni d'établir une présomption d'inaptitude de sa part.
Le plaignant a été renvoyé chez lui peu après son arrivée au travail lorsque son contremaître a constaté qu'il avait les yeux rouges, qu'il avait l'air fatigué et qu'il sentait l'alcool. L'employeur a ensuite déduit sept heures de congés flottants de sa banque. Selon l'employeur, son geste était purement préventif et non disciplinaire et il a agi conformément à ses droits de direction, à ses directives internes et aux dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).
Décision
L'arbitre a évalué la preuve et il en tiré des conclusions logiques. Il a refusé de conclure que l'odeur d'alcool dégagée par le plaignant conjuguée à ses yeux rouges et à son air fatigué étaient des éléments suffisants pour inférer que celui-ci était « sous l'effet de l'alcool ». De son côté, l'employeur n'a présenté aucune preuve de l'inaptitude du plaignant. En ce qui a trait au fait que l'arbitre a exigé que l'employeur fasse la démonstration que les facultés physiques ou intellectuelles du plaignant étaient altérées en raison de sa consommation d'alcool alors que le fardeau de preuve appartenait au plaignant, puisque la décision de le renvoyer chez lui était une mesure administrative et non disciplinaire, cet argument ne peut être retenu. L'interprétation de la portée de la règle de conduite imposée par l'employeur et l'application du fardeau de la preuve sont des questions qui relèvent clairement du champ de compétence de l'arbitre; or, son analyse et ses explications sont rationnelles. L'employeur a également invoqué une erreur manifeste du fait que l'arbitre aurait passé outre aux dispositions d'ordre public de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, et particulièrement à son article 51. Même si le raisonnement de l'arbitre ne fait pas précisément référence à l'article 51 LSST, cela ne veut pas dire qu'il n'en a pas tenu compte. En effet, en concluant que le plaignant n'était pas sous l'effet de l'alcool et qu'il n'avait donc pas enfreint le règlement de l'employeur, l'arbitre n'avait pas à aller plus loin dans l'analyse de la législation, dans la mesure où son appréciation de la preuve lui dictait une telle conclusion. Par ailleurs, même s'il eût peut-être été préférable que l'arbitre explique les différences dans le fardeau de preuve associée selon le type de mesure, il n'en demeure pas moins qu'il a considéré que l'employeur n'avait pas de motifs raisonnables pour renvoyer le plaignant chez lui et le priver d'une rémunération. Enfin, lorsque l'arbitre mentionne que les termes de son règlement – politique de « tolérance zéro » – ne sont peut-être pas assez rigoureux pour atteindre son objectif, il ne s'agit que d'un obiter. Ainsi, le résultat auquel en arrive l'arbitre en accueillant le grief n'est pas contraire à la preuve et ses inférences font partie de l'éventail des conclusions possibles auxquelles il pouvait logiquement arriver.
Sanimax ACI inc. c. Poulin, SOQUIJ AZ- 50435288
Incapacité physique ou psychologique
L'employeur ne pouvait utiliser la clause de perte automatique d'emploi et d'ancienneté, malgré l'absence non autorisée de la plaignante – une assembleuse –, parce qu'il disposait de toute l'information médicale lui permettant de conclure qu'elle avait un motif sérieux de s'absenter.
La plaignante occupait un poste d'assembleuse. Depuis le 16 janvier 2006, elle était absente en raison d'une dépression. Son absence a été justifiée périodiquement par des certificats médicaux produits par son médecin traitant; l'employeur n'a jamais remis en cause le sérieux de cette absence et n'a jamais fait examiner la plaignante par un de ses médecins. Le dernier certificat remis à l'employeur, produit le 2 mai 2007, précise l'inaptitude de celle-ci au travail et fait état du délai d'attente quant à la consultation d'un psychiatre en vue de l'obtention de soins psychologiques requis pour la reprise du travail. La psychiatre mandatée par l'assureur a également examiné la plaignante et a conclu que cette dernière était inapte à exercer son métier d'assembleuse et qu'elle requérait des soins psychothérapeutiques. Ce rapport, daté du 24 janvier 2007, faisait partie du dossier de l'employeur. Le 12 juin suivant, l'assureur a fait parvenir à la plaignante et à l'employeur une lettre indiquant que l'information contenue au dossier n'était pas suffisante pour démontrer une invalidité totale à exercer son emploi et que les prestations avaient été interrompues en date du 24 mai précédent. Le 15 juin, l'employeur a envoyé une lettre enjoignant à la plaignante de revenir au travail, étant donné que son état de santé ne correspondait plus à la définition d'invalidité de longue durée prévue au contrat d'assurance. Puis, le 22 juin, il l'a congédiée à la suite de son absence, appliquant l'article 7.05 e) de la convention collective, lequel prévoit que les droits d'ancienneté sont perdus et le lien d'emploi est rompu « si un salarié s'absente de son travail pour une période de plus de trois (3) jours programmés et consécutifs sans autorisation ou pour motif sérieux dont la preuve lui incombe ».
Décision
Plusieurs décisions arbitrales approuvent l'application automatique de clauses semblables à l'article 7.05 e) de la convention lorsqu'un employé n'avise pas son employeur de son absence; cependant, les arbitres attachent également de l'importance aux circonstances entourant la rupture du lien d'emploi. Au soutien de sa prétention selon laquelle la clause visée entraîne la perte d'ancienneté et la fin de l'emploi après une certaine période d'absence, l'employeur invoque l'affaire Hôpital Ste-Croix et Syndicat des employés de l'Hôpital Ste-Croix (T.A., 1983-02-01), SOQUIJ AZ-83145342, D.T.E. 83T-180, A.A.S. 83A-91, [1983] T.A. 204. Selon lui, l'application automatique de cette clause est permise dès qu'une seule de ces deux situations est présente : une absence sans autorisation ou une absence sans motif sérieux. Or, il ressort de l'affaireHôpital Ste-Croix que l'excuse raisonnable ou le motif sérieux peuvent justifier l'absence d'avis. Ainsi, l'interprétation de cette clause doit être restrictive, car son objectif est d'autoriser l'employeur à se départir d'un salarié manifestant son désintéressement à l'égard de son emploi. Lorsque l'absence est justifiée par le handicap du salarié, la prudence s'impose. Comme il ressort de plusieurs décisions, une analyse des circonstances doit être faite. En l'espèce, la plaignante avait reçu en janvier 2006 la permission de s'absenter. Au moment de la réception de l'avis de rappel au travail, en juin 2007, et jusqu'à la présentation d'un nouveau certificat médical, le 29 juin suivant, elle avait toujours le même motif sérieux d'absence. Elle était fondée à croire qu'elle ne devait pas retourner au travail. Le reproche de ne pas avoir réagi comme une personne normale à la réception de cet avis n'est pas justifié, car elle souffrait d'un problème de santé la privant de 50 % de ses capacités. De plus, elle a toujours collaboré avec tous les médecins qui l'ont examinée et elle n'était pas responsable du fait qu'elle n'avait pas été soignée adéquatement. D'autre part, à aucun moment l'employeur n'a écrit à la plaignante entre le début de son invalidité, en janvier 2006, et le 15 juin 2007, moment de l'envoi de l'avis de rappel au travail. En outre, celui-ci n'est fondé que sur l'opinion de l'assureur selon laquelle l'état de santé de la plaignante ne correspondait plus à la définition d'invalidité à long terme au sens de la police d'assurance. Dans son dossier, en plus d'avoir tous les certificats médicaux produits par le médecin traitant, l'employeur disposait d'une lettre de l'assureur datée du 5 avril lui indiquant que la psychiatre travaillant pour son compte avait fait un rapport d'expertise dans lequel elle concluait à la possibilité d'un retour au travail seulement après l'écoulement d'un délai de 8 à 10 semaines suivant un traitement psychologique. De plus, cette opinion du médecin de l'assureur n'était pas empreinte de complaisance. Le dernier certificat du médecin traitant, daté du 2 mai 2007, confirmait que la plaignante était toujours en attente de soins psychologiques requis par son état de santé. L'employeur pouvait de plus obtenir de l'assureur toutes les informations voulues et pouvait communiquer avec la plaignante. En outre, il a reproché à cette dernière, dans son avis de congédiement, de ne pas avoir fourni d'autres certificats médicaux après le 18 juin 2007, mais il ne lui en avait jamais demandé. La plaignante ne s'était pas désintéressée de son emploi; dès qu'elle a pu voir son médecin, soit le 29 juin 2007, elle a fourni un certificat médical. L'employeur ne pouvait appliquer de façon automatique la clause 7.05 e), étant donné toutes les informations dont il disposait au sujet de l'état de santé de la plaignante. En conséquence, la décision de l'employeur de mettre fin à l'emploi de la plaignante et de lui faire perdre ses droits d'ancienneté est annulée et la plaignante est réintégrée dans ses droits.
Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 et VKI Technologies inc. (grief syndical), SOQUIJ AZ-50513530
L'employeur n'a pas réussi à démontrer que l'obligation faite à un chef d'équipe présentant une condition cardiaque d'effectuer chacune des tâches de son poste, y compris les plus épuisantes, constitue une exigence professionnelle justifiée; le congédiement est annulé.
Le plaignant était chef d'équipe au service des travaux publics de la municipalité depuis plusieurs années lorsque, en février 2002, il a subi une chirurgie cardiaque. À son retour au travail, en décembre, les parties se sont entendues pour qu'il ne soit affecté que deux jours par semaine à son poste habituel. Le reste du temps, il était de garde et recevait les appels d'urgence. En mars 2005, l'employeur a mis fin à cette entente. Le plaignant a alors repris son poste à temps plein. En janvier 2006, il a subi une évaluation médicale à la demande de l'employeur. Le médecin expert a conclu que ses fonctions de chef d'équipe étaient incompatibles avec ses limitations fonctionnelles. Il a recommandé un départ à la retraite. Le 5 mai suivant, le plaignant a reçu une lettre de l'employeur l'avisant qu'il était placé en arrêt de travail. Estimant qu'il s'agissait d'un congédiement, le syndicat a déposé un grief à l'encontre de cette mesure. L'employeur soutient qu'il a plutôt procédé à une suspension administrative. Il fait valoir que la résolution du conseil municipal relative au congédiement n'a été adoptée que le 6 juin 2006, de sorte que le grief serait prématuré. Le syndicat soutient que le plaignant a été congédié à cause de son état de santé et de son âge (71 ans), en violation de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. De son côté, l'employeur prétend que le congédiement était fondé sur une exigence professionnelle justifiée au sens de l'article 20 de la Charte.
Décision
Le 5 mai 2006, la partie syndicale a reçu un avis qui pouvait fort bien être interprété comme un avis de congédiement. On ne peut lui reprocher d'avoir alors déposé un grief à l'encontre de cette mesure. Au surplus, les tribunaux ont traité la question de la prématurité d'un grief comme constituant un vice de forme ou de procédure qui ne doit pas être fatal (Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999 c. Lussier (C.S., 1986-05-09), SOQUIJ AZ-86149072, D.T.E. 86T-380). D'autre part, l'employeur n'a subi aucun préjudice du fait que le grief de congédiement ait été déposé avant l'adoption de la résolution du conseil municipal. Par conséquent, l'objection est rejetée.
Quant au fond, le syndicat a prouvé l'existence d'un préjudice, soit le congédiement, et d'un lien entre cette mesure et le motif de discrimination prohibé, soit le handicap résultant de l'état de santé du plaignant. Par conséquent, il incombait à l'employeur de démontrer que le congédiement était justifié et fondé sur des aptitudes ou qualités requises par l'emploi de chef d'équipe. À cet effet, l'employeur soutient que le plaignant devait pouvoir effectuer « la totalité des tâches du poste ». En effet, cette norme a été adoptée dans un but rationnellement lié à l'exécution du travail de chef d'équipe. De plus, l'employeur croyait sincèrement que cette norme était nécessaire pour atteindre le but qu'il poursuivait, à savoir une plus grande efficacité. Il reste à déterminer s'il a démontré son incapacité de composer avec les limitations du plaignant sans subir de contrainte excessive. Selon la preuve médicale, le plaignant pouvait, sans danger pour lui ou ses collègues, continuer à remplir ses fonctions de chef d'équipe, dans la mesure où il n'effectuait pas lui-même les tâches épuisantes décrites aux quatre premiers paragraphes de la description d'emploi. L'employeur avait déjà appliqué des mesures d'accommodement en 2002 et en 2005 sans que cela pose problème. Il s'agissait donc d'accommodements raisonnables. À partir de 2002, l'employeur a ainsi supporté une certaine contrainte. Or, il n'a pas démontré pourquoi et comment cette contrainte était devenue excessive en 2006, d'autant moins que l'état de santé du plaignant était demeuré stable à cette époque et que celui-ci avait toujours fourni sa pleine collaboration quant aux accommodements proposés. Par conséquent, on doit conclure que la norme édictée par l'employeur n'est pas une exigence professionnelle justifiée. En congédiant le plaignant à cause de son handicap, il n'a pas respecté le droit de ce dernier à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, de ses droits et libertés. Le congédiement est annulé.
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1084 et Rawdon (Municipalité de), (Jacques Bélisle), SOQUIJ AZ-50507609
L'employeur n'a pas été suffisamment « proactif » et innovateur dans la recherche d'un accommodement raisonnable pour un salarié – un papetier – affligé d'un handicap relié à des lésions professionnelles; il aurait dû réintégrer celui-ci dans un poste de préposé aux triturateurs et à la guillotine.
Le plaignant a été embauché à un poste de papetier en 1987. Un an plus tard, il a subi un accident du travail, qui lui a causé une lésion professionnelle au dos. Il s'est absenté pour cause d'invalidité pendant presque quatre ans. En 1994, il a subi un second accident du travail, qui lui a cette fois causé une lésion professionnelle au genou. Par la suite, il a connu de nombreux arrêts de travail en raison de ses problèmes au dos et au genou. Le 12 avril 2005, l'employeur l'a informé de sa mise à pied au motif qu'il n'était pas apte à occuper son poste de papetier ni un autre poste disponible de triturateur. Il a fondé sa décision sur l'avis de son médecin expert, selon lequel le plaignant présentait des risques de rechute et de récidive et ses limitations fonctionnelles ne lui permettaient pas d'occuper les postes en question. Le syndicat a invoqué le rapport du médecin traitant du plaignant établissant son aptitude au travail sans limitations fonctionnelles à compter de l'automne 2004. Même s'il existait de telles limitations, il a allégué que l'employeur n'avait pas assumé son obligation d'accommodement à l'égard du plaignant. L'employeur a soutenu qu'il a tenté d'accommoder ce dernier en lui offrant un plan de réadaptation personnalisé, mais que ce dernier a refusé cette offre. Il a ajouté que le certificat médical du médecin traitant du plaignant constituait un certificat de complaisance.
Décision
La preuve médicale concernant l'aptitude au travail du plaignant est contradictoire. D'une part, son médecin traitant établit que ses lésions professionnelles sont consolidées et qu'il est apte au travail sans aucune limitation. D'autre part, le médecin expert de l'employeur conclut que la condition du plaignant comporte de sérieux risques de rechute ou de récidive et que celui-ci n'est pas apte à occuper le poste de papetier ou de triturateur. L'arbitre n'a pas à s'ingérer dans le débat et encore moins à départager les opinions divergentes sur la base de leur dimension médicale ou scientifique. Il doit strictement choisir l'explication qui lui semble la plus probable en tenant compte de l'objectivité et de la crédibilité qu'il reconnaît aux auteurs d'opinions divergentes. En l'espèce, autant la démarche du médecin traitant à l'effet de reconnaître l'aptitude au travail du plaignant paraît audacieuse, autant l'opinion du médecin de l'employeur semble trop prudente et même exagérément alarmiste. Le Tribunal conclut que, lors de son évaluation par le médecin de l'employeur, le 27 octobre 2006, le plaignant souffrait d'une pathologie justifiant la reconnaissance de limitations fonctionnelles. Toutefois, le fait qu'il travaillait dans une fromagerie depuis un an sans ressentir de douleurs révélait une amélioration de sa condition ne permettant pas de conclure à un risque réel et immédiat de rechute. Dans ce contexte, il faut se demander si l'employeur a assumé son obligation d'accommodement à l'égard du plaignant, qui souffrait d'un handicap. À cet égard, il y a une intention réelle d'accommoder lorsqu'on commence à modifier ou à adapter des composantes de travail, notamment par l'élimination de certaines exigences pour occuper un poste, le retrait de certaines tâches, la redistribution de responsabilités ou l'ajout d'équipements facilitateurs. L'employeur n'a pas à créer un poste sur mesure. Il doit toutefois évaluer la possibilité de procéder à certaines modifications devant permettre de répondre à la situation de l'employé souffrant d'un handicap. En l'espèce, l'offre de l'employeur d'un plan de réadaptation personnalisé conditionnelle au retrait des griefs du plaignant ne constituait pas une offre raisonnable. Relativement au poste de papetier, l'employeur ne pouvait offrir au plaignant des accommodements répondant à sa condition médicale sans subir de contraintes excessives. Il pouvait cependant lui en offrir certains qui lui auraient permis d'occuper le poste de triturateur, notamment en l'exemptant des tâches les plus exigeantes et en lui permettant de s'aider de certains outils. Dans la mesure où de tels accommodements ne nécessitaient pas la création d'un poste spécialement adapté au plaignant, l'employeur aurait dû réintégrer ce dernier avec certains accommodements, et ce, à compter du 27 octobre 2006. Le grief est donc accueilli.
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 253 et Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, division Beaupré (Alain Boutet), SOQUIJ AZ-50496868
La plaignante n'a pas manqué à son obligation de loyauté puisque les activités personnelles exercées durant son arrêt de travail n'étaient pas incompatibles avec sa condition médicale; par conséquent, sa suspension est annulée.
Le 27 mai 2005, la plaignante, une agente approvisionneure, a subi un accident du travail, soit une entorse cervicale et lombaire. Jusqu'au 15 juillet suivant, elle a été affectée à des travaux légers, sauf pour la période du 20 juin au 4 juillet, où elle était en arrêt de travail. Les 17 et 18 juin, elle a effectué des heures supplémentaires. Le 21 juin, son médecin a refusé l'assignation temporaire proposée par l'employeur parce qu'elle comportait des travaux non favorables à la réadaptation de la plaignante. Les 21, 22 et 23 juin, l'employeur a fait effectuer une filature de cette dernière. Sur la bande vidéo réalisée à cette occasion, on la voit notamment transporter des sacs d'épicerie, une caisse de 24 bouteilles de bière et une caisse de 24 cannettes de boissons gazeuses. Le 17 août, l'employeur l'a suspendue pour quatre mois au motif qu'elle avait exercé des activités incompatibles avec son état de santé déclaré à l'occasion de son arrêt de travail.
Décision
L'article 2088 du Code civil du Québec prévoit que le salarié est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence et qu’il doit faire preuve de loyauté; c'est le manquement à ces obligations que l'employeur invoque afin de justifier la suspension. En l’espèce, l'événement qui a conduit celui-ci à exercer une filature de la plaignante est le refus par son médecin de l’affectation à des travaux légers alors qu'elle avait effectué des heures supplémentaires. En ce qui concerne celles-ci, l'affirmation selon laquelle elle n'a alors pas manipulé de pièces lourdes est crédible. Quant au rapport médical sur la base duquel l'employeur a suspendu la plaignante, il a été rédigé à partir d'un dossier médical incomplet. De plus, ses conclusions sont basées sur le visionnement d'un enregistrement vidéo dans lequel on voit la plaignante accomplir des gestes de la vie courante qui ne sont pas incompatibles avec le traitement prescrit par son médecin traitant. D'autre part, l'arrêt de travail pendant une courte période visait à accélérer le processus de rétablissement et constituait une modalité de traitement. Par ailleurs, la blessure a été consolidée deux mois après la lésion, ce qui est inférieur au délai moyen de trois mois pour une telle lésion. Enfin, la plaignante compte vingt-sept ans d'ancienneté et elle n'a aucun dossier disciplinaire. La suspension de quatre mois est donc annulée et l'employeur devra lui verser une indemnité équivalant aux pertes financières qu'elle a subies en raison celle-ci.
Syndicat national des employés de l'aluminium d'Alma inc. (section des employés de bureau) et Alcan inc., usine Alma (Dorys Trottier), SQOUIJ AZ-50498109
La bande vidéo et le témoignage de l'enquêteur ayant procédé à la filature du plaignant – un aide-magasinier – pendant son absence sont déclarés irrecevables, puisque l'employeur n'avait aucun motif sérieux de douter de son honnêteté; en outre, accepter la production de la preuve matérielle aurait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice.
Au moment de son congédiement, le plaignant comptait trente-deux ans de service et occupait le poste d'aide-magasinier. Le 18 avril 2006, il a subi une lésion professionnelle à la hanche, qui a nécessité un arrêt de travail. Durant son absence, l'employeur a fait effectuer une filature du plaignant. Celui-ci a été congédié le 5 juin suivant pour avoir accompli des activités personnelles incompatibles avec l'incapacité alléguée. À l'audience, le syndicat s'est opposé à la recevabilité de la preuve issue de la surveillance (bande vidéo, témoignage de l'enquêteur et commentaires des médecins) aux motifs qu'elle constitue une atteinte à la vie privée du plaignant et que sa production aurait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. Quant au fond, le syndicat affirme que l'absence du plaignant était motivée et que ce dernier n'a commis aucune faute.
Décision
La jurisprudence enseigne qu'il faut des motifs sérieux et rationnels pour recourir à la filature d'un salarié et que celle-ci doit être menée de la façon la moins intrusive possible. En l'espèce, la décision de procéder à une surveillance du plaignant a été prise le jour suivant l'accident du travail, avant même la réception de la première attestation médicale. La direction le soupçonnait d'avoir organisé cette manœuvre afin d'obtenir indûment un congé. Ses soupçons se fondaient plus particulièrement sur quatre éléments : une rumeur selon laquelle il aidait à la construction de la maison de sa fille; une demande de congé rejetée le 3 avril; l'emprunt, depuis le 20 mars, d'une scie à céramique; le fait que le plaignant avait terminé son quart après l'accident. Or, que ces éléments soient considérés de façon isolée ou globalement, on ne peut y voir des motifs sérieux de douter de l'honnêteté du plaignant. Aucun ne concerne l'état de santé de ce dernier. Si l'employeur avait des doutes sur l'accident du travail, il aurait dû demander une expertise médicale avant de décider de la filature. D'autre part, même si le Tribunal avait déclaré la bande vidéo recevable, il en serait venu à la même conclusion. En effet, tout au long du processus de filature, l'employeur est allé à la recherche de preuve. Suivre le plaignant chez lui et chez sa fille pendant huit longues journées constitue une trop grande intrusion dans la vie privée de ce dernier. Accepter en preuve la bande vidéo aurait donc pour effet de déconsidérer davantage l'administration de la justice que le contraire. Quant au fond, le plaignant s'est absenté en raison d'un accident du travail reconnu par l'organisme compétent. Le fait de mentir par omission – si tel est le cas – ne constitue pas un motif pour congédier un salarié ayant accumulé plus de trente ans d'ancienneté et qui possède un dossier disciplinaire vierge. Affirmer que le plaignant a voulu profiter des indemnisations et qu'il a exercé des activités personnelles incompatibles avec sa « prétendue » incapacité serait décider a posteriori, ce que le Tribunal ne peut faire. Le congédiement est annulé et la réintégration est ordonnée.
Syndicat national des travailleurs des pâtes et papiers de Donnacona inc. (CSN) et Produits forestiers Alliance inc. (Bowater), (Marcel Barbeau), SOQUIJ AZ-50487873
Le congédiement du plaignant, un apprenti électricien ayant fait des gestes dangereux sans en connaître les conséquences, est abusif étant donné que l'employeur partage une part de cette responsabilité, car il n’a pas fourni la supervision adéquate; une suspension sans solde de deux mois est justifiée étant donné les risques sur la santé et la sécurité ainsi que les dommages qu'aurait pu causer une explosion.
Résumé
Griefs contestant une suspension aux fins d'une enquête et un congédiement. Accueillis en partie; une suspension sans solde de deux mois est substituée au congédiement.
Le plaignant, un apprenti électricien, a été appelé à travailler pendant un quart de travail au cours duquel on a procédé aux premiers essais d'un nouvel équipement dans le contexte d'un projet visant à produire de l'électricité avec la vapeur générée par l'usine. Le jour des événements, il devait, en cas de besoin, aider un collègue ingénieur et un représentant d'une autre entreprise. À son arrivée, on lui a demandé de régler un problème ayant causé un arrêt des équipements durant la nuit, mais son supérieur est intervenu et lui a dit d'attendre l'appel de l'ingénieur électricien. Entre-temps, le plaignant a fait des recherches et a tenté de trouver la source du problème jusqu'à ce que le représentant de l'autre entreprise lui mentionne que le problème provenait probablement d'un autre disjoncteur. C'est à ce moment que l'ingénieur électricien a appelé et a demandé que certains systèmes soient réarmés. Devant l'insuccès de cette démarche, le plaignant s'est dirigé vers l'autre disjoncteur et a tenté de réarmer le système à trois reprises. Cela a provoqué des arrêts d'équipements et une baisse d'intensité de l'électricité. Le plaignant a reconnu ses torts et a parlé de démission. Il a changé d'idée après la rencontre avec le syndicat. L'employeur invoque un manque de jugement justifiant le bris du lien de confiance et prétend que le congédiement est de nature administrative.
Décision
Le congédiement est de nature disciplinaire, car l'employeur a abusé de son droit en allant au-delà de ce qu'un employeur raisonnable placé dans des circonstances similaires aurait fait. Le plaignant était un apprenti, il travaillait à des essais à l'aide d'un nouvel équipement, il n'avait pas de formation et l'identification des disjoncteurs n'était pas terminée. Dans un tel cas, il aurait fallu être plus prudent. On doit aussi tenir compte de l'investissement de près de 90 millions de dollars, de l'étape cruciale où en était rendu le projet ainsi que du fait que le plaignant a eu à faire face à un arrêt de l'équipement dès son arrivée et qu'il travaillait sous la pression d'une urgence. Selon la preuve, on aurait dit au plaignant d'attendre, qu'on allait communiquer avec lui. Jamais on ne lui a dit de ne toucher à rien et on ne l'a affecté à aucune autre tâche. De plus, en collaborant avec lui à deux reprises alors qu'il tentait de trouver la source du problème, son supérieur a tacitement approuvé sa démarche. D'un autre côté, le plaignant a été téméraire en préférant chercher à résoudre le problème au lieu de s'informer avant d'agir ou d'attendre que l'ingénieur communique avec lui. Il a également été imprudent en manipulant un disjoncteur contrôlant jusqu'à 13 800 volts, mais cette démarche était guidée par son désir de rétablir la mise en marche de l'équipement. Toutefois, l'employeur a eu un comportement abusif en voulant lui faire porter l'entière responsabilité de l'incident: il a fait preuve de négligence en l’affectant aux essais sans un encadrement adéquat. Le congédiement est donc abusif. De plus, la gravité de la faute commise est atténuée par le fait que le plaignant a eu sa leçon, que la possibilité de répétition est improbable étant donné les modifications apportées aux équipements et que de la formation est prévue. Quant aux éléments techniques de son geste, il n'est pas utile de s'y attarder puisque le plaignant aurait dû faire l'objet d'une supervision minimale, comme le prévoit la réglementation applicable aux apprentis électriciens. On doit également considérer qu'il avait un dossier disciplinaire vierge et respecter le principe de la gradation des sanctions. Toutefois, à titre de facteur aggravant, il faut tenir compte du fait qu'une explosion aurait pu mettre en danger la santé et la sécurité du plaignant et de ses collègues de même que causer des dommages aux équipements. Une suspension sans solde de deux mois est donc substituée au congédiement.
Syndicat des travailleuses et travailleurs des pâtes et du papier de Brompton — CSN et Kruger inc. (Sébastien Houle),SOQUIJ AZ-50482068
Le centre jeunesse n'a pas prouvé que les fautes commises par un agent de relations humaines justifiaient son retrait de la liste de disponibilité à l'urgence sociale; ayant traité les manquements sous l'angle administratif, il a échoué à démontrer l'incapacité du plaignant à satisfaire aux exigences normales de la tâche.
Le plaignant travaille au service d'un centre jeunesse depuis 1999. Il détient un poste à temps plein d'agent de relations humaines (ARH). En août 2001, il a été inscrit sur la liste de disponibilité des salariés disposés à assumer, à tour de rôle, la garde téléphonique de l'urgence sociale, la nuit et la fin de semaine. Le 23 septembre 2005, son nom a été retiré définitivement de cette liste au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de la tâche ainsi que l'exige une lettre d'entente conclue en 2000. Selon l'employeur, le plaignant a commis cinq manquements entre décembre 2003 et septembre 2005. Le syndicat soutient que ce dernier a été visé par une mesure disciplinaire injustifiée et qui ne respecte pas le principe de la progression des sanctions. L'employeur réplique que sa décision constitue une mesure administrative parce qu'elle vise à prévenir un préjudice à l'établissement.
Décision
L'employeur avait considéré que le plaignant satisfaisait aux exigences de la tâche lorsqu'il a consenti à inscrire son nom sur la liste de disponibilité de l'urgence sociale. D'autre part, aucun reproche n'a été adressé au plaignant relativement à ses tâches habituelles. Or, celles-ci sont du même ordre que le travail qu'il doit accomplir dans le contexte de la garde à l'urgence sociale. Ces éléments permettent de présumer qu'il satisfait aux exigences normales de cette tâche de garde. La preuve patronale est insuffisante pour réfuter cette présomption. Les manquements reprochés au plaignant sont tous attribuables à un comportement fautif de sa part : à cinq occasions, il a fait preuve de négligence. Comme toute faute de nature comportementale, la négligence est un manquement disciplinaire qui doit être sanctionné par une mesure proportionnelle. Conclure, à partir des cinq fautes professionnelles mises en preuve, que le plaignant est incapable de remplir les exigences normales de l'emploi d'ARH de garde à l'urgence sociale est abusif, d'autant plus que l'employeur n'a jamais cru devoir sévir à son endroit autrement qu'au moyen de simples avertissements.
Syndicat des professionnelles et professionnels du réseau de la santé et des services sociaux de l'Outaouais (SPPRSSSO) et Centres jeunesse de l'Outaouais (Nicolas Bourgeois), SOQUIJ AZ-55000296
La suspension de cinq jours imposée au plaignant – préposé à l'entretien ménager – à la suite de plaintes d'un client est annulée; comme son chef d'équipe ne lui a pas donné plus de temps alors qu'il lui a assigné un nouvel itinéraire de travail, il est normal que certaines tâches en aient souffert.
Le plaignant, un préposé à l'entretien ménager, a été affecté dans une entreprise du secteur pétrolier à compter de juillet 2004. Son superviseur l'a rencontré à quelques reprises relativement à la qualité de son travail. En mars 2006, à la suite de la plainte d'un client, l'employeur lui a remis un premier avis disciplinaire dans lequel il lui reprochait notamment de ne pas avoir lavé les planchers et les toilettes correctement. Au mois d'avril suivant, un second avis disciplinaire, qui contenait des reproches similaires, lui a été remis. Le 9 juin 2006, il a été suspendu deux jours pour les mêmes motifs. En juillet, le plaignant a posé sa candidature et a obtenu un poste de préposé à l'entretien ménager pour un autre contrat. Au cours de l'automne, le superviseur a été remplacé. Le nouveau chef d'équipe a ajouté des tâches à celles normalement dévolues au plaignant sans lui donner davantage de temps pour exécuter son travail. Le 16 novembre, ce dernier a de nouveau été suspendu, pendant cinq jours, au motif qu'il exécutait mal son travail.
Décision
Pour ce qui est des avis disciplinaires de mars et d'avril 2006, la preuve de l'employeur sur l'état des planchers et des toilettes est claire, sans équivoque et non contredite. Par ailleurs, le plaignant avait été averti verbalement à quelques reprises avant l'imposition de la première mesure. Les deux avis sont donc justifiés. Quant à la suspension de deux jours en juin 2006, elle a fait suite à une inspection effectuée dans les jours qui l'ont précédée et qui avait révélé de nombreuses lacunes dans le travail exécuté par le plaignant. Ce dernier n'ayant donné aucune explication, la suspension est par conséquent justifiée et elle s'inscrit dans le principe de la progression des sanctions. En ce qui a trait à la suspension de cinq jours imposée au mois de novembre suivant, à la suite de deux plaintes d'un client relativement à la qualité du travail du plaignant, ce dernier ne nie pas les difficultés éprouvées. Or, comme son superviseur ne lui a pas donné plus de temps pour s'acquitter de ce nouvel itinéraire de travail, il est normal que certaines tâches en aient souffert. Le chef d'équipe prétend avoir retranché certaines tâches de sa tournée habituelle pour compenser les ajouts. Toutefois, devant des versions contradictoires, il y a lieu de privilégier celle du plaignant, laquelle s'intègre bien dans la logique du déroulement des faits où, dans un contexte d'absence d'animosité, du mois d'août au mois de novembre, l'employeur n'a eu aucun reproche à lui faire quant à l'exécution de son travail, alors qu'après l'ajout de tâches, au mois de novembre, le plaignant n'arrivait pas à produire un travail de qualité dans les limites de temps imparties. Cet état de fait tend à corroborer de façon circonstancielle la version de ce dernier selon laquelle il y a eu surcharge de travail. La suspension de cinq jours est par conséquent annulée.
Union des employées et employés de service, section locale 800 et Service d'entretien Distinction inc. (Luis Fernando Ortega-Murcia), SOQUIJ AZ-50429283
Le congédiement imposé pour ne pas avoir réussi l'examen afin d'obtenir un permis est annulé; ce n'est pas un geste fautif qui mérite une sanction disciplinaire et, même du point de vue de la mesure administrative, la décision de l'employeur est abusive puisque cette exigence ne constituait pas une condition de travail lors de l'embauche bien qu'elle le soit devenue par la suite.
Le plaignant a été embauché à titre de préposé au service aux passagers en mars 2004. Au mois d'avril suivant, l'employeur a émis une directive par laquelle tous les salariés à son service devaient détenir un permis DA, prévu à la Directive sur la circulation en zone réglementée aux aéroports internationaux de Montréal-Trudeau et Mirabel, leur permettant de circuler sur les aires de trafic et sur les routes de l'aéroport. Cette directive stipulait notamment les modalités de reprise des examens en cas d'échec. En mars 2005, l'employeur a remarqué que plusieurs salariés, dont le plaignant, ne détenaient toujours pas le permis. Il a alors affiché une note de service avisant les salariés en poste depuis plus de trois mois qu'ils avaient un délai de un mois pour obtenir ce permis. Le plaignant n'ayant toujours pas entrepris les démarches nécessaires, il a été avisé personnellement qu'il avait jusqu'à la mi-mai pour s'exécuter. Il n'a pas réagi à cet avis. Le 24 mai suivant, l'employeur a prolongé le délai jusqu'au 31 mai. Le 3 juin, ne s'étant toujours pas conformé à la directive, il a été suspendu une journée. Malgré cette mesure, le plaignant n'a entrepris aucune démarche pour l'obtention du permis DA, de sorte que, le 19 juin, l'employeur lui a imposé une nouvelle suspension, de trois jours, à la suite de laquelle il s'est inscrit aux examens. Le 16 juillet, il a été avisé qu'il avait jusqu'au 2 août pour réussir l'examen théorique et que, en cas d'échec à l'examen pratique, l'employeur n'aurait d'autre choix que de mettre fin à son emploi. Il a finalement réussi l'examen théorique, le 2 août 2005, après quatre échecs. Le 16 août, il a échoué à son examen pratique. Le 20 août, il a été congédié.
Décision
Le congédiement est ici une mesure disciplinaire puisqu'il s'agit de la concrétisation de l'ultimatum signifié au plaignant le 16 juillet. L'employeur a par ailleurs admis avoir imposé la mesure parce que le plaignant n'avait pas démontré de bonne volonté pour amorcer le processus d'obtention du permis DA, et ce, même après avoir eu plusieurs chances. Il est donc clair que l'employeur considérait le comportement du plaignant comme fautif et qu'il a cherché à punir sa conduite et aussi son échec. Toutefois, la directive donnait au plaignant des droits de reprise qui lui ont été niés. En outre, sa négligence à prendre les mesures nécessaires à l'obtention du permis a été sanctionnée par des mesures disciplinaires non contestées. Cette négligence ne saurait donc être sanctionnée deux fois. Or, le 20 août, le reproche qui lui a été fait est d'avoir omis de suivre la directive. Toutefois, ce reproche n'est pas fondé puisque, à compter du 19 juin, le plaignant a pris les moyens nécessaires pour réussir son examen théorique. S'il n'a pas obtenu le permis, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Tout ce que l'employeur pouvait lui reprocher est d'avoir échoué à son examen pratique. Or, l'échec à un examen n'est pas un geste fautif méritant une sanction disciplinaire. Par ailleurs, même si la mesure devait être considérée comme administrative, le geste du 20 août aurait été abusif. En effet, l'obtention d'un permis DA n'était pas une condition de travail à l'embauche, bien qu'elle le soit devenue par la suite. Or, il faut faire une distinction entre ces deux situations. Même si l'employeur pouvait exiger que le plaignant prenne les mesures nécessaires pour se présenter aux examens, il devait par contre respecter les conditions d'obtention du permis énoncées à la directive. Il ne pouvait imposer des conditions plus restrictives. Le congédiement est donc annulé et les parties ont un délai de 30 jours pour s'entendre sur les conditions de la réintégration et de l'obtention du permis DA.
Teamsters Québec, section locale 1999 et Handlex inc. (Michel Pariseault), SOQUIJ AZ-50421187
Un employeur ne peut procéder à un congédiement pour incompétence sans se conformer aux exigences reconnues par la jurisprudence.
Au mois de juillet 2005, l'employeur, une municipalité, a embauché le plaignant à un poste de mécanicien temporaire. Conformément à la convention collective, le plaignant a alors commencé une période d'essai de 60 jours. À la fin du mois d'août, avant l'expiration de la période d'essai, l'employeur a conclu que le plaignant satisfaisait aux exigences normales du poste et a confirmé son embauche au poste temporaire par résolution le 19 septembre suivant. Le plaignant conteste le refus de l'employeur de lui attribuer un poste de mécanicien permanent ayant fait l'objet d'un affichage au mois de décembre 2005. Il soutient qu'il était le candidat comptant la plus grande ancienneté et qu'il remplissait les exigences normales du poste. De plus, il conteste la décision de l'employeur de mettre fin à son emploi, le 20 janvier 2006, pour cause d'incompétence. L'employeur allègue que le plaignant a commis de nombreuses erreurs démontrant qu'il ne satisfaisait plus aux exigences normales du poste. Pour sa part, le syndicat affirme que les erreurs reprochées au plaignant sont liées au départ d'un camarade de travail qui l'aidait à accomplir ses tâches ainsi qu'à un manque de soutien de la part de l'employeur.
Décision
Jusqu'à l'expiration de la période d'essai de 60 jours, l'employeur disposait de la possibilité de mettre fin à l'emploi du plaignant sans que ce dernier puisse se prévaloir du droit à la procédure de grief. Or, il a plutôt décidé que le plaignant satisfaisait aux exigences normales du poste, et ce, avant même l'expiration de la période d'essai. Par ailleurs, aucun élément ne permet de conclure que le plaignant ne remplissait plus ces exigences au moment de son congédiement. Il semble plutôt que, à compter du 28 novembre 2005, il ait perdu le soutien dont il bénéficiait auparavant et qu'il se soit trouvé le seul mécanicien de son quart de travail. Or, il a tout de même continué à satisfaire aux exigences normales du poste. Au surplus, l'employeur ne pouvait procéder à son congédiement pour incompétence sans préalablement se conformer aux obligations reconnues dans la jurisprudence. Celle-ci établit que : 1) le salarié doit connaître les attentes de l'employeur; 2) son rendement doit être significativement insatisfaisant par rapport à celui des autres employés; 3) il doit avoir été avisé que son rendement est insatisfaisant; 4) il doit avoir bénéficié de l'aide ainsi que du soutien nécessaire pour corriger la situation et il doit avoir été prévenu des conséquences d'une absence d'amélioration sur la relation d'emploi; et 5) la décision de l'employeur doit avoir été prise de bonne foi. En l'espèce, l'employeur n'a pas respecté la plupart de ces obligations et sa décision de congédier le plaignant pour incompétence était donc hâtive. Quant à l'obligation de bonne foi, elle doit s'apprécier non pas en recherchant une intention malicieuse ou frauduleuse, mais en fonction de la rigueur du processus d'évaluation suivi par l'employeur. En l'espèce, l'employeur a confirmé que le plaignant satisfaisait aux exigences normales du poste de mécanicien temporaire et donc nécessairement à celles du poste de mécanicien permanent. Il ne pouvait lui appliquer des critères d'évaluation plus élevés pour l'obtention de ce poste. Pour ces motifs, les deux griefs sont accueillis.
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Ste-Adèle (CSN) et Ste-Adèle (Ville de), (Jean-François Goupil) ,SOQUIJ AZ-50424624
Le congédiement pour insuffisance professionnelle est annulé, l'employeur n'ayant pas fait connaître suffisamment à la plaignante – technicienne en loisirs – ses attentes quant à la planification et à l'organisation du travail ainsi qu'à la gestion des priorités ni donné d'avis suffisant selon lequel son rendement était insatisfaisant.
La plaignante, une technicienne en loisir au service d'une école secondaire, a fait l'objet d'un renvoi. L'employeur lui reproche son incapacité à remplir ses fonctions, notamment ses manquements récurrents résultant de son peu de diligence dans le traitement des effets de commerce, ses difficultés majeures à gérer ses priorités, son sens de la planification et de l'organisation déficient de même que le fait qu'elle n'a pas réinvesti la formation reçue et ne s'est pas approprié une formation en informatique.
Décision
Puisque la mesure imposée est de nature administrative, il faut déterminer si la situation que l'employeur voulait corriger se prêtait à une telle approche. Ainsi, un manquement volontaire donnera généralement ouverture à une sanction disciplinaire alors qu'un manquement involontaire sera traité administrativement. Le salarié et l'employeur ont, dans la relation d'emploi, des devoirs et des obligations. En échange de sa rémunération, le salarié doit fournir la prestation de travail attendue. Les obligations qui lui incombent ont trait à son comportement et à l'exécution du travail. Par ailleurs, il s'avère parfois difficile, comme en l'espèce, d'établir avec justesse la nature du manquement et, en conséquence, l'approche à suivre. En effet, certains reproches ont trait à des tâches précises, de nature administrative, et bien circonscrites : le traitement des effets de commerce. D'autres reproches ont plutôt trait à une insuffisance professionnelle en planification, organisation et gestion des priorités. Or, l'incapacité est généralement reconnue comme étant un manquement involontaire, alors que la négligence est plutôt perçue comme un manquement volontaire. En l'espèce, l'employeur n'a pas imposé une mesure dans le but de punir un manquement volontaire, mais afin d'assurer une bonne gestion de l'organisation, en écartant une salariée qu'il estimait incapable, bien qu'involontairement, de remplir les exigences normales de son emploi. En conséquence, il était fondé à suivre une approche administrative pour insuffisance professionnelle. Essentiellement, le motif à l'origine du renvoi est que la plaignante aurait omis de déposer des sommes d'argent dans un délai acceptable, et ce, en raison d'une mauvaise organisation de son travail. D'autre part, l'employeur pouvait, dans la lettre de renvoi, invoquer le fait que les mesures administratives qu'il a mises en place pour aider la plaignante à améliorer son rendement n'auraient pas donné les résultats escomptés et faire valoir le caractère chronique des manquements relatifs à l'exécution des tâches. La preuve ayant toutefois révélé que le retard dans le traitement des sommes d'argent est explicable, on ne peut conclure que le renvoi est une mesure raisonnable. En effet, il n'est pas possible de faire un lien entre la difficulté d'organiser son travail et de gérer ses priorités et l'omission de traiter les effets de commerce. L'employeur espérait que la plaignante joue un rôle différent, axé sur l'étude des besoins de la clientèle et le développement d'activités. De plus, la preuve n'établit pas que la plaignante ne fournissait pas une prestation de travail satisfaisante quant aux attributions caractéristiques de son emploi. En ce qui a trait au processus préalable au renvoi, l'employeur a fait valoir que son omission d'aviser officiellement la plaignante qu'elle serait congédiée si elle n'améliorait pas son rendement ne suffit pas pour permettre à l'arbitre d'annuler sa décision. Or, même en matière administrative, un employeur doit informer un salarié ayant un problème de rendement non seulement de ses attentes, mais aussi des conséquences de son omission d'y satisfaire même si, à elle seule, cette omission ne sera pas déterminante pour conclure que la décision de procéder au renvoi est déraisonnable. En l'espèce, l'employeur aurait dû faire connaître à la plaignante le niveau de rendement requis (planification et organisation du travail ainsi que gestion des priorités), l'informer que son rendement était insatisfaisant et prendre les moyens pour lui assurer une véritable chance d'atteindre les objectifs fixés. Il ne l'a pas fait et n'a pas fait non plus d'évaluation officielle du rendement de la plaignante. On ne peut donc considérer qu'elle a été traitée équitablement. Ainsi, malgré sa bonne foi en prenant des mesures qu'il croyait appropriées, l'employeur n'a pas accordé à la plaignante l'occasion d'améliorer son rendement. Le renvoi est donc une mesure administrative déraisonnable, qui doit être annulée.
Syndicat des employés de soutien de Charlevoix et Commission scolaire de Charlevoix (Odette Lafrance), SOQUIJ AZ-50399777
Manquement à un règlement d’entreprise
Même si le plaignant – un technicien de laboratoire – a contrevenu à une directive de l'employeur en fumant dans un endroit où cela était interdit en raison du danger que représente la poussière de farine, une matière hautement explosive, une suspension est substituée au congédiement; le Code canadien du travail accorde un tel pouvoir à l'arbitre en présence de facteurs atténuants et, en l'espèce, il ne s'agissait pas d'un problème récurrent et le plaignant avait un dossier disciplinaire vierge.
Le plaignant était technicien en laboratoire dans une minoterie, soit un établissement où l'on trouve de la poussière de farine, hautement explosive. Le 12 octobre 2007, l'employeur l'a congédié, lui reprochant d'avoir fumé dans un endroit où cela était interdit. Le syndicat soutient que l'arbitre doit vérifier si la sanction était appropriée, juste et raisonnable, malgré la politique claire de tolérance zéro de l'employeur. Il invoque plusieurs facteurs atténuants. L'employeur allègue que sa politique est raisonnable, compte tenu des dangers présents dans le milieu de travail.
Décision
En vertu de ses droits de direction prévus à l'article 2.01 de la convention collective, l'employeur peut adopter une politique prévoyant trois catégories d'infractions pour lesquelles un traitement différent existe. Le fait de fumer constitue une infraction grave entraînant un congédiement automatique. En l'espèce, cette politique est connue de tous. Ainsi, plusieurs affiches et pictogrammes d'interdiction de fumer sont apposés dans l'usine. De plus, des informations et une formation avaient été données au plaignant. D'autre part, les dangers d'explosion étaient présents à l'endroit où ce dernier fumait. Le plaignant a donc commis une faute très grave, qui permet d'écarter la règle de la progression des sanctions. Par ailleurs, selon la majorité des décisions arbitrales, le congédiement constitue la mesure appropriée dans le contexte dangereux d'une minoterie, puisque le fait de fumer met en danger la vie de plusieurs personnes. Cependant, les salariés en cause avaient agi de façon délibérée, répétée et inconsciente. En l'espèce, compte tenu des pouvoirs conférés à l'arbitre par l'article 60 (2) du Code canadien du travail, une peine moins sévère et pouvant être juste et raisonnable est substituée au congédiement. Les facteurs atténuants suivants militent en faveur d'une modification de la sanction imposée : l'incident est survenu à l'occasion d'une altercation très éprouvante avec un chauffeur d'un client de l'entreprise; le geste du plaignant était isolé et son attitude n'était pas une attitude de défi; il avait quatre ans d'ancienneté, son dossier disciplinaire était vierge et il était apprécié de ses supérieurs; enfin, il a admis sa faute, a présenté des regrets et a compris la gravité de son geste. Le lien de confiance n'est pas complètement rompu. Cependant, la sanction doit avoir un aspect dissuasif à l'égard des employés. En conséquence, le congédiement est annulé et une suspension sans rémunération y est substituée jusqu'à la date de la présente sentence.
Syndicat national des employés de la Minoterie Ogilvie ltée et ADM Milling Co. Montréal (Québec), (Claude Lessard), SOQUIJ AZ-50509771
Le nouveau règlement de l'employeur interdisant de fumer « sur le temps de travail » à l'extérieur de l'usine sauf « pendant les pauses », alors que l'ancien n'interdisait de fumer qu'à l'intérieur, est valide et est justifié pour combattre l'absentéisme; de plus, il est raisonnable puisque les employés ont une obligation d'exécution diligente de leur contrat de travail.
Le 17 avril 2007, l'employeur a modifié son règlement antitabac. Celui-ci prévoit qu'il est désormais interdit de fumer en tout temps, sauf durant les pauses, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. De 1998 à 2007, le règlement n'interdisait de fumer qu'à l'intérieur. Il a été modifié parce que l'employeur estimait que certains employés trouvaient toutes sortes de raison pour sortir dans la cour et aller fumer, occasionnant des retards et une baisse de productivité. Le jour de l'adoption du règlement, l'employeur a tenu une réunion afin d'expliquer la nouvelle politique antitabac aux salariés. Au cours de cette réunion, le plaignant a annoncé qu'il ne respecterait pas le nouveau règlement. Le directeur des ressources humaines, qui présidait la réunion, lui a sur-le-champ remis un avertissement verbal. Deux heures plus tard, le plaignant a été surpris à fumer alors qu'il n'était pas en pause. Le lendemain matin, il a de nouveau fumé durant les heures de travail et a été aperçu par son supérieur. Estimant qu'il s'agissait de la troisième infraction du plaignant à l'encontre du règlement antitabac, l'employeur lui a imposé la sanction prévue, soit une suspension d’une journée. Le syndicat a déposé un grief contestant la validité du nouveau règlement, qu'il juge déraisonnable, arbitraire, abusif et discriminatoire alors que le précédent était conforme à la Loi sur le tabac. D'autre part, le plaignant conteste sa suspension.
Décision
Le droit de l'employeur d'élaborer un règlement lui permettant de mieux gérer son entreprise est reconnu. La jurisprudence a énoncé des critères permettant d'évaluer la validité d'un règlement. En l'espèce, la règle établie n'est pas en contradiction avec la convention collective et elle est claire et non équivoque. Le règlement a été porté à la connaissance des employés avant sa mise en vigueur et il a fait l'objet de discussions entre les parties. Les salariés ont été avisés que le non-respect de la règle pouvait mener à leur renvoi et la règle a été appliquée de manière uniforme dès son entrée en vigueur. Le règlement, pour être valide, doit de plus être raisonnable. Afin de respecter ce critère, le règlement doit être d'application générale. C'est le cas en l'espèce alors que tous les employés y sont soumis, y compris les cadres. Le règlement doit aussi être fondé sur de justes motifs. Or, l'employeur voulait réduire les pertes de temps et traiter tous ses employés sur un pied d'égalité : ceux qui travaillent à l'intérieur de l'usine comme ceux qui travaillent à l'extérieur. Le règlement respecte donc tous les critères et est déclaré valide. Quant au grief individuel, l'avertissement verbal reçu par le plaignant lui a été signifié avant même qu'il n'enfreigne le règlement. Sa première infraction est survenue deux heures après la réunion. L'infraction qui lui a valu une suspension était ainsi la première récidive et non la seconde. Il y a donc lieu d'annuler la suspension et de lui substituer un avertissement écrit.
Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada, section locale 1983 (TCA-Canada) et Lar Machinerie inc. (grief syndical et Dany Duchesne), SOQUIJ AZ-50510571
Le plaignant – un opérateur de chariot élévateur – a agi de façon téméraire et irréfléchie en soulevant le chariot embourbé d'un collègue alors que celui-ci était à bord, ce qui aurait pu provoquer un renversement; une suspension est cependant substituée au congédiement puisqu'il a reconnu immédiatement sa faute et que l'employeur, qui a les mêmes responsabilités, applique les règles de façon inégale et incohérente.
Le plaignant, un opérateur de chariot élévateur détenant cinq années d'ancienneté, a soulevé avec sa chargeuse un chariot qui était embourbé et à bord duquel se trouvait un collègue. Il les a promenés sur une certaine distance dans la cour pour ensuite les redéposer au point de départ.
Décision
Les gestes du plaignant constituent une faute. Toutefois, comme il est mentionné dans McKinley c. BC Tel (C.S. Can., 2001-06-28), 2001 CSC 38, SOQUIJ AZ-50098273, J.E. 2001-1327, D.T.E. 2001T-666, [2001] 2 R.C.S. 161, il n'y a pas d'automatisme à l'égard de certains comportements ou de certaines fautes, même graves. Il appartient au décideur d'analyser l'ensemble des circonstances afin de déterminer si l'inconduite justifie le congédiement. En l'espèce, le plaignant n'a pas agi avec une intention évidente de causer un préjudice. Cependant, ses agissements téméraires et irréfléchis auraient pu entraîner des conséquences sérieuses. En effet, le chariot aurait pu se renverser et son collègue aurait pu se blesser. Toutefois, le plaignant a reconnu sa faute dès sa rencontre avec l'employeur et il n'a pas cherché à cacher les faits. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'il a fait fi des procédures usuelles ainsi que de plusieurs règles élémentaires en matière de santé et sécurité, qui sont d'ailleurs reconnues par la convention collective et des dispositions d'ordre public. Quant à l'employeur, il a les mêmes responsabilités à cet égard et la pratique établie dans l'entreprise doit inciter les salariés au respect des règles de santé et de sécurité et mettre l'accent sur l'importance de protéger l'intégrité d'autrui. Or, il ressort de la preuve que l'employeur applique ces règles de façon inégale et incohérente. Notamment, les pratiques pour dégager les chariots élévateurs ou les chargeuses ne sont pas claires et suscitent des questions. Le signataire de la lettre de congédiement a lui-même enfreint à quelques reprises les règles alors qu'il manœuvrait une chargeuse semblable à celle du plaignant en faisant monter des employés sur les marches pour les soulever. Un autre événement que l'employeur a qualifié d'aussi grave que celui impliquant le plaignant est survenu lorsque deux salariés ont manœuvré un chariot élévateur et un monte-charge à ciseaux alors qu'ils n'étaient pas qualifiés pour le faire. Or, dans ce cas, aucune mesure n'a été prise à l’endroit de ces employés ou du contremaître, qui avait donné son accord. Ainsi, l'employeur peut difficilement fonder le congédiement du plaignant sur le respect strict des règles de santé et de sécurité, ce qui a pour effet de diminuer la gravité de sa faute. Par ailleurs, d'autres facteurs atténuants doivent être pris en considération, tels le dossier disciplinaire vierge du plaignant, ses années d'ancienneté, les circonstances entourant la faute et l'absence de préjudice ou de conséquences graves, de sorte qu'il n'y a pas eu rupture du lien de confiance. La décision de l'employeur est excessive et arbitraire; la règle de la progression des sanctions aurait dû être appliquée. Or, dans un tel cas, les tribunaux annulent habituellement le congédiement et y substituent une mesure disciplinaire plus appropriée. Toutefois, l'intensité de cette progression doit aussi être mesurée en fonction de l'écart de conduite du salarié et de son intention de se corriger. En l'espèce, d'autres incidents mettant en cause le plaignant montrent un certain laisser-aller en ce qui a trait aux règles de sécurité. Ainsi, une suspension de quinze mois est substituée au congédiement afin d'inciter le plaignant à corriger son comportement.
Syndicat des travailleuses et travailleurs de Planchers Husky (STTPH - CSN) et Planchers Husky Flooring, division de la Compagnie Commonwealth Plywood ltée (Christian Charron), SOQUIJ AZ-50492661
Étant donné que l'employeur a faussement déclaré que sa politique antitabac interdisant de fumer à l'extérieur des bâtiments était fondée sur la Loi sur le tabac, la sanction imposée au plaignant pour y avoir contrevenu est injuste et déraisonnable; une suspension de sept jours est substituée à celle d’un mois.
Le plaignant occupe des fonctions d'opérateur dans une usine de fabrication de moulures et autres composantes en bois. Il a été suspendu pour avoir fumé des cigarettes, le 14 et le 18 juin 2007, dans la cour extérieure de l'usine, contrevenant à la politique de l'employeur à cet effet. Ce dernier affirme qu'il est soumis à des obligations précises et contraignantes, comme celle de respecter les normes imposées par les assureurs, d'assurer la santé et la sécurité de ses employés et de respecter la Loi sur le tabac. Le syndicat fait valoir que le plaignant a admis les faits reprochés, mais que la sanction imposée est injuste et abusive, puisque les endroits où le plaignant a été surpris en train de fumer ne sont pas aussi dangereux que l'employeur le prétend, que ce dernier n'a pas respecté le principe de la progression des sanctions, qu'il avait l'obligation de faire connaître les tenants et aboutissants de sa politique antitabac, qu'il n'a pas agi équitablement dans l'imposition de la sanction et que les événements du 14 juin auraient dû être sanctionnés plus rapidement.
Décision
L'employeur n'a pas respecté la règle de la progression des sanctions ni la convention collective, qui reconnaît explicitement ce principe. Il aurait dû procéder à l'évaluation de la sanction la moins contraignante, compte tenu du contexte, et se demander ensuite si les éléments aggravants justifiaient une mesure plus sévère. On ne peut cependant lui reprocher d'avoir imposé une seule sanction pour les deux événements: les faits sont survenus dans un délai rapproché et la convention collective prévoit un délai de dix jours pour agir. Par ailleurs, la politique de l'employeur, qui est basée sur la Loi sur le tabac – laquelle lui impose des obligations et des pénalités en cas de non-respect –, ne peut être retenue comme facteur aggravant. En effet, cette Loi n'oblige pas l'employeur à interdire la consommation de tabac à l'extérieur de ses bâtiments. Ainsi, la politique affichée par l'employeur est inexacte, car il est faux de prétendre que, « en conformité avec la loi sur le tabac », il est interdit de fumer sur les terrains de l'entreprise. De plus, celui-ci n'avait pas l'obligation de pratiquer une politique de « tolérance zéro ». Cela ne signifie pas que l'employeur ne peut interdire l'usage du tabac à l'extérieur de ses bâtiments mais, lorsqu'il le fait, il doit motiver clairement cette politique et les employés doivent en être informés. Quant à l'obligation de l'employeur de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, il devait démontrer un lien rationnel et raisonnable entre sa politique et les risques à ce égard. Or, bien qu'il ait allégué qu'il y avait eu par le passé deux incendies majeurs, il n'a pas fait la preuve que ceux-ci avaient été causés par une cigarette ni que le feu avait débuté à l'extérieur. De plus, avant l'adoption de la politique, il faisait preuve d'une certaine tolérance puisqu'il permettait aux employés de fumer dans le stationnement. L'employeur ne peut pas non plus invoquer les normes de ses assureurs, étant donné que la personne qui a joué un rôle important dans l'imposition de la sanction du plaignant n'avait pas connaissance du contrat d'assurance. Enfin, il ne peut avoir recours à sa responsabilité pénale pour expliquer son geste, car il n'en a aucune en ce qui concerne l'extérieur des bâtiments. À titre de facteurs aggravants, le Tribunal retient le risque de danger en raison de l'environnement général et de la nature des activités de l'employeur. Toutefois, ce facteur est retenu avec réserve, étant donné que celui-ci n'en a pas fait une preuve exhaustive. Le fait que le plaignant avait été avisé qu'il était interdit de fumer est également retenu avec réserve vu l'information erronée transmise par l'employeur. Même s'il savait qu'il s'exposait à une sanction disciplinaire, deux autres employés ont reçu des sanctions nettement inférieures pour des incidents de même nature et ce facteur doit être pris en considération. L'insouciance n'est pas retenue : le plaignant a réduit les risques d'incendie en fumant, le 14 juin, sur un sol cimenté et entouré de terre battue et, le 18 juin, sur une grille d'égout. Comme facteurs atténuants, le Tribunal retient le dossier disciplinaire vierge du plaignant, son ancienneté de quatorze ans, l'obéissance immédiate lorsqu'il a été surpris, l'absence de sanction automatique, l'erreur de l'employeur dans sa politique et, surtout, les sanctions moindres imposées à d'autres employés pour le même comportement. Toutefois, la sanction doit refléter le fait que les deux infractions ont été commises pendant deux jours rapprochés de travail, qu'elles l'ont été durant les heures de travail et qu'elles constituent du vol de temps. Ainsi, la suspension d’un mois est injuste et déraisonnable; une suspension de sept jours sans traitement lui est substituée.
Syndicat national des employés du bois ouvré de Warwick (CSD) et Roland Boulanger et Cie ltée (Paulin Vigneault), SOQUIJ AZ-50475333
L'employeur – un centre de la petite enfance – pouvait valablement adopter, dans la mesure où il le jugeait nécessaire pour répondre à ses obligations éducatives, un code d'éthique et un code vestimentaire obligeant les éducatrices à couvrir leurs tatouages en milieu de travail; il ne pouvait cependant remettre un avertissement écrit avant que les employés en aient connaissance.
La plaignante est éducatrice dans un centre de la petite enfance. L'employeur lui a remis un avertissement écrit lui intimant de couvrir le tatouage qu'elle porte à l'épaule d'un vêtement adéquat alors qu'elle est au travail. Le syndicat conteste cet avertissement ainsi que la décision de l'employeur d'obliger la plaignante à couvrir son tatouage.
Décision
Le libellé des griefs permet au Tribunal de se prononcer sur la validité de la politique de l'employeur relative au tatouage. Par l’entremise de son conseil d'administration, ce dernier a adopté un code d'éthique et un code vestimentaire qui contiennent des dispositions obligeant les salariés à couvrir leurs tatouages en milieu de travail. Il pouvait adopter ces dispositions dans la mesure où il les jugeait utiles ou nécessaires pour répondre à ses obligations éducatives, lesquelles sont décrites dans le programme du ministère de la Famille et de l'Enfance ainsi que dans les règles de vie de son contrat de services avec les parents. Le Tribunal n'a pas le pouvoir de déroger à cette politique, adoptée de façon unanime par les parents et les éducatrices qui siègent au conseil d'administration. Si elle comporte une limite à la liberté d'expression, celle-ci paraît raisonnable compte tenu de la mission éducative de l'employeur. La mesure retenue n'est pas discriminatoire, car elle est applicable à l'ensemble des salariés. De plus, elle n'est pas abusive ni imposée de mauvaise foi. Le grief contestant la décision de l'employeur d'obliger la plaignante à couvrir son tatouage est donc rejeté. Quant à celui contestant l'avertissement écrit, il est accueilli. En effet, ce n'est qu'après la réception de cet avertissement que la plaignante a eu connaissance de la politique. Le Tribunal ordonne à l'employeur de retirer cet avertissement du dossier de la plaignante.
Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance du Saguenay—Lac-St-Jean — FSSS-CSN et Centre de la petite enfance La Pirouette (Nadine Bélisle), SOQUIJ AZ-50459577
Le congédiement d'une agente d'intervention sociale dans un CLSC pour avoir falsifié des ordonnances médicales afin d'obtenir illégalement des analgésiques est remplacé par une suspension sans solde; compte tenu de l'existence d'un handicap, soit la dépendance au Fiorinal, l'employeur avait une obligation d'accommodement, qu'il n'a pas respectée.
La plaignante, une agente d'intervention sociale dans un CLSC, a été congédiée pour avoir falsifié des ordonnances médicales afin d'obtenir illégalement des médicaments, soit du Fiorinal. L'employeur soutient que les agissements de la plaignante s'assimilent à de la fraude et constituent une faute grave justifiant son renvoi. Pour sa part, le syndicat fait valoir que cette dernière souffrait d'une dépendance aux médicaments, soit une maladie qui exigeait des accommodements. L'employeur affirme qu'il ignorait la dépendance de la plaignante et qu'il n'avait donc aucune obligation d'accommodement à son égard.
Décision
La preuve démontre que la plaignante a utilisé de fausses ordonnances médicales afin d'obtenir du Fiorinal, un analgésique. Or, le dossier médical que l'employeur avait en sa possession au moment du congédiement établissait un problème de consommation d'analgésiques. L'ensemble des circonstances et le dossier médical de la plaignante permettent de conclure que celle-ci souffre d'un problème de dépendance aux médicaments. D'ailleurs, la preuve médicale établit que la consommation de Fiorinal présente un risque de contracter une pharmacodépendance. Or, la pharmacodépendance constitue une maladie au même titre que l'alcoolisme. L'employeur avait donc une obligation d'accommodement à l'égard de la plaignante. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et du fait que celle-ci a néanmoins commis un manquement grave en utilisant de fausses ordonnances médicales, le Tribunal substitue au congédiement une suspension sans solde de seize mois se terminant le 18 janvier 2008, date à laquelle la preuve médicale établit que la plaignante ne souffrait plus d'une dépendance au Fiorinal.
Centre de santé et de services sociaux de Québec – Nord et Syndicat des professionnels de CLSC – CHSLD de Québec et de Chaudière-Appalaches (CSN), (grief syndical), SOQUIJ AZ-50513580
Malgré le vol d'informations concernant des employés d'une unité non syndiquée – nom et adresse d'employés – alors qu'il était président du syndicat, une suspension de quatre mois est substituée au congédiement du salarié; la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé n'interdit pas à un employeur de communiquer de telles listes et il ressort de la jurisprudence que les cas où l'on a confirmé le congédiement mettaient en cause des violations graves de l'obligation de loyauté.
Le plaignant, qui compte trente ans d'ancienneté dans le secteur bancaire, dont douze au service de l'employeur, est directeur de compte à la succursale de Valleyfield, un poste de confiance assujetti à un devoir de confidentialité. Il est également président du syndicat. Le 18 avril 2007, il s'est rendu à la succursale de Châteauguay pour y rencontrer la directrice. Un messager lui a remis par erreur un sac contenant les paies des employés. Après la rencontre, le plaignant a décidé de prendre avec lui les paies des employés de la succursale où il travaille. Avant de partir, il a photocopié les fenêtres des enveloppes des employés non syndiqués des succursales de Châteauguay et de Saint-Rémi, afin d'obtenir leurs coordonnées. Il a été aperçu par une employée non syndiquée. Par la suite, il a remis la liste des adresses au syndicat, qui a convoqué les employés non syndiqués à une réunion d'information syndicale le 9 mai. Une vingtaine d'employés s'y sont présentés. Lors de cette réunion, l'employée qui avait vu le plaignant effectuer les photocopies lui a demandé d'informer les employés de la manière dont il avait obtenu leurs adresses; aucun ne s'est plaint du procédé. Le 25 avril précédent, cette employée avait informé deux cadres des gestes du plaignant et, le lendemain, ceux-ci en avaient avisé la directrice. Le 24 mai, cette dernière a rencontré le plaignant à ce sujet et, le jour suivant, elle l'a congédié au motif qu'il s'était approprié des informations illégalement et avec préméditation.
Décision
Le plaignant reconnaît avoir commis une faute en photocopiant la fenêtre des enveloppes de paie et en communiquant les adresses ainsi obtenues au syndicat. Toutefois, le fait de recevoir les paies des mains du messager et de prendre avec lui celles des employés de sa succursale ne constitue pas une faute; la directrice et l'agente de l'accueil l'ont vu agir sans protester. De plus, même si le transport des chèques de paie était contraire aux pratiques de l'employeur, le plaignant n'a pas outrepassé le degré de confiance associé à sa fonction. Il s'agit d'un employé cadre auquel incombaient de lourdes responsabilités et il avait la confiance de tous; ce geste ne lui aurait jamais été reproché s'il s'était contenté de transporter les paies. Or, le nom des employés non syndiqués et leur adresse constituent des renseignements personnels protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et le plaignant ne pouvait les communiquer au syndicat. En outre, il est soumis à un engagement de confidentialité et à un code de déontologie. Il aurait dû savoir qu'il ne pouvait transmettre cette information à un tiers sans l'accord de l'employeur, et ce, même s'il n'avait pas reçu de formation particulière à cet égard. Cependant, la faute du plaignant ne constitue pas une cause juste et suffisante de congédiement. La préméditation n'a pas été prouvée. Le plaignant ne pouvait prévoir que le messager lui remettrait le sac en question. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il est retourné à son bureau avec les photocopies et qu'il a disposé de plusieurs jours avant de remettre l'information au syndicat, qu'il a agi de façon délibérée. De plus, la directrice qui l'a congédié a été induite en erreur. Lors de sa rencontre avec le plaignant, elle a cru qu'il niait avoir photocopié les enveloppes. Or, il n'a pas répondu verbalement à cette question, mais il a acquiescé par un signe de la tête que la directrice n'a pas vu. Les autres personnes présentes à cette rencontre ont toutefois été témoins du geste d'acquiescement. La directrice a d'ailleurs admis que, si le plaignant avait avoué avoir photocopié les adresses, il n'y aurait pas eu rupture du lien de confiance. La nature des informations divulguées par le plaignant constitue aussi un facteur atténuant. La loi sur la protection des renseignements personnels protège moins les listes de noms et d'adresses que d'autres renseignements. En outre, le plaignant avait déjà réussi à obtenir bon nombre d'adresses, de manière légale, en consultant le bottin téléphonique. Le fait qu'il n'ait causé aucun préjudice joue aussi en sa faveur. Aucune des personnes dont il a photocopié l'adresse ne s'est plainte. Au contraire, certains employés n'ayant pas été convoqués à la réunion d'information syndicale auraient aimé y être invités. De plus, l'employeur n'a pas subi de préjudice. Par ailleurs, on ne lui a pas reproché d'avoir manqué à ses obligations de confidentialité et le fait d'inviter des employés à une réunion d'information syndicale ne peut être préjudiciable dans un système où le droit d'association est protégé par les chartes. Quant aux facteurs aggravants et atténuants, le dossier disciplinaire du plaignant était vierge et il était considéré comme un employé exemplaire. Dans sa carrière, il n'a jamais failli à son obligation de confidentialité et une récidive de sa part est hautement improbable. Le lien de confiance entre l'employeur et le plaignant n'est donc pas rompu. Pour conclure à la rupture d'un tel lien, il ne suffit pas que le supérieur d'un employé affirme avoir perdu confiance en celui-ci, d'autant moins en l'espèce, alors que la rupture du lien de confiance a été causée par une erreur de la directrice d'une succursale. Il faut plutôt trancher objectivement, sur la base de la preuve, si le lien est rompu. Or, un employeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances n'aurait pas congédié le plaignant. Une suspension de quatre mois est substituée au congédiement.
Centre financier aux entreprises Desjardins Grandes-Seigneuries—Vallée-des-Tisserands et Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 575 (Pierre Laflèche), SOQUIJ AZ-50507770
Malgré le manquement à une politique claire relative au vol de biens appartenant à l'employeur, l'arbitre tient compte, notamment, du fait que le plaignant – un magasinier – a avoué son erreur, qu'il désire travailler pour la compagnie jusqu'à sa retraite, qu'il n'y a pas véritablement de surveillance, que le syndicat recommande le déplacement à un autre poste qui serait moins à risque et qu'il sera certainement reconnu coupable de tentative de vol par la Cour du Québec; une suspension de quatre mois est substituée au congédiement.
Le plaignant travaille depuis dix-huit ans dans une entreprise en région éloignée; il est magasinier depuis huit ans. Le 13 janvier 2008, il a tenté de voler divers articles, d'une valeur d'environ 100 $, se trouvant dans l'entrepôt où il travaillait. Ils ont été découverts dans son sac personnel lors d'une fouille effectuée à la sortie du travail. Des accusations criminelles de tentative de vol ont été déposées contre lui et, le 15 janvier suivant, il a été suspendu sans solde aux fins d'une enquête. Le 14 février, il a été congédié. Le plaignant reconnaît qu'une politique prohibe le vol, qu'il y a eu une note de service à ce sujet et qu'il a pu commettre d'autres vols auparavant. Le syndicat prétend que le congédiement est une peine trop sévère et demande qu'une seconde chance soit accordée au plaignant. Il serait d'accord avec une suspension de quelques mois et une rétrogradation dans un poste où celui-ci serait moins à risque. De son côté, l'employeur soutient que le congédiement est justifié, car le vol constitue une faute grave, d'autant plus qu'il est en droit d'exiger une loyauté et une honnêteté complètes étant donné que le plaignant avait un accès facile à toutes les pièces en stock. De plus, il ne s'agissait pas d'un geste isolé.
Décision
Il ne faut pas banaliser le vol ni considérer cet acte grave comme sans importance, mais il faut tenir compte de l'ensemble de la preuve. En l'espèce, le congédiement est une peine trop sévère, car le plaignant perdrait un emploi très rémunérateur pour un vol d'objets valant environ 100 $. De plus, celui-ci possède dix-huit années d'ancienneté, il n'a pas vraiment de dossier disciplinaire, il a admis sa faute à la première occasion et il la regrette. D'autre part, la compagnie n'est pas victime d'une épidémie de vols, il n'y a pas de véritable surveillance de la part des contremaîtres et la seule fouille a été celle du 13 janvier. Par ailleurs, il faut également prendre en considération le fait que le plaignant sera très certainement reconnu coupable par la Cour du Québec, qu'il recevra sans doute un sursis de sentence et qu'une amende de quelques centaines de dollars lui sera imposée. Les tribunaux de droit commun rendent des peines relativement clémentes dans des cas de vols de peu d'importance. En l'espèce, une suspension sans solde, mais sans perte d'ancienneté, jusqu'au 20 mai 2008 est imposée. Le Tribunal ne peut cependant pas faire perdre le poste de magasinier au plaignant puisqu'il s'agit d'une prérogative de l'employeur. Toutefois, si ce dernier désire agir ainsi et muter le plaignant à un autre poste, le syndicat ne pourra pas contester cette décision, car il a accepté d'avance cette mesure.
Métallurgistes unis d'Amérique — section locale 5778 et Compagnie minière Québec Cartier (Tony Dubé), SOQUIJ AZ-50495100
En matière de congédiement pour un motif de nature criminelle, le critère de la prépondérance de la preuve suffit, mais la qualité de preuve requise est plus exigeante; l'employeur doit donc présenter une preuve particulièrement convaincante et, si celle-ci est circonstancielle, elle doit reposer sur des présomptions de faits qui sont graves, précises et concordantes.
Le plaignant occupe des fonctions de préposé à l'entretien. À la suite d'un vol dans l'un des édifices appartenant à l'employeur, on a trouvé ses empreintes digitales sur une boîte contenant un écran d'ordinateur qui avait été volé. Il a été convoqué par l'employeur à une rencontre, au cours de laquelle il a affirmé : qu'il était allé dans l'édifice pour voir ses amis; qu'il aidait de temps à autre à l'entretien de cet édifice; que, s'il s'était trouvé dans les locaux en question, c'était pour en faire l'entretien; et qu'il ne se souvenait pas précisément de la boîte, mais qu'il avait dû la déplacer pour nettoyer. L'employeur a alors procédé au congédiement du plaignant. Selon l'employeur, le critère d'appréciation requis est celui de la prépondérance de preuve, alors que le syndicat soutient que la prépondérance des probabilités doit être particulièrement convaincante. Le syndicat demande que des dommages moraux soient accordés vu le traitement abusif dont le plaignant a été victime.
Décision
En matière de congédiement pour un motif de nature criminelle, le critère d'appréciation pertinent est celui de la prépondérance de la preuve. Toutefois, une simple possibilité ne suffit pas: l'employeur, qui a le fardeau de la preuve, doit présenter une preuve particulièrement convaincante dont le critère de qualité est plus exigeant. En l'espèce, la preuve de l'employeur est circonstancielle et devra reposer sur des présomptions de faits qui sont graves, précises et concordantes. Comme premier fait, l'employeur estime que l'explication fournie par le plaignant quant à la présence de ses empreintes digitales sur la boîte qui contenait l'écran d'ordinateur volé était vague et imprécise et, ce faisant, rendait probable la présomption qu'il avait volé l'écran. Or, le plaignant n'a pas à prouver son innocence; il doit plutôt fournir une explication qui pourrait, le cas échéant, atténuer les conséquences tirées de la preuve circonstancielle établie par l'employeur et créer un doute. En effet, la jurisprudence a établi que, si une autre explication ou conclusion que celle de l'employeur est plausible suivant une preuve prépondérante, il faut conclure que celle de ce dernier n'est pas prépondérante. Le deuxième fait retenu par l'employeur est la présence des empreintes digitales. Il est indéniable que le plaignant a manipulé la boîte. Toutefois, on ne peut savoir s'il l'a manipulée pour voler l'écran ou s'il l'a fait dans le contexte de son travail. Le troisième fait retenu est la présence du plaignant dans un édifice où il n'avait pas le droit d'aller selon la politique de déplacement des employés. Or, le témoignage du représentant de l'employeur n'est pas crédible et on ne peut déduire que cette politique était respectée. Au contraire, la preuve démontre qu'il y avait une pratique d'entraide entre les employés d'entretien. Finalement, l'employeur a considéré que le positionnement des empreintes digitales ne correspondait pas à la version du plaignant et que, si la boîte avait été déplacée pour nettoyer le plancher, il aurait utilisé la poignée. Cette présomption implique que la boîte avait été complètement fermée avant d'être déposée au sol. Ce fait n'est aucunement concluant et n'est pas assez précis pour présumer que le positionnement des empreintes démontre que la boîte avait été ouverte dans le but d'en voler le contenu. Étant donné l'absence de preuve de la présence du plaignant dans les locaux où le vol a eu lieu, le Tribunal conclut que, dans son ensemble, la preuve circonstancielle n'est pas concordante. La version fournie par le plaignant contredit la présomption de l'employeur et suffit à créer un doute qui entache la qualité de la preuve présentée. L'employeur a souligné qu'il avait été surpris d'entendre le plaignant décrire l'objet volé lors de la rencontre alors que personne n'en avait fait mention. Or, peu de temps auparavant, le plaignant avait été accusé au criminel et il connaissait l'objet de son accusation. Ainsi, le congédiement est annulé et la réintégration du plaignant est ordonnée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder de dommages à ce dernier. En effet, l'employeur ne voulait pas nuire à l'enquête policière et c'est ce qui a justifié son intervention tardive. De plus, on ne peut lui reprocher d'avoir retenu la version de son représentant lorsqu'il a pris sa décision.
Union des employés de service, section locale 800 (FTQ) et Université McGill (Adamo D'Ambrosio), SOQUIJ AZ-50486612
La toxicomanie du plaignant – un journalier qui s'est approprié des métaux récupérés et neufs appartenant à l'employeur – doit être prise en considération afin de diminuer la sanction qui lui a été imposée; une suspension de dix mois est substituée au congédiement.
Le plaignant occupe des fonctions de journalier au sein d'une entreprise municipale. Il a été suspendu aux fins d'une enquête et congédié par la suite pour avoir volé à trois reprises du cuivre neuf et à plusieurs reprises du cuivre usagé. Il a admis sa faute et explique son comportement par sa toxicomanie. Il allègue que le produit de la vente des biens volés ou récupérés a servi à payer la cocaïne qu'il consommait depuis trois ans.
Décision
Le vol est un manquement très grave, mais la jurisprudence a évolué et accorde maintenant une importance aux circonstances particulières de l'acte ainsi qu'aux caractéristiques personnelles du salarié fautif. Le congédiement n'est donc plus la mesure qui sanctionne automatiquement une faute de cette nature. En l'espèce, le plaignant a une ancienneté de treize ans et est âgé de trente-sept ans. Son dossier disciplinaire contient une réprimande pour avoir récupéré des métaux appartenant à l'employeur et une suspension pour ne pas avoir respecté une directive. Comme facteur atténuant, il a admis sa faute et a invoqué son problème de toxicomanie tant lors de la rencontre en présence du conseiller syndical, du directeur général et de l'inspecteur municipal qu'à l'occasion de celle avec le conseil municipal avant son congédiement. On doit également tenir compte du fait qu'il a réitéré ses aveux devant le Tribunal, puisqu'on pourrait difficilement conclure que l'employeur pourrait lui faire de nouveau confiance s'il avait menti ou n'avait pas été crédible. Son désir de s'amender et sa volonté de ne pas récidiver sont corroborés par la cure de désintoxication qu'il a volontairement suivie immédiatement après son congédiement et par son abstinence depuis ce temps. De plus, la toxicomanie peut être prise en considération afin de diminuer la sanction imposée. Conformément à la convention collective, il semble plus « juste » dans les circonstances d'accorder une dernière chance au plaignant pour lui permettre de continuer à se prendre en main. Toutefois, il devra fournir sa prestation de travail normale selon les directives de l'employeur, sans consommer ni être sous l'effet de la drogue; une suspension de dix mois est substituée au congédiement.
Syndicat des municipalités de la Côte-Nord (CSN) et Chute-aux-Outardes (Corporation municipale du Village de), (Daniel Girard), SOQUIJ AZ-50487168
COMMENT TROUVER LES DÉCISIONS MENTIONNÉES DANS CET ARTICLE?
- Accéder au site Internet Azimut de SOQUIJ
- Sélectionner la banque Juris.doc.
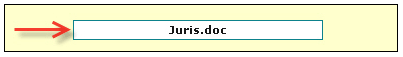 |
- Entrer votre code d'accès et votre mot de passe.
COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE?
Deux façons s'offrent à vous, d'abord :
- Chacune des décisions mentionnées dans cet article a une référence AZ
(par exemple AZ-50287651). Pour retrouver cette décision, il faut :
- accéder à l’écran Choix de banque de Juris.doc;
- utiliser la case de recherche par référence AZ;
- cliquer sur
.
- Pour effectuer une recherche portant sur le vol en milieu de travail, il faut :
- accéder à l’écran de recherche par Mots clés de la banque Juridictions en relations du travail;
- effectuer votre recherche à l’aide du Plan de classification annoté;
- éclater la rubrique Travail;
- ensuite, vous devez également éclater les sous-rubriques Grief et Mesure disciplinaire ou non disciplinaire;
- lancer la recherche en cliquant sur la sous-rubrique Formalités issues de la jurisprudence;
- pour compléter votre recherche, vous pouvez raffiner celle-ci à l’écran Mots clés en cliquant sur le bouton RAFFINER PAR MOTS CLÉS;
- exécuter la recherche à l’aide du bouton RECHERCHER.
Pour toute question relative à l'utilisation d'AZIMUT, Documentation juridique, communiquez avec le Service d'aide aux utilisateurs au 514 842-AIDE ou, sans frais, au 1 800 356-AIDE, de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi.
Monique Desrosiers, avocate, Coordonnatrice, Secteur droit du travail et droit social, Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
Source : VigieRT, numéro 31, octobre 2008.