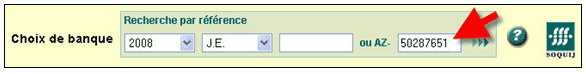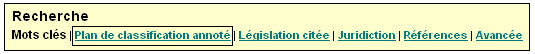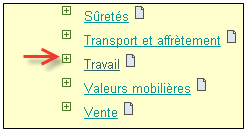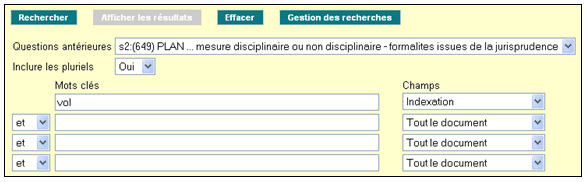La mesure imposée à un salarié peut être disciplinaire ou non disciplinaire. La qualification de la mesure revêt une importance capitale puisque les formalités applicables et la compétence de l'arbitre ne seront pas les mêmes.
Lorsqu'il impose une mesure « disciplinaire », le représentant de l'employeur doit respecter certains principes qui ont été établis par la jurisprudence arbitrale. Le principe fondamental est celui de la cause juste et suffisante, auquel se rattachent d'autres éléments à prendre en compte, entre autres les facteurs atténuants et aggravants.
Quand la mesure imposée est « non disciplinaire », c’est qu’elle résulte d’une situation pour laquelle la sanction est prévue à la convention collective, la plus fréquente étant l’absence de plus de trois jours sans aviser ou sans motif valable. Dans ce cas, l’arbitre ne pourra pas intervenir si toutes les conditions prévues sont rencontrées.
La mesure imposée par l’employeur sera « annulée », si les formalités issues de la convention collective ou de la jurisprudence ne sont pas respectées. Elle sera « confirmée » ou « modifiée » par l’arbitre qui prendra en compte, dans l’évaluation de la justesse de la mesure imposée, des facteurs aggravants et atténuants qui ont été développés par la jurisprudence.
Dans les textes qui suivent, ces règles sont illustrées en fonction des manquements du salarié que l’on retrouve le plus souvent et dans lesquels l’arbitre a confirmé la mesure imposée.
On note qu’une politique claire, portée à l’attention des salariés lors de l’embauche et largement diffusée par la suite est un facteur de succès.
Par ailleurs, en matière d’incapacité physique ou psychologique, les arbitres tiennent compte de l’obligation d’accommodement en fonction du critère de l’obligation de fournir une prestation normale de travail dans un avenir prévisible.
MENU
|
Absence du travail
La Ville était fondée à mettre fin à l'emploi d'un pompier à temps partiel en raison de son omission de participer à au moins « 50 % des séances d'entraînement annuelles »; le motif invoqué par le plaignant afin de justifier ses absences, soit ses obligations familiales, n'est pas retenu puisqu'il n'a pas respecté toutes les obligations énoncées au troisième alinéa de l'article 79.7 L.N.T.
Les trois plaignants, des pompiers travaillant à temps partiel, contestent la décision de l'employeur de mettre fin à leur emploi. L'employeur invoque l'application de la clause de perte d'emploi prévue à la convention collective, laquelle énonce que : « Un pompier perd son lien d'emploi [...] s'il ne participe pas à au moins 50 % des séances d'entraînement annuelles. » Il prétend que les pompiers doivent participer à au moins 50 % des heures d'entraînement et non à 50 % des séances. Le syndicat fait valoir que la résolution municipale prévoyant la perte d'emploi des trois plaignants est invalide puisqu'elle ne mentionne pas leur nom. Sur le fond, il prétend que deux des plaignants ont participé à au moins 50 % des séances puisqu'ils se sont présentés à quatre séances sur un total de sept. Quant au troisième plaignant, il n'a pu se présenter à la quatrième séance en raison d'obligations familiales. Il doit donc bénéficier de la protection prévue à l'article 79.7 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.).
Décision
L'employeur soutient qu'il a voulu protéger l'identité des pompiers en ne les nommant pas dans la résolution municipale. En dépit du fait que la résolution ne mentionne pas le nom des personnes visées par la mesure de fin d'emploi, les trois salariés visés ont connu, deux jours après l'adoption de la résolution, les motifs de leur congédiement et ont contesté la décision patronale en toute connaissance de cause. Aux fins du présent litige, il y a donc lieu de conclure que la résolution est valide; l'objection syndicale est rejetée.
Quant au fond, l'expression « 50 % des séances d'entraînement » fait référence à une participation à 50 % des séances. Lorsque les parties ont voulu calculer une mesure en heures, elles l'ont prévu de façon expresse à la convention collective. Le Tribunal retient donc la position syndicale, laquelle est plus conforme à l'interprétation restrictive que doit recevoir la clause de perte d'emploi. Par conséquent, les griefs des deux pompiers qui ont participé à quatre séances sur sept doivent être accueillis. Quant au troisième pompier, il a participé à trois séances, mais il invoque des obligations familiales afin de justifier son absence à la quatrième. En vertu de l'article 79.7 L.N.T., afin de motiver son absence du travail, le salarié doit remettre un avis préalable à l'employeur et il doit « prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé ». Or, le plaignant n'a pas démontré qu'il avait agi conformément à cet énoncé. Il ne peut donc bénéficier de la protection prévue à cet article. Son grief est rejeté.
Syndicat des pompières et pompiers du Québec, section locale Ste-Agathe-des-Monts et Ste-Agathe-des-Monts (Ville de…) (griefs individuels, Sylvain Tremblay et autres) SOQUIJ AZ-50504045
Le fait qu'une personne ait appelé l'employeur pour annoncer que le plaignant ne pouvait se présenter au travail parce qu'il était à l'hôpital n'est pas un avis conforme à ce qui est prévu à la clause de perte d'ancienneté; la personne ne s'est pas nommée, n'a pas indiqué le nom de l'hôpital ni n'a donné d'information sur la date de retour au travail alors que les faits postérieurs ont confirmé qu'il était plutôt incarcéré.
Le plaignant travaillait à titre de journalier. À compter du 31 octobre 2007, il ne s'est pas présenté au travail et n'a pas avisé l'employeur de son absence. Le lendemain, une personne inconnue a téléphoné à l'employeur pour l'informer que le plaignant était hospitalisé. Le 9 novembre, l'employeur a signifié à ce dernier sa fin d'emploi en application de la clause de la convention collective prévoyant la perte d'ancienneté après trois jours consécutifs d'absence sans autorisation ou sans aviser, sauf en cas de motif raisonnable d'absence. Le 12 novembre, le plaignant a informé l'employeur qu'il avait été emprisonné du 31 octobre au 10 novembre. Le syndicat prétend que l'emprisonnement constitue un motif raisonnable d'absence.
Décision
Le plaignant n'avait pas obtenu l'autorisation de ne pas se présenter au travail. De plus, l'appel effectué le 1er novembre par un inconnu ne constitue pas un avis valable au sens de la convention collective, car son contenu était faux. Enfin, tel que l'établit la jurisprudence, l'emprisonnement ne constitue pas une raison valable pour s'absenter du travail. Le grief est donc rejeté.
Syndicat des travailleuses et travailleurs d'abattoir de volaille de Saint-Jean-Baptiste (CSN) et Unidindon inc. (Jacques Blanchette), SOQUIJ AZ-50497116
La perte d'ancienneté et d'emploi du plaignant — un salarié à temps partiel pleine disponibilité — pour s'être absenté quatre jours sans autorisation ni justification au cours des six derniers mois est confirmée malgré l'erreur de l'employeur quant au nombre de ses heures programmées et de ses absences injustifiées; il était de la responsabilité du plaignant de faire les vérifications qui s'imposaient.
Le plaignant était un salarié à temps partiel à pleine disponibilité depuis un an et demi. Le 3 janvier 2005, alors qu'il était prévu qu'il travaille, il a avisé l'employeur qu'il ne pouvait se présenter parce qu'il se trouvait à l'extérieur de la ville. L'employeur lui a alors remis un avis écrit selon lequel son absence était considérée comme injustifiée. Une rencontre d'encadrement a eu lieu, et le plaignant n'aurait donné aucune explication supplémentaire. Le 6 mars, il a été de nouveau absent et n'a fourni aucune justification. Le 17 avril, il a téléphoné pour aviser qu'il serait absent puisque le sous-sol de sa maison était inondé. Une autre rencontre d'encadrement a été tenue, lors de laquelle il n'a fait aucun commentaire. Le 19 juin, il a appelé au travail pour s'enquérir du nombre d'absences injustifiées à son dossier. Son superviseur lui aurait dit qu'il en avait deux mais qu'il ne pouvait garantir la fiabilité de cette information, car son dossier n'était pas nécessairement à jour. Le plaignant s'est donc absenté. Se fondant sur la convention collective, l'employeur a mis fin à l'emploi de celui-ci avec perte d'ancienneté puisqu'il avait été absent quatre fois au cours des six derniers mois.
Décision
Pour chacune des quatre absences, le plaignant a avisé l'employeur, selon la procédure prévue, qu'il ne se présenterait pas au travail. Relativement à l'absence du 3 janvier 2005, il a déclaré à l'audience qu'il avait un rapport du Club automobile CAA attestant la panne de son automobile, mais qu'il n'avait pas jugé opportun de le remettre à l'employeur. Or, ses explications paraissent invraisemblables étant donné qu'il lui revenait de motiver son absence et qu'il a été convoqué à une rencontre dans le but de fournir des explications. L'argument voulant que l'employeur ne lui ait pas demandé de pièce justificative n'est pas retenu. C'était à lui de motiver son absence et il se devait de rapporter tous les faits et documents pertinents. Le syndicat a allégué que l'avis d'absence était nul au motif que l'employeur ne pouvait, selon la convention collective, inscrire à l'horaire un salarié à temps partiel pleine disponibilité pour 8 heures, mais devait le faire pour un minimum de 24 heures. Il ajoute qu'il s'agirait donc d'une absence sur disponibilité et non d'un jour programmé. Or, les huit heures qui ont été assignées au plaignant étaient planifiées et affichées comme telles au tableau. Par conséquent, l'on ne peut prétendre que ces heures constituaient des heures non planifiées et distribuées sur place ou par appel téléphonique comme le prévoit la convention collective. L'erreur dans le nombre d'heures prévues n'en change pas la nature. On doit respecter l'objectif poursuivi par la convention collective qui est de s'assurer de la présence des salariés lorsqu'il est prévu qu'ils travaillent. Quant à l'absence du 6 mars, le plaignant n'a fourni aucune explication et a admis son manquement. En ce qui a trait à celle du 17 avril, les détails et les explications qu'il a donnés au Tribunal paraissent cohérents et raisonnables. Toutefois, il aurait dû les fournir en temps opportun, particulièrement lors de la rencontre d'encadrement au cours de laquelle il devait convaincre l'employeur, et le Tribunal doit se placer à l'époque où ce dernier a pris sa décision. Il est vrai que le salarié n'a pas l'obligation de présenter un document pour motiver chacune de ses absences; cependant, comme le fardeau de la preuve lui incombe, il doit présenter la meilleure explication possible. Finalement, le plaignant allègue que son superviseur ne lui aurait pas donné le bon nombre de refus qu'il avait accumulés et qu'il l'aurait ainsi induit en erreur. Or, contrairement à la jurisprudence déposée selon laquelle l'on ne peut exiger d'un citoyen qu'il connaisse à fond ses obligations légales, le litige s'inscrit dans un contexte de droit du travail et, en l'espèce, il s'agit d'une erreur de fait et non de droit. Le plaignant a été négligent en ne vérifiant pas les avis écrits qu'il avait reçus. De plus, il avait affirmé savoir durant la dernière rencontre qu'il ne pouvait plus s'absenter pour les deux prochains mois. La perte d'ancienneté et d'emploi est confirmée.
Provigo Distribution inc. (Division Laval) et Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 (Karl Pépin), SOQUIJ AZ-50485753
Le plaignant n'a pas « fourni », selon les termes de la convention collective, une justification à son absence prolongée en transmettant un certificat médical dont le diagnostic avait été biffé par un membre du bureau syndical, et l'employeur n'avait pas l'obligation de faire des démarches auprès du plaignant afin d'obtenir l'original du certificat; le congédiement est confirmé.
Le plaignant occupait des fonctions d'opérateur et travaillait au sein de l'entreprise depuis environ 31 ans. Lorsque les opérateurs sont en nombre insuffisant pour assurer la bonne marche d'une équipe, ils sont affectés par l'employeur à la distribution. Le plaignant a reçu un avis verbal pour insubordination après avoir refusé de travailler à la distribution alors que l'employeur pouvait l'affecter à cette tâche et après avoir quitté le travail. Les semaines suivantes, il a travaillé à la distribution, mais se plaignait de la fumée dégagée par les machines. À son retour au travail après la semaine de fermeture de l'usine, en constatant qu'il devait travailler de nouveau à la distribution pour les semaines à venir, il aurait exprimé son désaccord avec agressivité et en alléguant qu'il ne respecterait pas cet horaire. Par la suite, il s'est présenté au travail sans que sa présence soit prévue à l'horaire et a demandé un congé sans solde de deux semaines qui ne lui a pas été accordé. Il a alors quitté le travail. L'employeur a tenté à plusieurs reprises de le joindre dans la semaine qui a suivi. Il lui a fait parvenir une lettre lui demandant de communiquer avec lui pour obtenir la raison de son absence. Le plaignant, qui aurait allégué pour la première fois des raisons médicales, a transmis un certificat médical à un membre du bureau syndical qui est responsable des assurances collectives chez l'employeur. Ce dernier a biffé le diagnostic sur le certificat, comme il avait l'habitude de le faire dans le traitement des demandes de prestations d'assurance, avant de le transmettre à l'employeur. Le plaignant a été congédié conformément à la convention collective, l'employeur ayant considéré que le certificat médical était illisible et exempt de diagnostic.
Décision
La convention collective prévoit que le « salarié perdra son ancienneté s'il [...] s'absente pendant plus de sept (7) jours consécutifs prévus au calendrier de travail [...] sans fournir à l'employeur, par téléphone ou par écrit, une explication satisfaisante pour telle absence [...]. » L'application de cette clause est automatique, et l'arbitre ne peut substituer une autre mesure disciplinaire au congédiement. Le grief ne pourra être accueilli que si les conditions n'existaient pas au moment de la décision de l'employeur. En l'espèce, le plaignant s'était absenté plus de sept jours, et il s'agit de déterminer s'il a « fourni » une explication satisfaisante en transmettant le certificat médical. Selon la jurisprudence, pour constituer un certificat médical, le document fourni à l'employeur doit comporter un diagnostic. Il est vrai qu'il en comportait un lorsqu'il a été remis au responsable des assurances collectives, mais, sur le document transmis à l'employeur, le diagnostic avait été biffé et le plaignant doit subir les conséquences des gestes de son mandataire. C'est ce document que l'employeur avait en main lorsqu'il a pris sa décision, et la convention collective prévoit non pas que le salarié ait une explication satisfaisante, mais qu'il en « fournisse » une. Le syndicat a fait valoir que, compte tenu des circonstances, l'employeur aurait dû demander au plaignant l'original du certificat médical. Il s'appuie sur une jurisprudence qui, compte tenu des circonstances, a sanctionné l'employeur pour ne pas avoir fait de démarches afin de s'assurer que le salarié n'avait pas d'explication satisfaisante à son absence. Or, en l'espèce, en vertu de la convention collective, c'est le salarié qui doit « fournir une explication ». De plus, les circonstances démontrent que le plaignant refusait de travailler à la distribution et que la condition médicale alléguée ne constituait pas la raison de l'absence prolongée. L'employeur aurait pu tout simplement attendre l'écoulement du temps sans prendre contact avec le plaignant. De façon subsidiaire, les circonstances constituent des indices graves, précis et concordants du caractère complaisant du certificat médical. Ainsi, la perte d'ancienneté et d'emploi est confirmée.
Syndicat des travailleurs de câbles d'acier de Pointe-Claire (CSN) et Industries de câbles d'acier ltée (Gilles Monette), SOQUIJ AZ-50479600
L'employeur n'est pas tenu d'accorder un congé sans solde au plaignant, qui doit purger une peine d'emprisonnement; le congédiement de celui-ci est confirmé.
Le plaignant, un opérateur-réparateur au concentrateur, s'est vu imposer une peine d'emprisonnement de neuf mois à purger dans la collectivité. Il n'a pas respecté ses conditions de détention et a été arrêté. Sachant qu'il serait incarcéré, il a demandé à l'employeur quatre jours de vacances, qui lui ont été refusés. Il a été incarcéré, et le syndicat a demandé, en vain, un congé sans solde de 20 jours. Il s'agit de déterminer si un salarié emprisonné peut obtenir un congé sans solde de son employeur lui permettant de purger sa peine pour ensuite retourner au travail.
Décision
La Cour suprême, dans Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc. (C.S. Can., 2003-11-14), 2003 CSC 68, SOQUIJ AZ-50206959, J.E. 2003-2125, D.T.E. 2003T-1124, [2003] 3 R.C.S. 228, a décidé que la peine d'emprisonnement n'est pas un motif valable d'absence, que, devant un tel cas, l'employeur n'est pas obligé d'accorder un congé sans solde, qu'il ne s'agit pas de discrimination contre le travailleur ni d'une violation de l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne et que l'employeur n'a pas d'obligation d'accommodement envers le salarié. Ainsi, la clause de la convention collective prévoyant la perte de l'emploi en cas d'absence du travail pendant plus de trois jours sans justification et sans raison est applicable. Le congédiement est donc confirmé.
Syndicat des métallos, section locale 5778/6869 et Compagnie minière Québec Cartier (Stéphane Samuel), SOQUIJ AZ-50475440
La conduite d'un chariot élévateur, alors que le plaignant avait consommé de l'alcool au travail et était en état d'ébriété, constitue un facteur aggravant qui fonde son congédiement, malgré son dossier vierge, puisque sa santé et sa sécurité ainsi que celles de ses collègues ont été mises en danger.
Le plaignant, un commis-manutentionnaire, occupait ses fonctions à titre occasionnel depuis environ 1 000 heures dans un centre de distribution où il doit préparer des commandes et déplacer des palettes de matériel à l'aide d'un chariot élévateur. Le jour de l'incident, il a consommé de l'alcool une heure avant son quart de travail et pendant celui-ci; il a dû quitter les lieux en raison de son état d'ébriété. Le lendemain, on l'a avisé qu'il était suspendu aux fins d'une enquête. Par la suite, il est revenu à l'usine tous les jours pour savoir ce qui se passait, puis il a été convoqué à une rencontre, pour finalement être congédié. Il a fait parvenir une lettre à l'employeur, lui demandant une suspension sévère au lieu du congédiement au motif qu'il avait cessé sa consommation d'alcool.
Décision
Les faits sont prouvés : le plaignant a travaillé alors que ses facultés étaient affaiblies. L'admission de sa faute, lors de l'enquête menée par l'employeur, n'a pas une grande importance et ne peut constituer un facteur atténuant. En effet, cet aveu n'a pas eu pour conséquence d'éviter la tenue d'une longue enquête. De plus, le plaignant a contrevenu à la politique de l'employeur qui prévoit que la consommation d'alcool est prohibée au travail et qu'il est défendu de se présenter à l'usine en état d'ébriété. Le fait qu'il y ait des risques importants à conduire un chariot élévateur en état d'ébriété constitue un facteur aggravant. Le plaignant aurait pu mettre en danger sa propre santé et sa sécurité, de même que celles de ses collègues. Quant à la lettre qu'il a fait parvenir à l'employeur, le Tribunal doute de sa sincérité. En effet, le dépôt d'une preuve à ce sujet (plumitif criminel) démontre qu'il n'a pas cessé de consommer de l'alcool. Ce fait est postérieur, mais, en transmettant sa lettre, le plaignant a ouvert la porte à cette preuve, qui vient le contredire. Enfin, même s'il n'a pas de dossier disciplinaire et qu'il s'agit d'une première infraction en matière de consommation d'alcool, son ancienneté à titre de salarié occasionnel n'est que de 1 000 heures et il doit assumer les conséquences de ses gestes. Ainsi, le congédiement est maintenu.
Napa Pièces d'auto UAP inc. — Centre de distribution de Montréal et Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), (Martin Lachapelle), SOQUIJ AZ-50468475
Le congédiement du plaignant — aux prises avec un problème d'alcool — en raison de sa contravention à une deuxième entente de dernière chance est confirmé; il ne pouvait substituer un suivi fait par des professionnels dans un contexte thérapeutique par des réunions des AA alors qu'il s'était engagé à « maintenir une consultation en consultation externe ».
Le plaignant, un préposé à l'expédition dont le travail consistait à conduire un chariot élévateur et à préparer des commandes, a fait l'objet d'une première entente de dernière chance en février 2002. En février 2005, il a été suspendu durant une période de quatre semaines pour s'être présenté au travail en état d'ébriété. Dans les jours suivants, il a signé une seconde entente de dernière chance. Il s'est alors engagé à suivre une cure dans un centre de désintoxication et à se soumettre à un suivi hebdomadaire postcure d'une durée minimale de un an. Il n'a toutefois participé qu'à quatre rencontres, ce suivi ayant été interrompu par le centre de désintoxication en raison de ses absences sans avis. Lorsqu'il a été interrogé par l'employeur, en mai 2005, sur les raisons de son abandon du suivi, le plaignant a répondu qu'il se rendait plutôt à des réunions du groupe Alcooliques anonymes (AA), s'y sentant plus à l'aise et croyant que cela compensait les suivis hebdomadaires. L'employeur l'a alors congédié, invoquant le non-respect de l'entente.
Décision
La preuve doit être analysée à la date où l'employeur a rencontré le plaignant; la preuve postérieure n'est d'aucune utilité pour trancher le grief. Le plaignant prétend avoir respecté les termes de l'entente. Or, au troisième paragraphe, il « s'engage à maintenir une consultation en consultation externe et assistant à toutes les séances prévues pour un minimum d'un an ». Cet engagement, rédigé en termes généraux, couvre le suivi postcure. Or, le plaignant a substitué un suivi fait par des professionnels dans un contexte thérapeutique aux réunions des AA, soit des rencontres fraternelles qui ont également l'objectif de maintenir la sobriété, mais dont l'effet thérapeutique peut être moins probant. En outre, il n'a aucunement obtenu la permission de qui que ce soit pour effectuer cette substitution. Une entente de dernière chance est un substitut au congédiement immédiat. En l'espèce, la lettre d'entente ne laisse pas de discrétion à l'employeur ni à l'arbitre lorsqu'une contravention est constatée. Elle prévoit en effet que « [t]oute violation des engagements de l'employé [...] sera sanctionnée par un congédiement immédiat ».
STT de la Brasserie Labatt (CSN) et Brasserie Labatt ltée (Steve Larocque), SOQUIJ AZ-50426683
Le congédiement d'un cuisinier pour avoir tenté d'introduire de l'alcool sur les lieux du travail est confirmé, l'employeur — qui exploite une mine en territoire autochtone — ayant adopté une politique de « tolérance zéro » à ce sujet.
En mai 2000, le plaignant a été embauché à titre de cuisinier pour aller travailler au Nunavik, à la mine Raglan. À son retour de vacances, le 9 janvier 2006, alors qu'il devait prendre l'avion le menant à la mine, on a trouvé dans ses bagages une bouteille de rhum. L'employeur l'a congédié le 23 janvier suivant pour avoir violé le règlement prohibant l'alcool sur le site minier en raison d'une entente avec la communauté inuit, dont plusieurs villages sont des « dry communities ».
Décision
Il s'agit d'une problématique hors du commun alors que la vie et le travail se situent en région éloignée, sur un territoire occupé par la communauté inuit. L'exploitation de la mine est régie par un contrat, l'« Entente Raglan de 1995 », qui prime tout autre contrat existant. La convention collective prévoit d'ailleurs que les conditions de travail ne peuvent être interprétées à l'encontre de cette entente. Or, c'est en vertu de la convention et de l'entente qu'une politique concernant les drogues et l'alcool a été adoptée, laquelle se traduit par une prohibition totale de ces substances. À deux reprises, lors de son embauche et au moment de la signature de son contrat de travail, le plaignant a pris connaissance de la politique en question et il a même signé un document à cet effet. Cette politique est énoncée de façon encore plus précise dans le manuel des employés, remis à chacun d'eux. Par ailleurs, il existe plusieurs contradictions dans le témoignage du plaignant, et le Tribunal est convaincu qu'il ne s'agit pas d'un oubli comme celui-ci l'a affirmé, mais plutôt d'un risque qu'il a couru en emportant cette bouteille alors qu'il savait que les bagages seraient radiographiés. Il s'agit d'une inconduite qui dénote un grave manque de jugement de sa part. Quant à la sévérité de la sanction, il y a lieu de tenir compte du fait que, en raison de l'entente signée avec les Inuits, l'employeur ne peut se permettre une tolérance qui risquerait de compromettre ses relations avec les autochtones et que, s'il crée un précédent, d'autres salariés pourraient s'en servir. Le plaignant a manqué à son devoir de loyauté, et sa façon de se comporter, alors qu'il a donné plusieurs versions des événements, est un facteur aggravant. Compte tenu de la jurisprudence arbitrale, il n'y pas lieu d'intervenir.
Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 9449 (FTQ) et Falconbridge ltée (Denis Dufresne), SOQUIJ AZ-50366957
Le congédiement d'un opérateur pour cause d'absentéisme lié à l'alcoolisme est confirmé; l'employeur a satisfait à son obligation d'accommodement, tandis que le plaignant n'a pas pris tous les moyens disponibles afin de contrôler les effets de sa maladie.
Le 10 novembre 2003, le plaignant, un opérateur, a été suspendu trois jours à la suite d'une altercation survenue sur les lieux du travail. Le jour même, il a remis un rapport médical recommandant un arrêt de travail pour cause de dépression situationnelle. Durant son absence, il a consulté un centre de désintoxication en raison de ses problèmes de surconsommation d'alcool et de drogues. En septembre 2004, l'assureur a cessé le versement des indemnités. Le 12 octobre suivant, l'employeur a congédié le plaignant au motif qu'il était absent depuis un an, qu'il avait un taux d'absences de 40 % et qu'il refusait de suivre une thérapie, ce qui démontrait son manque de volonté de régler ses problèmes de consommation.
Décision
Il s'agit en l'espèce d'un congédiement administratif et non disciplinaire. Selon l'employeur, le plaignant ne fournissait plus une prestation normale de travail et il était d'avis que cette situation ne changerait pas, d'où la rupture du lien d'emploi. Dans de telles circonstances, quatre questions se posent : 1) L'employeur a-t-il fait la preuve que le taux d'absences du plaignant démontrait une prestation de travail anormale? 2) La raison de l'absentéisme était-elle liée à une maladie? 3) La maladie étant un handicap au sens des chartes, l'employeur a-t-il rempli son devoir d'accommodement envers le plaignant? 4) L'employeur avait-il des motifs lui permettant de croire raisonnablement que, dans un avenir rapproché, le plaignant serait en mesure d'offrir une prestation normale de travail?
1) La preuve non contestée démontre que le plaignant a atteint un taux moyen d'absences, au cours des années 2002, 2003 et 2004, de plus de 40 %. Un tel taux ne peut correspondre à une prestation normale de travail quand la preuve révèle pour ces mêmes années un taux d'absences moyen de 2 à 3 % pour les autres salariés. 2) Le plaignant souffre d'un problème d'alcool sérieux qu'il n'est pas parvenu à maîtriser malgré toutes ses tentatives de régler la situation par des cures répétées. Or, il est reconnu depuis longtemps que l'alcoolisme constitue une maladie. 3) Il est établi que, de 2002 à 2004, l'employeur a été compréhensif, tolérant et patient relativement au problème d'alcool du plaignant. Tout en l'avisant qu'il devait remédier à son problème, il savait que ce dernier suivait des cures et il acceptait ses absences, ses retards répétés, ses départs prématurés, ses haussements de ton et l'inconfort qu'il créait auprès de ses collègues. Il a annulé deux suspensions, indiquant toutefois au plaignant qu'il devait réfléchir à sa situation et se prendre en main. Rien n'y fit. Il est difficile d'exiger davantage d'un employeur dans l'exécution de son devoir d'accommodement à l'égard d'un employé qui souffre d'une maladie. Par ailleurs, si l'employeur se doit d'accommoder un employé en difficulté, ce dernier a également le devoir et la responsabilité de prendre tous les moyens pour guérir ou, à tout le moins, pour atténuer les effets de sa maladie afin d'offrir une prestation de travail normale et régulière. S'il échoue et si les mesures d'accommodement de l'employeur échouent également, la relation contractuelle n'a plus de raison d'être et doit se terminer. 4) Le passé étant généralement garant de l'avenir, les nombreuses cures, rechutes et absences de longue durée du plaignant permettaient à l'employeur de croire que le problème n'était pas près de se régler. En outre, les faits postérieurs au congédiement ou ceux qui n'ont été révélés qu'à l'audience viennent confirmer cette conclusion.
Association des employés de Patenaude Industries inc. et Patenaude Industries inc. (Clément Duplessis), SOQUIJ AZ-50338850
Incapacité physique ou psychologique
La Cour suprême conclut que l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Hydro-Québec est entaché de deux erreurs de droit, l'une portant sur la norme d'évaluation de la contrainte excessive, et l'autre, sur le moment pertinent pour décider si l'employeur a satisfait à son obligation d'accommodement; cette obligation cesse là où les obligations fondamentales rattachées à la relation du travail ne peuvent plus être remplies par l'employé dans un avenir prévisible.
Résumé
Pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec ayant infirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté la requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale de grief. Accueilli.
La plaignante, une employée d'Hydro-Québec, souffre de nombreux problèmes physiques et mentaux, et son dossier d'absences indique qu'elle a manqué 960 jours de travail entre le 3 janvier 1994 et le 19 juillet 2001. Au fil des ans, l'employeur ajuste les conditions de travail de la plaignante pour tenir compte des limites de cette dernière. Au moment de son congédiement, le 19 juillet 2001, la plaignante ne s'était pas présentée au travail depuis le 8 février. Son médecin traitant lui avait prescrit un arrêt de travail à durée indéterminée et l'expertise du psychiatre de l'employeur mentionnait que la plaignante ne serait plus en mesure de fournir « une prestation de services régulière et continue sans continuer à présenter un problème d'absentéisme comme [...] dans le passé ». La plaignante dépose un grief, alléguant que le congédiement n'est pas justifié. L'arbitre rejette le grief au motif que l'employeur avait prouvé qu'au moment où il a congédié la plaignante, celle-ci ne pouvait, dans un avenir raisonnablement prévisible, remplir sa prestation de travail soutenue et régulière prévue au contrat. De plus, les conditions de retour au travail suggérées par l'expert du syndicat constitueraient une contrainte excessive. La Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire de la décision de l'arbitre. La Cour d'appel infirme le jugement de la Cour supérieure, concluant que l'employeur n'avait pas prouvé qu'il lui était impossible de composer avec les caractéristiques de la plaignante. De plus, l'arbitre ne devait pas uniquement tenir compte des absences, car l'obligation d'accommodement doit être évaluée au moment de la décision de mettre fin à l'emploi.
Décision
Mme la juge Deschamps : Le critère d'évaluation de la contrainte excessive formulé par la Cour d'appel est erroné. Ce critère n'est pas l'impossibilité pour un employeur de composer avec les caractéristiques d'un employé. Bien que l'employeur n'ait pas l'obligation de modifier de façon fondamentale les conditions de travail, il a cependant l'obligation d'aménager, si cela ne lui cause pas une contrainte excessive, le poste de travail ou les tâches de l'employé pour lui permettre de fournir sa prestation de travail. L'incapacité totale d'un salarié de fournir toute prestation de travail dans un avenir prévisible n'est pas le critère de détermination de la contrainte excessive. Lorsque les caractéristiques d'une maladie sont telles que la bonne marche de l'entreprise est entravée de façon excessive ou lorsque l'employeur a tenté de convenir de mesures d'accommodement avec l'employé aux prises avec une telle maladie, mais que ce dernier demeure néanmoins incapable de fournir sa prestation de travail dans un avenir raisonnablement prévisible, l'employeur aura satisfait à son obligation de démontrer la contrainte excessive. L'obligation d'accommodement qui incombe à l'employeur cesse là où les obligations fondamentales rattachées à la relation de travail ne peuvent plus être remplies par l'employé dans un avenir prévisible. En l'espèce, l'arbitre n'avait commis aucune erreur de droit et rien ne justifiait une intervention dans son appréciation des faits. [16] [18-19] [23]
C'est aussi par erreur que la Cour d'appel a estimé que l'obligation d'accommodement devait être évaluée au moment de la décision de congédier la plaignante. Plutôt, il faut privilégier une évaluation globale de l'obligation d'accommodement qui tient compte de l'ensemble de la période pendant laquelle l'employée s'est absentée. [20]
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2008. Reproduit avec la permission du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
Hydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ), SOQUIJ AZ-50502617
L'employeur, qui exploite des résidences pour jeunes en difficulté, était fondé à congédier la plaignante — une gardienne de nuit — au terme d'une absence de plus de 36 mois; compte tenu des limitations fonctionnelles consécutives à un accident vasculaire cérébral de cette dernière, il ne pouvait l'accommoder sans subir de contrainte excessive.
La plaignante travaillait à titre de gardienne de nuit dans un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse. Elle conteste la décision de l'employeur de mettre fin à son emploi en application de la clause de la convention collective prévoyant la perte d'emploi à la suite d'une absence de plus de 36 mois pour cause d'invalidité. Elle s'est absentée à compter du 4 février 2002 en raison d'une dépression majeure. Par la suite, elle a tenté, sans succès, trois retours progressifs au travail. À compter du 29 octobre 2003, un neurochirurgien lui a prescrit un arrêt de travail pour une période indéterminée en raison d'un anévrisme géant au cerveau. Au mois de janvier 2004, quatre jours après une opération au cerveau, elle a subi un accident vasculaire cérébral. Au mois d'avril 2005, l'employeur a décidé de mettre fin à son emploi compte tenu du fait qu'elle était absente pour cause d'invalidité depuis plus de 36 mois et qu'elle n'était toujours pas apte au travail. L'employeur invoque l'opinion de son médecin expert, un neurochirurgien, selon lequel la plaignante a subi une lésion dans la région antérieure des lobes frontaux entraînant des déficits d'attention, des pertes de mémoire, une baisse de la créativité, une tendance à manifester des émotions inadéquates et une certaine apathie. Ce médecin conclut à l'incapacité de la plaignante à assumer ses fonctions de gardienne de nuit compte tenu de ses limitations et du risque élevé de rechute. L'employeur précise que la gardienne de nuit travaille auprès d'une clientèle de jeunes contrevenants. Les risques d'agressions sont élevés et la gardienne doit avoir toutes ses capacités afin d'assurer sa propre sécurité et celle de la clientèle. Il précise que la gardienne travaille généralement de façon autonome. Selon lui, en raison de la condition médicale de la plaignante, il ne pouvait lui offrir un accommodement sans subir une contrainte excessive. Le syndicat invoque pour sa part les conclusions de son médecin expert selon lesquelles la plaignante était apte à effectuer un retour progressif au travail. Il prétend que l'employeur aurait dû tenir compte de ses limitations en lui offrant certaines mesures d'accommodement.
Décision
Le syndicat a souligné avec justesse la diversité des malchances qu'a éprouvées la salariée sur le plan médical. Après avoir subi une dépression, une chirurgie du tunnel carpien et une chirurgie ayant permis la ligature d'un anévrisme géant, elle a eu un accident vasculaire cérébral qui a entraîné une grave détérioration de ses fonctions neurologiques. À cet effet, les conclusions du médecin expert de l'employeur reposent sur des constats précis concernant certaines habiletés cognitives réduites. Or, le syndicat n'a présenté aucune preuve afin de contredire les constats de cet expert, son propre médecin expert n'ayant pas suffisamment tenu compte de la réalité du travail de la plaignante. Il est clair qu'en réintégrant celle-ci dans ses fonctions l'employeur aurait compromis la sécurité, la santé et le bien-être des jeunes sous sa responsabilité, en plus de compromettre la sécurité et l'intégrité de la plaignante. Le gardien de résidence ne bénéficie que d'un niveau minimal de supervision et d'encadrement. Sauf exception, il est seul pendant son quart de travail à surveiller les jeunes de son unité et à veiller à leur sécurité, à leur santé et à leur bien-être. Il doit donc faire preuve d'une grande autonomie et avoir la capacité d'intervenir seul, et rapidement, lorsqu'une situation de crise se présente. Dans ces circonstances, et compte tenu des atteintes d'ordre cognitif présentes chez la plaignante, celle-ci était incapable d'exécuter certaines tâches essentielles rattachées à la fonction qu'elle occupait. Relativement à l'obligation d'accommodement, l'employeur a entrepris une démarche authentique et sérieuse, en collaboration avec le syndicat, afin d'évaluer les possibilités d'accommoder la plaignante. Au terme de cette démarche, il a conclu à l'inexistence d'un poste disponible correspondant à la qualification et aux capacités réduites de la plaignante. Quant à la possibilité d'un transfert dans un autre établissement, une telle mesure n'aurait pas permis de réduire les risques pour la sécurité de la plaignante. Enfin, l'employeur ne pouvait créer un poste sur mesure pour cette dernière ou encore lui offrir une assistance permanente sans subir une contrainte excessive. Dans l'évaluation du devoir d'accommodement, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des mesures d'accommodement offertes à la plaignante depuis le début de son invalidité, y compris la période d'absence prévue à la convention collective. L'employeur ne pouvait donc l'accommoder sans subir une contrainte excessive.
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et SCFP, section locale 2718 (S.M.), SOQUIJ AZ-50504040
Une préposée aux bénéficiaires absente du travail depuis plus de 36 mois en raison d'une lombarthrose grave refuse les propositions d'accommodement de l'employeur, dont celle de réduire son poids de 30 livres; l'arbitre estime que cette avenue était raisonnable et confirme le congédiement de la plaignante.
La plaignante, une préposée aux bénéficiaires âgée de 53 ans au moment du dépôt des griefs, a été congédiée après s'être absentée du travail plus de 36 mois en raison d'une grave lombarthrose. Celle-ci ayant demandé à l'employeur qu'il s'acquitte de son obligation d'accommodement, ce dernier l'a fait expertiser par un orthopédiste, qui a conclu qu'elle était inapte à effectuer ses tâches en raison de sa maladie arthrosique et de sa surcharge pondérale. Il a ajouté qu'elle devrait perdre au moins 30 livres avant d'être autorisée à reprendre ses tâches habituelles. L'employeur a acheminé cette proposition à la plaignante, qui l'a refusée et contestée par voie de grief.
Décision
La prestation de travail constitue l'une des obligations essentielles du contrat de travail, en échange de laquelle le salarié reçoit sa rémunération. En l'espèce, la plaignante a été absente du travail pendant trois ans et a eu durant les quatre années précédentes un taux d'absences anormalement élevé. D'autre part, une amélioration ou une rémission de sa pathologie dans un avenir prévisible paraît improbable. Par conséquent, le congédiement doit être maintenu, à moins que la plaignante ne démontre que la décision de l'employeur est discriminatoire. Or, tous les médecins au dossier, y compris le médecin traitant de la plaignante, ont conclu qu'en raison de sa lombarthrose des rechutes graves et répétitives étaient appréhendées si elle maintenait son poids à 230 livres. La perte d'au moins 30 livres constituait donc un traitement essentiel pour lui permettre d'exécuter ses tâches de préposée aux bénéficiaires sans risquer d'aggraver sa condition médicale. Or, elle a toujours refusé de perdre du poids. D'autre part, le fait de réintégrer la plaignante sans condition, en respectant ses limitations fonctionnelles, aurait eu pour effet d'augmenter considérablement les tâches déjà exigeantes des autres préposés aux bénéficiaires, ce qui aurait été injuste pour ces derniers. La proposition de l'employeur a été faite de bonne foi, sans intention discriminatoire, dans le but de préserver la santé et la sécurité de la plaignante. Il n'aurait pas pu mettre en place une autre mesure d'accommodement sans qu'il en résulte pour lui une contrainte excessive. Par conséquent, sa proposition satisfaisait aux trois critères élaborés dans Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU (C.S. Can., 1999-09-09), SOQUIJ AZ-50067256, J.E. 99-1807, D.T.E. 99T-868, [1999] 3 R.C.S. 3.
Poirier et Centre Maria-Chapdelaine, SOQUIJ AZ-50510570
Dans le cas d'une secrétaire atteinte d'un cancer du sein et qui n'a pu remplir les conditions d'assiduité consignées dans une entente de retour au travail intervenue après l'expiration de la période d'absence de 24 mois allouée par la convention collective, le syndicat n'a pas réussi à démontrer qu'un retour au travail était prévisible dans un délai raisonnable; le congédiement est confirmé.
La plaignante, une agente de secrétariat, conteste la décision de l'employeur de mettre fin à son emploi au mois de mars 2007. Elle s'est absentée à compter du mois d'octobre 2004 en raison d'un cancer du sein. À l'expiration de la période d'invalidité de 104 semaines prévue à la convention collective, les parties ont convenu d'une entente prévoyant les modalités de son retour progressif au travail au cours d'une période d'essai devant aller du 30 octobre 2006 au 11 mai 2007. L'entente prévoyait la fin de la période d'essai et la cessation d'emploi de la plaignante si celle-ci s'absentait en invalidité à plus de 5 reprises ou pendant plus de 21 jours consécutifs. À compter du 3 janvier 2007, la plaignante s'est de nouveau absentée en raison d'une résurgence de son cancer. Le 12 mars suivant, l'employeur l'a informée de sa cessation d'emploi en application de l'entente de retour progressif au travail. Le syndicat soutient qu'il n'a pas respecté son obligation d'accommodement.
Décision
L'entente relative au retour progressif au travail prévoit qu'il s'agit d'une mesure finale d'accommodement. En cas d'absences pour cause d'invalidité pendant la période visée à l'entente, les parties ont convenu que l'employeur pouvait mettre fin à l'emploi et que la compétence de l'arbitre était alors limitée à constater les conditions d'application de l'entente. Malgré ces limites aux pouvoirs de l'arbitre, celui-ci conserve sa compétence afin de s'assurer que les dispositions ne contreviennent pas à une loi d'ordre public. À cet effet, il importe de distinguer l'entente de retour progressif au travail de l'entente de dernière chance en matière disciplinaire, celles-ci n'ayant pas la même finalité. L'entente de retour progressif au travail constitue une forme d'accommodement négocié par les parties à l'égard d'un salarié qui souffre d'un handicap. Or, tel que l'a reconnu la Cour suprême du Canada dans Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de l'Hôpital général de Montréal (C.S. Can., 2007-01-26), 2007 CSC 4, SOQUIJ AZ-50408361, J.E. 2007-291, D.T.E. 2007T-111, [2007] 1 R.C.S. 161, l'accommodement négocié par les parties dans une entente ne constitue pas nécessairement un accommodement définitif, mais plutôt un élément pertinent dans l'appréciation de l'obligation d'accommodement raisonnable, laquelle découle du droit à l'égalité reconnu comme un droit fondamental. L'entente relative au retour progressif est donc inopposable à la plaignante dans la mesure où elle ne permet pas de lui assurer un accommodement raisonnable et contrevient à son droit fondamental à l'égalité. Le Tribunal doit déterminer si, au moment de mettre fin à son emploi, il était possible pour l'employeur de lui offrir un accommodement raisonnable sans contrainte excessive. À cet égard, il faut souligner qu'un employeur n'est pas tenu de maintenir à son emploi un salarié incapable de fournir sa prestation de travail dans un avenir raisonnable. Le fardeau de démontrer la possibilité d'un retour au travail dans un délai raisonnable incombe au salarié. Par ailleurs, la jurisprudence établit que le délai raisonnable de retour au travail doit correspondre à un certain nombre de jours ou de semaines, qui varie selon les circonstances. Or, au moment de sa cessation d'emploi, la plaignante n'était pas apte au travail avant une période d'environ cinq mois et demi. Il ne s'agissait pas d'un délai raisonnable de retour au travail. L'employeur était donc fondé à mettre fin à son emploi.
Syndicat de la fonction publique du Québec et Québec (Gouvernement du…) (Emploi et Solidarité sociale), (Francine Prévost), SOQUIJ AZ-50498874
La nouvelle formule de mesure du rendement des préposés à l'entrepôt en ce qui a trait au nombre de caisses manipulées ne constitue pas un changement technologique ni l'instauration de nouvelles méthodes de travail; le congédiement du plaignant pour rendement insatisfaisant a été imposé après une progression des sanctions et est confirmé.
Le plaignant travaillait à titre de préposé à l'entrepôt dans un centre de distribution de denrées non périssables. Son travail consistait principalement à manipuler des caisses de marchandise. Il conteste les quatre suspensions ainsi que le congédiement qui lui ont été imposés en raison de son rendement insatisfaisant au travail. L'employeur a mis en place un système de contrôle de la production visant à établir des normes de rendement et à s'assurer que les salariés respectent celles-ci. Le système impliquait notamment une nouvelle formule de mesure du rendement en ce qui a trait au nombre de caisses manipulées. L'employeur fait valoir que le plaignant ne s'est pas conformé aux normes établies malgré les nombreuses mesures disciplinaires qui lui ont été imposées. Pour sa part, le syndicat prétend d'abord que l'employeur n'a pas respecté la règle de la progression des sanctions prévue à la convention collective puisque la première mesure disciplinaire imposée constituait une « sévère réprimande » et non un avis écrit. Il soutient que cela invalide tout le processus disciplinaire. Relativement au rendement insatisfaisant du plaignant, il allègue que celui-ci n'avait pas reçu la formation adéquate lui permettant de respecter les nouveaux standards de l'employeur. Il prétend que la façon de travailler a été modifiée de façon draconienne alors que le plaignant avait été formé afin de répondre aux exigences de l'ancienne méthode de travail. Il ajoute que l'employeur devait reprendre le processus disciplinaire à partir du début lors de l'application du nouveau système de contrôle de la production.
Décision
Le Tribunal ne retient pas l'argument syndical selon lequel la mesure disciplinaire imposée au plaignant au début du processus disciplinaire ne constituait pas un avis écrit au sens de la convention collective. La mesure en question constituait bien un avis écrit et son intitulé ou son objet de « sévère réprimande » ne vient pas en changer la nature. Par ailleurs, l'employeur n'avait pas à reprendre le processus disciplinaire à partir du début lors de l'application du nouveau système de contrôle de la production. Contrairement aux prétentions syndicales, il n'y a pas eu de changement technologique ni l'instauration de nouvelles méthodes de travail. Il y a uniquement eu la mise en place un nouveau système de contrôle du rendement en faisant appel à des standards beaucoup plus précis pour mesurer la performance des salariés, lesquels ont reçu une formation adéquate.
Relativement aux mesures imposées, l'employeur a respecté le principe de la progression des sanctions. En matière de rendement insatisfaisant au travail, la jurisprudence arbitrale reconnaît le droit de l'employeur d'imposer des mesures disciplinaires en raison de l'omission d'un salarié d'atteindre des normes de productivité dans le secteur de la distribution alimentaire et dans des domaines connexes. De plus, il est reconnu que l'établissement de standards de productivité est un droit de la direction, et que l'arbitre ne peut intervenir que s'ils sont abusifs, discriminatoires ou malicieux. Un employeur peut également procéder à des mesures disciplinaires même si le salarié a fait tous les efforts pour atteindre le niveau demandé. L'employeur n'a pas à démontrer en ce cas une conduite fautive du salarié, et son fardeau de preuve consiste à démontrer de façon convaincante que le salarié n'a pas satisfait aux normes exigées. Si le syndicat allègue la méconnaissance de certains aspects des standards tels que l'obligation de demander des délais pour justifier l'omission de respecter la norme, il doit démontrer que cette ignorance explique l'écart entre la norme requise et celle atteinte. En l'espèce, le syndicat n'a pas fait une telle démonstration. Par contre, le témoin expert de l'employeur a démontré que les normes de productivité mises en place étaient justes, précises et atteignables. Le système de contrôle de la production est, sinon le meilleur, du moins l'un des plus adéquats et performants sur le marché. Le plaignant n'a pas respecté la norme fixée par l'employeur ni n'a fourni un rendement adéquat, et il n'y a au dossier aucune preuve venant établir qu'il n'a pas atteint les standards de productivité en raison d'une erreur d'application de ces derniers. Les griefs sont donc rejetés.
Sobeys Québec inc. (Entrepôt) et Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 (FTQ), (Christian Audet, SOQUIJ AZ-50497117
Il est vrai que la plaignante — une enseignante de mathématiques d'origine algérienne — a été victime de propos racistes de la part de certains élèves et de leurs parents; toutefois, l'employeur ayant rapidement pris des mesures afin de sanctionner sévèrement les élèves et d'aviser les parents que de tels actes ne sauraient être tolérés dans l'institution, on ne peut lui imposer une obligation de résultat à cet égard et le grief contestant un non-rengagement en raison de l’évaluation négative est confirmé.
La plaignante a été affectée à une école polyvalente pour y enseigner les mathématiques durant l'année scolaire 2006-2007. Elle est d'origine algérienne et vit au Québec depuis 1998. Des élèves et leurs parents se sont plaints de ses méthodes d'enseignement. Le directeur adjoint de l'école a assisté à l'une de ses classes et lui a fait des suggestions afin qu'elle améliore la communication avec ses élèves. Il a aussi désigné une collègue de la plaignante pour l'aider à améliorer sa prestation de travail. Par ailleurs, certains élèves ont tenu à son endroit des propos racistes, lui disant notamment de « retourner dans son pays », et des parents ont manifesté un comportement agressif envers elle. La plaignante a déposé deux griefs, l'un contestant la discrimination dont elle aurait été l'objet et l'autre, le non-renouvellement de son contrat de travail. Le syndicat soutient que l'employeur a fait preuve de laxisme quant au comportement répréhensible des élèves et de leurs parents. Il ajoute qu'il a été injuste dans son évaluation de l'enseignement de la plaignante.
Décision
La plaignante a été victime d'actes discriminatoires et il y a manifestement eu atteinte à sa dignité. Or, l'employeur, auquel incombe l'obligation de prendre les mesures nécessaires afin de protéger la dignité de ses salariés, a sanctionné les élèves qui avaient eu des comportements malveillants. De fait, il a pris plusieurs mesures en vue de réprimer ces débordements et de faire connaître aux élèves ainsi qu'à leurs parents que de tels actes répréhensibles ne pouvaient être tolérés dans l'institution. Par conséquent, il ne saurait être question d'imposer à l'employeur une obligation de résultat à cet égard, au point de lui imputer la responsabilité automatique de toute récidive. Par ailleurs, en ce qui a trait au grief contestant le non-renouvellement de son contrat, il appert que la plaignante a tenté sérieusement d'améliorer sa prestation d'enseignement, mais malheureusement, sans grand succès. Devant ce constat, et compte tenu des piètres résultats des élèves, de l'inquiétude exprimée par leurs parents et de l'obligation de l'employeur d'offrir le meilleur service éducatif possible, il n'était pas abusif que ce dernier refuse de renouveler son contrat. Par conséquent, ce grief est également rejeté.
Syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (Fatma Yahiaoui), SOQUIJ AZ-50486345
La plaignante — une répartitrice médicale d'urgence depuis 17 ans — est incapable d'intégrer et d'appliquer correctement les nouvelles méthodes de travail malgré le soutien et la formation dont elle a fait l'objet; son congédiement est confirmé.
La plaignante occupait un poste de répartitrice médicale d'urgence depuis 17 ans dans un centre de communication santé au sens de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence. Elle devait répondre aux appels en suivant une démarche précise, de laquelle elle ne pouvait déroger. En 2004, l'employeur a mis en application un nouveau protocole d'intervention permettant d'obtenir des renseignements précis sur l'état de la personne qui devait être acheminée vers un établissement médical. Une formation a été offerte à cet effet, et la plaignante a réussi l'examen de certification. Elle a également réussi, deux ans plus tard, l'examen de réévaluation. En raison de difficultés persistantes, notamment quant à son rendement, elle a fait l'objet d'un soutien parallèle, en 2004, et d'une nouvelle formation, en février 2005. Plusieurs rencontres de rétroaction ont également eu lieu dans le contexte du programme d'assurance-qualité. En juin 2005, l'employeur a modifié les règles de fonctionnement se rapportant aux échanges d'affectation. Le 28 juin, la plaignante aurait alors exprimé de façon désobligeante, arrogante et agressive son désaccord. Le lendemain, elle a reçu un avis verbal parce qu'elle n'avait pas signé le registre des notes de service, contrevenant ainsi aux exigences du Guide des règles et des responsabilités des RMU du RASMCQ. Le 30 juin, au lieu de signer le registre, elle a inscrit son numéro de matricule. À deux reprises, elle aurait manifesté son mécontentement en ce qui a trait au guide en frappant sur son bureau. De plus, elle a critiqué la direction ainsi qu'une entreprise avec qui elle devait faire affaire. Le 11 juillet, elle a été suspendue en raison des manquements sérieux à ses obligations de respect et de civilité entre le 28 juin et le 4 juillet. Son comportement ne s'étant pas amélioré, elle a été suspendue pour une période de un mois le 30 août suivant. L'employeur lui a reproché ses retards, le non-respect des procédures de même que son comportement agressif et violent. Le 13 février 2006, la plaignante aurait traité de façon inappropriée deux appels d'une même personne. L'employeur allègue que cette erreur, qui a privé celle-ci des soins d'un premier répondant, aurait pu entraîner de graves conséquences. Par ailleurs, il soutient que le congédiement est de nature non disciplinaire, ou à tout le moins mixte, et qu'il est l'aboutissement d'un processus relié à la qualité des services offerts, soit une démarche administrative. Le syndicat prétend que le congédiement doit être qualifié de disciplinaire puisqu'il concerne l'évaluation de la qualité de travail et il conteste la sévérité des mesures imposées le 11 juillet ainsi que le 30 août 2005.
Décision
En ce qui a trait à la suspension du 11 juillet 2005, les exigences procédurales prévues à la convention collective ont été respectées, et le comportement inapproprié de la plaignante le 28 juin constitue un manquement à son obligation de retenue ou de civilité. Les nouvelles exigences de l'employeur, notamment en ce qui a trait à la signature du registre, ne sont pas excessives ou déraisonnables. Quant à l'incident du 30 juin, la plaignante a tenu des propos inappropriés à l'égard d'une entreprise avec laquelle l'employeur faisait affaire, en violation de ce que prescrit le guide, soit de la maîtrise sur le plan émotif et de la retenue. Par contre, on ne peut conclure qu'elle s'est livrée à une critique de l'employeur. De même, les reproches portant sur le comportement agressif de la plaignante ce jour-là ne sont pas retenus, la preuve étant trop vague. Il en va de même du reproche en ce qui a trait aux retards, la preuve de l'employeur s'étant limitée à la production d'un avis verbal ne permettant pas de connaître les dates des manquements. Enfin, le reproche quant aux commentaires écrits de la plaignante sur les demandes de correction aux cartes d'appels est rejeté faute de preuve. Compte tenu du fait que l'employeur n'a pas invoqué le dossier antérieur pour expliquer la sévérité de la sanction et que certains reproches n'ont pas été retenus, une suspension de trois jours est substituée à celle de cinq jours.
En ce qui a trait aux retards, à l'exception d'un seul, tous sont survenus dans le délai prescrit à la convention collective, et l'employeur a démontré leur importance compte tenu de la nature de l'emploi et du fait que le guide prescrivait de se présenter 10 minutes avant le début de la relève. La jurisprudence reconnaît d'ailleurs qu'un retard de quelques minutes, même s'il est attribuable à un événement complètement indépendant de la volonté de l'employé, peut être à l'origine d'une suspension. Quant à la collaboration de la travailleuse à la préparation de fausses cartes d'appels servant à évaluer la charge de travail, il s'agit d'une faute grave. Par contre, bien qu'elle ait fait usage d'un langage abusif, contrevenant ainsi au guide, qui prescrit une conduite irréprochable, on ne peut retenir ce reproche puisque l'employeur a donné à l'incident une importance plus grande qu'au moment des événements. Quant au reproche concernant la signature inadéquate du registre, il n'est pas soutenu par la preuve. Enfin, les accès de colère du 16 et du 17 août ne sont pas retenus puisque ce n'est que le 30 août suivant que l'employeur y a réagi. Ainsi, compte tenu de l'ensemble du dossier chargé de la plaignante et de son attitude négative, une suspension de 15 jours est indiquée.
Pour ce qui est du congédiement, sa nature doit d'abord être déterminée, soit disciplinaire ou non disciplinaire, puisque cette qualification a une incidence sur la preuve. En l'espèce, le congédiement a été imposé pour des raisons non disciplinaires même si la lettre qui le confirme a des allures de mesures disciplinaires par son contenu. La plaignante était incapable d'accomplir son travail selon les règles établies en juin 2004. Elle ne parvenait pas à intégrer celles-ci ni à les appliquer de façon constante, uniforme et habituelle malgré tout le soutien et la formation dont elle a fait l'objet. Rien ne permet de conclure qu'elle refusait d'appliquer ces règles ou de s'y plier. Bien que la preuve ne permette pas de conclure qu'elle a été informée d'une façon expresse des attentes de l'employeur, elle connaissait celles-ci. Par ailleurs, sa prétention voulant qu'elle n'ait pas compris qu'elle était tenue à des normes élevées et à un usage rigoureux du système de répartition est inconciliable avec l'homologation et la formation dont elle a bénéficié, la nature de son travail ainsi que celle des activités de l'employeur. La prétention du syndicat selon laquelle elle ne savait pas que son emploi était en péril avant l'incident du 13 février est également rejetée. Il est inconcevable qu'elle n'ait pas eu conscience qu'une erreur importante, confirmant les difficultés qu'elle avait avec le système de répartition et son usage, était susceptible d'entraîner la perte de son emploi. Or, l'erreur survenue à cette date était grave, et elle a entraîné des conséquences importantes. L'employeur a été de bonne foi; il était raisonnable de mettre un terme à l'emploi de la plaignante.
Syndicat des travailleurs industriels unis du Québec, conseil de district 2006, section locale 911 et Centre de communication santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec (Denise Courtois), SOQUIJ AZ-50468476
Manquement à un règlement d’entreprise
Malgré neuf avertissements écrits et une suspension de trois jours, la plaignante — une caissière — a continué à déroger aux procédures de caisse; dans les circonstances, l'employeur était fondé à la congédier sans appliquer la règle de la progression des sanctions.
La plaignante, une caissière, a été congédiée pour avoir modifié le prix d'un article en invoquant une erreur de prix sans obtenir préalablement l'autorisation du gérant. L'employeur soutient qu'elle a contrevenu aux directives relatives aux caisses. Selon lui, il s'agit d'une récidive d'un manquement similaire. Il souligne que, malgré le peu d'ancienneté de la plaignante, son dossier disciplinaire comporte de nombreux avertissements écrits et une suspension de trois jours pour diverses manifestations de désobéissance ou de refus de se conformer aux directives reçues. Il allègue que, à la suite du dernier incident, il était manifeste que la plaignante n'amendait pas son comportement malgré les nombreux avis disciplinaires. Il a donc décidé de la congédier. Le syndicat invoque la clause d'amnistie prévue à la convention collective et prétend que l'employeur ne pouvait invoquer les mesures disciplinaires imposées à la plaignante par le passé. Il ajoute que l'employeur a contrevenu à la règle de la progression des sanctions en imposant un congédiement sans d'abord imposer une longue suspension.
Décision
La clause d'amnistie prévue à la convention collective énonce que l'employeur ne tiendra pas compte des infractions passées si, depuis leur occurrence, l'employé a travaillé pendant 12 mois dans le cas d'une suspension ou pendant 6 mois dans le cas d'une réprimande écrite sans autre mesure disciplinaire de même nature. L'expression « de même nature » fait référence à des traits essentiels qui sont similaires. En l'espèce, la clause ne s'applique pas à la situation de la plaignante, compte tenu du délai entre les mesures disciplinaires de même nature. Relativement à l'application du principe de la progression des sanctions, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que ce principe est tempéré par certaines exceptions, notamment lorsque la faute commise est d'une gravité telle que le lien de confiance est irrémédiablement rompu et que la rationalité de cette rupture a été établie à la satisfaction du tribunal. C'est également le cas lorsqu'il est devenu manifeste, après considération du dossier disciplinaire du salarié, de ses multiples manquements répétés à la discipline, aux directives et aux exigences indiquées et de son indifférence à l'égard de toutes les mesures disciplinaires qui lui ont été imposées, qu'il ne veut pas s'amender ou en est incapable et qu'une nouvelle mesure disciplinaire moindre que le congédiement ne fera que retarder inutilement l'inéluctable. En l'espèce, en 21 mois d'emploi, la plaignante a reçu au moins 1 avertissement verbal, 9 avertissements écrits et 1 suspension de 3 jours. En dépit de cette dernière mesure disciplinaire et de la mise en garde qui lui avait alors été faite selon laquelle, en l'absence d'une amélioration, elle allait être congédiée, elle a néanmoins récidivé deux mois plus tard en se rendant coupable d'un autre manquement aux procédures de caisse identique à celui qui lui avait valu cette suspension et cette mise en garde, soit une modification de prix sans l'autorisation d'un gérant. Dans ce contexte, l'imposition du congédiement respectait le principe de la progression des sanctions. Par ailleurs, il n'appartient pas à l'arbitre d'imposer à l'employeur une obligation de clémence, et la preuve a démontré que ce dernier avait des raisons très sérieuses de croire qu'il était inutile de donner à la plaignante une nouvelle chance de corriger son comportement déviant. Le congédiement est donc maintenu.
Syndicat des métallos, section locale 7065 et Entreprises D.L. Léger (Canadian Tire), (Nancy Levasseur), SOQUIJ AZ-50504057
En omettant de cadenasser la trancheuse à pain avant de procéder au nettoyage de l'appareil, le plaignant a mis en péril sa propre sécurité; cet accroc aux directives justifiait la mesure imposée par l'employeur, soit une suspension de trois jours.
Le plaignant, un opérateur de four dans une boulangerie industrielle, a été suspendu trois jours pour avoir omis de cadenasser sa trancheuse à pain avant d'y effectuer un nettoyage. L'employeur soutient que ce dernier a compromis sa sécurité et celle de ses collègues en plus de contrevenir à sa directive relative à la procédure de cadenassage. Le syndicat prétend que la suspension de trois jours constitue une mesure trop sévère qui ne respecte pas le principe de la progression des sanctions. Il ajoute que l'employeur a contrevenu à la règle interdisant la double sanction en renvoyant le plaignant chez lui le jour de l'incident et en le suspendant le lendemain. Enfin, il aurait contrevenu à la procédure disciplinaire en tenant une rencontre disciplinaire avec le plaignant sans la présence d'un représentant syndical.
Décision
Les moyens préliminaires du syndicat sont rejetés. Le plaignant n'a pas fait l'objet d'une double sanction puisque la décision de le renvoyer chez lui le jour de l'incident équivalait plutôt à une suspension aux fins d'une enquête. Par la suite, l'employeur a rencontré le plaignant en présence d'un représentant syndical afin de lui imposer la mesure disciplinaire.
Quant au fond, le témoin de l'employeur et le plaignant ont offert deux témoignages contradictoires. Or, le témoignage du plaignant n'est pas crédible. Il a lui-même admis ne pas avoir procédé au cadenassage de la trancheuse à pain. Il est clair que le plaignant ne reconnaît pas la gravité de sa faute et fait preuve d'un aveuglement volontaire quant au fait d'avoir sérieusement compromis sa sécurité et celle de ses collègues. Les cinq années d'ancienneté du plaignant constituent une circonstance aggravante. Celui-ci connaissait les exigences du cadenassage et ses objectifs. Il a cependant délibérément choisi de ne pas s'y soumettre. La faute était suffisamment grave pour justifier une suspension de trois jours.
Boulangerie Gadoua ltée et Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 (TUAC), (Daniel Tremblay), SOQUIJ AZ-50504686
La nature des fautes commises par le plaignant — qui occupait des fonctions de technicien en informatique dans une commission scolaire —, soit la surveillance d'un collègue à son insu au moyen d'une webcaméra, le téléchargement d'une centaine de vidéos pornographiques avec le matériel de l'employeur et leur caractère fortement répréhensible, le tout conjugué à ses réponses évasives et mensongères, justifie son congédiement.
Le plaignant occupait un poste de technicien en informatique dans une commission scolaire. Il travaillait dans un centre de formation pour adultes où des cours de niveau secondaire et d'éducation populaire sont donnés. Le 1er juin 2005, il s'est absenté pour des raisons médicales, mais il n'a pas dit à l'employeur qu'il souffrait d'une dépression et n'a pas remis d'attestation médicale. Au mois de septembre suivant, en dehors des heures de travail et alors qu'il s'agissait d'un jour férié, il a installé un cadenas sur l'ordinateur qu'il utilisait pour ses fonctions afin d'empêcher que l'on puisse l'ouvrir. En partant, il a emporté une webcaméra et une rallonge électrique appartenant à l'employeur de même qu'une bonbonne d'air comprimé. Dans les jours suivants, son remplaçant a communiqué avec lui par courriel parce qu'il avait besoin d'utiliser l'ordinateur qui avait été cadenassé. Le plaignant l'a alors avisé dans un message de trouver une autre solution. Le remplaçant a fait écouter ce message à son supérieur, qui, après vérification, a constaté qu'il y avait un système de réseau sans fil au bureau du plaignant et que son ordinateur contenait du matériel pornographique juvénile et adulte. Le supérieur a également visionné les images captées par la caméra de surveillance le 5 septembre et y a aperçu le plaignant circuler dans les locaux et en ressortir des objets à la main. Une convocation aux fins d'une enquête a été fixée au 14 septembre suivant afin de permettre au plaignant de donner sa version des faits. L'employeur lui reprochait d'avoir téléchargé du matériel pornographique durant ses heures de travail, d'avoir utilisé du matériel informatique appartenant à la Commission scolaire à cette fin, d'avoir utilisé et installé sans permission le logiciel LimeWire et, par le fait même, d'avoir permis à d'autres utilisateurs de récupérer ce matériel pornographique. De plus, il lui a demandé de rapporter tous les biens lui appartenant qui étaient en sa possession. Lors de cette réunion, le plaignant a commencé par nier les faits, puis en a admis certains. Il a ajouté avoir surveillé son remplaçant à l'aide de la webcaméra. Immédiatement après cette rencontre, il a remis les biens qu'il avait pris. Le 21 septembre suivant, l'employeur l'a congédié.
Décision
Même si la preuve établit que le plaignant a pris du matériel appartenant à l'employeur sans autorisation, on ne peut conclure qu'il l'a volé ou qu'il avait l'intention de le faire. En effet, les techniciens en informatique pouvaient sortir du matériel de bureau sans autorisation aux fins de leur travail. Par contre, la prétention du syndicat selon laquelle le plaignant voulait faire des tests relativement à de la formation à distance ne peut être retenue. Ce dernier n'avait reçu aucune directive à cet effet et il était en congé de maladie. En ce qui concerne la bonbonne d'air comprimé, on ne peut conclure qu'elle appartenait au plaignant ni qu'elle avait une certaine utilité pour son travail. Ainsi, il a emprunté ce matériel à ses fins personnelles. Toutefois, le congédiement pour ce motif n'est pas retenu.
En ce qui a trait aux autres faits reprochés par l'employeur lors de l'enquête du 14 septembre, les témoignages ne concordent pas pour ce qui est des réactions du plaignant. Ce dernier allègue qu'il est faux de dire qu'il a tout nié, alors que les personnes assistant à cette rencontre prétendent le contraire. En présence de versions contradictoires, l'examen doit être fait en utilisant le critère de la vraisemblance. Or, la version du plaignant est peu crédible. Il a d'abord tout nié et, après avoir été informé par son représentant syndical de la preuve détenue par l'employeur, il a avoué qu'il avait téléchargé des films pornographiques et surveillé, par webcaméra, son remplaçant. Un autre critère retenu par la jurisprudence pour évaluer la preuve testimoniale est la constance dans les déclarations. En l'espèce, les déclarations du plaignant ont souvent varié, à des dates différentes, et ce, quant à l'ensemble de son témoignage. Il est donc établi que celui-ci a installé la webcaméra afin de surveiller son remplaçant. De plus, la raison qu'il invoque pour avoir installé le logiciel LimeWire, soit dans le but d'effectuer des essais visant la formation à distance, n'est pas retenue. Il est plus plausible qu'il ait réservé l'ordinateur à ses propres fins pour communiquer avec des sites de rencontres et que le logiciel ait été installé pour télécharger du matériel pornographique. En effet, il a téléchargé plus de 60 films pornographiques, en a effacé 6, 38 films étaient en cours de téléchargement et l'ordinateur contenait 21 images pornographiques. Même si l'on ne peut conclure que le téléchargement a eu lieu durant les heures de travail, le plaignant a admis en avoir regardé le contenu sur les lieux du travail. Or, il savait qu'une telle conduite, fortement répréhensible, allait à l'encontre d'une politique de l'employeur qui lui avait été expliquée. Il a tenté de démontrer, par une expertise en psychiatrie, qu'il avait des problèmes psychologiques à cette époque. Les tribunaux d'arbitrage hésitent fortement à accepter des expertises non concomitantes des événements. En l'espèce, la prudence s'impose, d'autant plus que le plaignant a menti dans son témoignage et que l'expert affirme qu'il est possible que celui-ci ait amplifié ses symptômes. Ainsi, les fautes commises sont retenues et, selon la jurisprudence, le téléchargement de vidéos pornographiques à l'aide du matériel de l'employeur, leur transmission à des collègues ou à d'autres personnes de même que leur visionnement sur les lieux du travail doivent être sanctionnés sévèrement. Chaque cas est un cas d'espèce et l'on doit tenir compte de divers facteurs, tels l'aveu, les témoignages de bonne foi, la sincérité, le milieu où se produisent les fautes et l'état psychologique. En l'espèce, le plaignant a nié les faits, a omis de répondre avec sincérité aux questions posées en multipliant les réponses évasives, s'est contredit et a menti au Tribunal. L'employeur était fondé à affirmer qu'il y a eu rupture du lien de confiance et, étant donné toutes les circonstances, l'on ne peut tenir compte du fait que le plaignant pourrait avoir de la difficulté à trouver un autre emploi en raison de son âge ni de ses 18 années de service. Le congédiement est donc confirmé.
Syndicat du personnel de soutien de la Seigneurie des Mille-Îles (CSN) et Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (Louis Marchand), SOQUIJ AZ-50468456
Le congédiement d'un technicien ambulancier non disponible pendant 1 heure alors qu'il était en horaire « de faction » de 24 heures est confirmé; possédant 22 ans d'expérience, il ne pouvait ignorer qu'un appel urgent peut se produire à tout moment.
En janvier 2001, le plaignant, un technicien ambulancier, a été congédié pour ne pas avoir été disponible durant la dernière heure de sa faction. Une première sentence arbitrale a annulé la sanction et a ordonné sa réintégration. Cette décision a fait l'objet d'une requête en révision judiciaire, qui a été accueillie par la Cour supérieure. La Cour d'appel a maintenu cette décision, mais en a modifié l'une des conclusions et a retourné le dossier à un nouvel arbitre afin de déterminer si le congédiement du plaignant était la sanction appropriée et, dans le cas contraire, d'y substituer celle qui convient. Le 20 septembre 2005, le présent tribunal a rendu une décision interlocutoire sur l'étendue de la preuve qui serait recevable, soit toute preuve pertinente permettant de déterminer si la sanction imposée était appropriée. Lors de l'audience sur le fond, l'employeur s'est opposé à la présentation de l'ensemble de la preuve, faisant valoir qu'elle devait se limiter aux seuls éléments permettant de déterminer si la sanction imposée était appropriée puisque la Cour supérieure avait déjà, à partir de la première sentence arbitrale, déterminé les faits établissant que la faute du plaignant était prouvée et qu'elle était grave.
Décision
L'objection de l'employeur est rejetée. En effet, pour juger si la sanction était appropriée, il est nécessaire de déterminer le degré de gravité de la faute, ne serait-ce que pour décider si le principe de la progression des sanctions doit s'appliquer. Quant au fond, le plaignant a fait valoir divers facteurs atténuants. Ainsi, il a prétendu croire que son quart de travail se terminait à 8 h. Cela ne peut toutefois pas être considéré comme un facteur atténuant, mais plutôt comme une tentative de faire changer la réponse à la question de savoir s'il avait commis une faute, ce dont la Cour d'appel a décidé. En ce qui a trait au contexte particulier de la municipalité où l'intervention des ambulanciers était requise, cela n'a rien à voir avec le fait que le plaignant n'était pas disponible pendant la dernière heure de sa faction. En ce qui concerne le fait que le centre de répartition n'a pas tenté de le joindre au moyen de son téléphone cellulaire, il relevait plutôt de sa responsabilité de confirmer qu'il ne pouvait être joint autrement et de fournir son numéro de téléphone cellulaire. Le plaignant a également invoqué le fait que l'état de santé du bébé pour lequel l'ambulance avait été appelée n'avait pas été compromis par le délai de réponse et que l'employeur n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires. Or, l'absence de conséquences peut être considérée comme un facteur atténuant à la faute, laquelle était l'absence de disponibilité du plaignant pour répondre à un appel urgent. Quant au climat de tension entre ce dernier et l'employeur — qui l'aurait autorisé à ne pas se rendre à une rencontre afin de fournir sa version des faits —, il ne saurait être considéré comme un facteur atténuant. En effet, cette rencontre était importante, voire vitale, pour l'emploi du plaignant et, en ne fournissant pas les explications requises, il a été l'artisan de son propre malheur. Pour ce qui est d'une déclaration écrite qui aurait été rédigée par son épouse, ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas signée qu'elle ne constitue pas une déclaration du plaignant, d'autant moins qu'elle n'a pu être rédigée qu'à la suite d'une narration des événements par ce dernier. Ce fait ne peut donc être considéré comme un facteur atténuant. En ce qui concerne les 22 années d'ancienneté du plaignant, cela constitue plutôt un facteur aggravant puisqu'il ne pouvait ignorer qu'en se rendant non disponible sans aviser il courait un risque très élevé, d'autant que cela est inconciliable avec l'obligation d'un technicien ambulancier de répondre aux appels pendant sa période de disponibilité. Enfin, le plaignant a fait valoir que son dossier disciplinaire était vierge, et que l'employeur n'a pas appliqué le principe de la progression des sanctions. Or, lorsqu'une faute est intrinsèquement grave, ce principe peut être écarté. L'employeur a, pour sa part, invoqué certains facteurs aggravants. Ainsi, le plaignant avait un rôle important à jouer à titre d'ambulancier au regard de la santé et de la sécurité du public. Toutefois, le lien de confiance n'a pas été rompu uniquement en raison de son absence, mais aussi à cause de son refus de collaborer à l'enquête. En outre, six ans après le fait, et malgré les propos tenus par la Cour supérieure et par la Cour d'appel, il persiste à dire qu'il n'a pas commis de faute. Il n'a jamais manifesté de regrets ou de remords. Or, ce dernier facteur aggravant permet, à lui seul, de confirmer la décision de l'employeur. Aucune mesure corrective ne permettrait la réhabilitation du plaignant.
Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) et Ambulance Montcalm inc. (René Robitaille), SOQUIJ AZ-50423352
Le congédiement imposé à un chauffeur de camion pour avoir, afin de toucher un minime supplément de rémunération, faussé la quantité chargée dans la citerne qu'il devait remorquer pour livraison est confirmé; la préméditation, l'incidence pour les clients, le système de rémunération basé en partie sur le lien de confiance et la politique de « tolérance zéro » sont, notamment, des facteurs aggravants.
Le plaignant travaillait à titre de chauffeur de camion-citerne pour l'employeur, une entreprise de produits laitiers. Il conteste la suspension provisoire puis le congédiement qui lui ont été imposés pour avoir faussé la quantité du chargement qu'il devait livrer chez un client afin de toucher un supplément de rémunération de 15 $. L'employeur explique que le chauffeur bénéficie d'un supplément de rémunération lorsqu'il transporte plus de 10 000 kilogrammes de produits. Il affirme que le plaignant a falsifié le bordereau de livraison en modifiant la quantité chargée de 9 490 kilogrammes à 10 490 kilogrammes de façon à bénéficier de la prime. Selon lui, le plaignant a commis une fraude qui rompt le lien de confiance. Il souligne que celui-ci a admis au cours de l'enquête avoir commis la faute reprochée. De plus, il invoque de nombreux facteurs aggravants justifiant le maintien du congédiement et sa politique de « tolérance zéro » en matière de fraude. Le syndicat fait valoir qu'il s'agissait d'un incident isolé et mentionne que le travail du salarié a été irréprochable au cours de ses cinq années de service.
Décision
Le plaignant a admis avoir modifié le bordereau de livraison afin de bénéficier du supplément de rémunération. Il est probable qu'il s'agissait d'un premier incident puisque de nombreuses circonstances devaient être réunies afin qu'il soit tenté de procéder à une telle manoeuvre. En effet, il fallait que le compteur du destinataire soit défectueux, que cette défectuosité soit connue du chauffeur, que celui-ci n'ait pas à passer à la pesée sur sa route et que le chargement soit partiel et près du niveau d'un chargement ordinaire. Or, il est justement troublant que le plaignant ait saisi cette occasion unique pour commettre sa falsification. Il est clair qu'il s'agissait d'une fraude compromettant sérieusement le lien de confiance. Le syndicat a invoqué certaines circonstances atténuantes : le bénéfice modeste, le geste apparemment isolé, l'omission de l'employeur de communiquer officiellement sa politique de « tolérance zéro », l'aveu, les regrets, la collaboration, le dossier vierge et la qualité du travail. L'on pourrait y ajouter les conséquences douloureuses sur sa vie familiale. Par contre, d'autres facteurs augmentent la gravité de la faute et jouent sur la sévérité de la sanction : la préméditation, les conséquences pour les clients de l'employeur, l'absence de supervision directe du travail de camionneur, un système de rémunération basé partiellement sur la confiance envers le salarié, la faible ancienneté et la politique de « tolérance zéro ». La jurisprudence arbitrale établit que le Tribunal doit hésiter à intervenir dans l'appréciation de la gravité de la faute par celui qui est victime de la fraude ou du vol. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, les griefs sont rejetés.
Syndicat des salariées et salariés de Beaudry-Lacoste et Agropur, coopérative agro-alimentaire (Beaudry & Lacoste), (Éric Davignon), SOQUIJ AZ-50502560
L'employeur — un casino — ne peut tolérer un manquement à la directive concernant les pourboires de la part d'un agent de sécurité, et le congédiement est justifié; c'est à lui qu'il se fie pour faire respecter les directives par les autres employés et il doit donner à la clientèle une image sans faille de son intégrité.
L'employeur reproche au plaignant, un agent de sécurité au Casino de Montréal, d'avoir accepté le pourboire d'un client qu'il reconduisait à la sortie du Casino et d'avoir dissimulé ce fait. Il précise que le plaignant a signé, lors de son engagement, un serment dans lequel il s'engageait à ne recevoir aucune somme d'argent ou considération quelconque de la clientèle. Le manuel de l'employé, que le plaignant reconnaît avoir reçu et s'être engagé à respecter, prévoit aussi l'interdiction d'accepter un pourboire. L'employeur allègue que les agissements du plaignant ont rompu le lien de confiance. Il ajoute que l'agent de sécurité doit faire preuve d'une intégrité sans faille en raison de la nature de ses fonctions.
Décision
Les témoignages entendus et la preuve vidéo révèlent clairement que le plaignant a reçu un pourboire d'un client. Le plaignant a reconnu qu'il n'est pas autorisé à accepter un tel pourboire. Lorsqu'il reçoit une telle somme, il doit en aviser l'employeur et la déposer dans une boîte prévue à cet effet. En l'espèce, le plaignant n'a pas refusé le geste du client, qui a glissé un billet de 10 $ dans la poche de son veston, ou n'a pas résisté. Par ailleurs, ses agissements dans les heures qui ont suivi la réception du pourboire ne laissent aucun doute quant à volonté de dissimuler ce fait par l'utilisation d'un stratagème. Il s'agit là de circonstances aggravantes. Au surplus, le plaignant n'a pas reconnu sa faute et n'a manifesté aucun regret d'avoir commis les gestes reprochés, offrant un témoignage contradictoire et incompatible avec la preuve vidéo. L'employeur exploite un casino et une telle entreprise repose sur la confiance qu'il doit avoir envers ses salariés. Il en va de la préservation de son image d'entreprise. L'employeur ne pouvait plus faire confiance au plaignant pour appliquer ses diverses directives. Compte tenu de la rupture du lien de confiance, le congédiement est maintenu.
Société des casinos du Québec inc. et Syndicat des employées et employés de la Société des casinos du Québec (CSN), (Adélard Hubert), SOQUIJ AZ-50499414
Malgré la politique de l'employeur et les règles d'éthique prohibant l'utilisation d'Internet à des fins personnelles durant les heures de travail, le plaignant — un employé de la fonction publique — naviguait de 4 à 13 fois par jour; la suspension de 5 jours était justifiée.
Le plaignant est agent d'aide socio-économique depuis 1999. Il jouit d'une grande autonomie dans son travail. En janvier 2005, il a été suspendu durant 1 journée pour avoir effectué un peu plus de 23 heures de navigation sur Internet à des fins personnelles pendant les heures de travail. Le 25 octobre 2006, lors d'une réunion d'équipe, l'employeur a affirmé qu'il tolérait 10 minutes de socialisation au début de la journée et il a rappelé qu'il était interdit de faire un usage personnel d'Internet et du courrier électronique. Le 4 mai 2007, le plaignant a été suspendu pendant 5 jours pour avoir navigué sur Internet à des fins personnelles, et ce, pendant 293 sessions totalisant environ 17 heures réparties sur 39 jours, pour avoir reçu des courriels personnels dont certains étaient accompagnés de pièces jointes comportant des images à caractère sexuel et pornographique, et pour avoir utilisé les outils informatiques de l'employeur afin d'exercer des activités reliées à son travail d'agent de voyages.
Décision
Ni la période de 10 minutes de socialisation tolérée par l'employeur au début de la journée ni les pauses ne peuvent être utilisées pour naviguer sur Internet à des fins personnelles. En effet, ainsi que l'énonce le règlement d'entreprise, l'utilisation du réseau Internet à des fins personnelles n'est pas permise. Il y est indiqué que seule une utilisation personnelle limitée pourra être tolérée. De plus, lors de la réunion du 25 octobre 2006, l'employeur a fait différents rappels relativement à l'utilisation du temps de travail. La navigation du plaignant sur Internet à des fins personnelles durant environ 17 heures réparties sur 39 jours dépasse nettement l'utilisation personnelle tolérée par l'employeur et mérite une sanction disciplinaire. D'autre part, le plaignant savait que la réception au bureau de courriels personnels dont certains étaient accompagnés d'images à caractère sexuel et pornographique était inappropriée. Il aurait pu les détruire, mais il les a ouverts et a envoyé les fichiers à son adresse électronique personnelle, conservant le tout dans le système informatique de l'entreprise. Ce type d'usage du matériel informatique ne pouvait être toléré par l'employeur. Le plaignant a également commis une faute en utilisant ce matériel afin d'exercer des activités personnelles d'agent de voyages. L'autonomie dont il bénéficie dans son travail, la répétition des gestes, la récidive après le premier reproche et le fait qu'il banalise son utilisation personnelle d'Internet et du courrier électronique sont des facteurs aggravants. Il n'existe aucun facteur atténuant qui permettrait de réduire la sanction.
Syndicat de la fonction publique du Québec - Fonctionnaires et Québec (ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale), (Joël Crevier), SOQUIJ AZ-50500581
Le congédiement imposé à un technicien en informatique pour avoir effectué de nombreux appels interurbains durant ses heures de travail et pour avoir quitté l'établissement sans avoir sécurisé l'accès à des données confidentielles est confirmé.
Le plaignant a été embauché en 2000 à titre de technicien en informatique. Il était appelé à travailler deux jours par semaine dans les locaux de l'employeur et trois jours chez certains clients à qui ce dernier fournit des services. Le 28 septembre 2006, il a été suspendu aux fins d'une enquête puis, le 20 octobre, il a été congédié pour vol de temps, fraude et négligence. L'employeur soutient que son enquête a démontré, notamment, que le plaignant avait effectué plus de 3 300 minutes d'appels interurbains personnels pendant une période de 76 jours de travail, ainsi qu'une vingtaine d'appels (totalisant 89 minutes) chez l'un de ses clients. Il lui reproche également de ne pas avoir répondu à trois appels de service et d'avoir laissé l'accès aux fichiers des patients d'un client non sécurisé à la suite d'un transfert de serveur. Le plaignant aurait en outre omis de régler ce problème, contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire, et serait parti en vacances sans informer son chef d'équipe du travail qu'il restait à exécuter.
Décision
La suspension imposée pour effectuer l'enquête n'avait rien de précipité ou de déraisonnable compte tenu de l’information recueillie, de la nature des manquements en cause et de la nécessité de vérifier la version du plaignant. Le grief à l'encontre de cette mesure est donc rejeté. Quant aux autres manquements, ils ont été prouvés de façon prépondérante et les explications fournies par le plaignant ont été contredites ou non corroborées par une preuve crédible. La fréquence et la durée des appels interurbains permettent même de conclure à du vol de temps. D'autre part, ces appels ont souvent coïncidé avec l'absence de prise en charge de demandes de soutien, parfois hautement prioritaires, qui incombaient au plaignant. Par ailleurs, il est possible de relier l'incident des répertoires non sécurisés chez un client au départ précipité du plaignant en vacances ou, à tout le moins, à une négligence de sa part dans les heures précédant ce départ. Celui-ci a tenté de minimiser la gravité de ses négligences en soulignant qu'elles n'avaient entraîné aucun dommage. Or, il a fallu que d'autres employés effectuent le travail ou que l'on intervienne directement auprès de lui pour qu'il s'occupe des demandes de prise en charge. Ainsi, dans l'ensemble, les fautes du plaignant dénotent un manque d'honnêteté, de la négligence, un non-respect délibéré des politiques et procédures, ou une combinaison de ces comportements. L'inexpérience ou la fatigue invoquées dans certains cas ne constituent pas des excuses valables. De plus, l'on ne peut retenir comme circonstance atténuante l'aveu du plaignant quant aux appels interurbains dans le contexte de l'enquête patronale ni sa proposition de remboursement. Par ailleurs, même si aucun des manquements mettant en cause la négligence du plaignant dans l'exécution de son travail ne justifie à lui seul un congédiement, leur répétition constitue un facteur aggravant. En outre, celui-ci a fourni sciemment des explications fausses ou non pertinentes, ce qui constitue un autre facteur aggravant. C'est donc à juste titre que l'employeur a considéré qu'il pouvait difficilement se fier à l'honnêteté et à la conscience professionnelle du plaignant.
Syndicat des employées et employés de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides - CSN et Agence de développement des RLSSS des Laurentides (Ariel Augustin), SOQUIJ AZ-50493336
COMMENT TROUVER LES DÉCISIONS MENTIONNÉES DANS CET ARTICLE?
- Accéder au site Internet Azimut de SOQUIJ
- Sélectionner la banque Juris.doc.
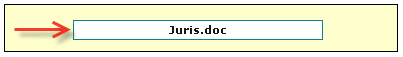 |
- Entrer votre code d'accès et votre mot de passe.
COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE?
Deux façons s'offrent à vous, d'abord :
- Chacune des décisions mentionnées dans cet article a une référence AZ (par exemple AZ-50493336). Pour retrouver cette décision, il faut :
- accéder à l’écran Choix de banque de Juris.doc;
- utiliser la case de recherche par référence AZ;
- cliquer sur
.
- accéder à l’écran Choix de banque de Juris.doc;
- Pour effectuer une recherche portant sur le vol en milieu de travail, il faut :
- accéder à l’écran de recherche par Mots clés de la banque Juridictions en relations du travail;
- effectuer votre recherche à l’aide du Plan de classification annoté;
- éclater la rubrique Travail;
- ensuite, vous devez également éclater les sous-rubriques Grief et Mesure disciplinaire ou non disciplinaire;
- lancer la recherche en cliquant sur la sous-rubrique Formalités issues de la jurisprudence;
- pour compléter votre recherche, vous pouvez raffiner celle-ci à l’écran Mots clés en cliquant sur le bouton RAFFINER PAR MOTS CLÉS;
- exécuter la recherche à l’aide du bouton RECHERCHER.
- accéder à l’écran de recherche par Mots clés de la banque Juridictions en relations du travail;
Pour toute question relative à l'utilisation d'AZIMUT, Documentation juridique, communiquez avec le Service d'aide aux utilisateurs au 514 842-AIDE ou, sans frais, au 1 800 356-AIDE, de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi.
Monique Desrosiers, avocate, Coordonnatrice, Secteur droit du travail et droit social, Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
Source : VigieRT, numéro 30, septembre 2008.