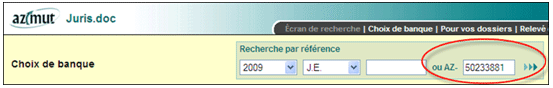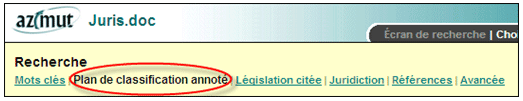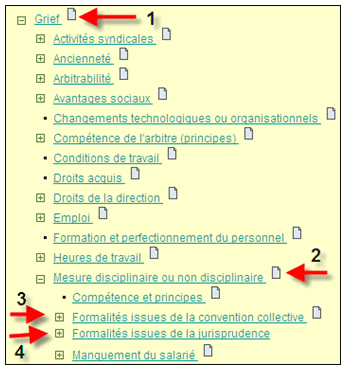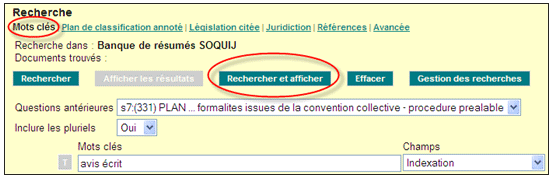Une étape essentielle dans la progression des mesures.
Tant les conventions collectives que la jurisprudence arbitrale prévoient des règles qui encadrent le processus de « discipline » des employés syndiqués.
La discipline progressive a pour but de permettre au salarié fautif de s'amender avant qu'on lui impose la « peine capitale », soit le congédiement. Le principe de la progression des sanctions implique généralement que l'employeur procède de la façon suivante : un avis verbal, un avis écrit, une courte suspension, une suspension de longue durée et, finalement, un congédiement. Cette séquence ne s'applique toutefois pas à toutes les situations. La règle de la progression n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’une faute grave.
L'employeur doit aussi respecter certaines étapes avant d'imposer une mesure disciplinaire. En règle générale, ces étapes sont définies dans la convention collective. Il peut s'agir, par exemple, de la transmission d'un avis écrit au salarié lui indiquant les motifs justifiant la sanction. Certaines conventions prévoient que l'avis doit être transmis en présence d'un représentant syndical ou que l'imposition de la sanction doit être précédée d'une rencontre avec le représentant. Le non-respect des formalités prescrites par la convention entraîne généralement l’annulation de la sanction.
La convention collective peut également prévoir une « clause d’amnistie ». Ce type de clause prévoit qu'une mesure disciplinaire doit être retirée du dossier du salarié au terme d'une période variant généralement de six mois à un an. Certaines conventions prévoient qu'en cas de récidive, le délai est plus long. Le retrait d'une mention disciplinaire du dossier signifie que l'employeur ne peut plus invoquer celle-ci contre le salarié, par exemple pour justifier une sanction en invoquant l'incident culminant.
Une décision récente illustre bien l’importance que l’arbitre de griefs accorde au respect de ces règles. La suspension d’un jour imposée au plaignant – qui en était à une troisième absence non motivée – a été annulée parce que l'employeur avait omis d'appliquer la progression des sanctions prévue à la convention collective. Selon l’arbitre, la sanction antérieure ne pouvait être qualifiée d'« avertissement écrit », puisqu'il s'agissait d'un avertissement verbal consigné par écrit au dossier.
Syndicat international des peintres et métiers connexes – travailleurs industriels, section locale 349A et Service Matrec inc. (Sous-division domestique), (Pierre Filion), SOQUIJ50502898.
Voici d’autres illustrations de l’application de ces règles.
Menu
|
Éléments dont l’employeur doit tenir compte
L'employeur doit tenir compte de la gravité de l'infraction commise ainsi que de toutes les circonstances de l'affaire plutôt que d'appliquer automatiquement la règle de la progression des sanctions.
Le plaignant, un journalier affecté à la collecte des ordures, conteste la décision de l'employeur de lui imposer une suspension de deux jours pour avoir commencé son travail avant l'heure prévue par une politique selon laquelle la collecte doit débuter à 19 h. L'employeur soutient que le plaignant a contrevenu à cette politique en commençant la collecte des ordures vers 18 h. Il a décidé de lui imposer une suspension de deux jours en application du principe de la progression des sanctions, son dossier disciplinaire comportant déjà une suspension d’un jour. Le plaignant admet qu'il a commencé avant 19 h. Il affirme qu'il a agi ainsi afin de changer les idées d'un collègue qui vivait une situation difficile à la suite du décès de son père. Le syndicat soutient que la suspension de deux jours constitue une mesure trop sévère compte tenu des circonstances.
Décision
Le plaignant a bel et bien commis le geste reproché; il admet d'ailleurs cette faute. Il s'agit cependant d'une faute mineure. Ce geste n'avait pas pour but de défier l'employeur, mais d'aider un collègue. Il est vrai que le dossier disciplinaire du plaignant comportait déjà une suspension d’un jour. Toutefois, avant d'appliquer le principe de la progression des sanctions, il faut prendre en considération la gravité de la faute et l'ensemble des circonstances. Le dossier disciplinaire constitue l'une de ces circonstances. En l'espèce, l'absence de gravité de la faute et l'absence d'intention de défier l'employeur constituaient des circonstances atténuantes qui justifiaient une sanction moins sévère. Une suspension d’un jour aurait permis au plaignant de comprendre que son comportement n'était pas approprié et qu’il ne devait plus se produire.
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 (SCFP) et Montréal (Ville de), (Stéphane George), SOQUIJ AZ-50376260
L'employeur n'avait pas à mettre en action le processus disciplinaire dès les premiers soupçons d'une conduite déviante; il pouvait attendre d'avoir une preuve concluante, mais devait agir dans le délai de 10 jours suivant sa connaissance acquise, prévu à la convention collective.
Le plaignant, un col bleu, a été suspendu puis congédié à la suite de trois avis d'infraction, datés des 22, 24 et 25 novembre 2005, faisant référence à des événements survenus du mois d'août au mois de novembre 2005. De façon préliminaire, le syndicat soutient que le plaignant ne peut recevoir de sanction pour des événements survenus en août et en septembre, puisque la convention collective prévoit que l'employeur doit aviser le salarié de l'imposition d'une mesure disciplinaire dans les 10 jours ouvrables suivant la prise de connaissance de l'infraction commise. L'employeur a acquis la connaissance des infractions reprochées au plaignant au plus tard le 22 septembre 2005, date à laquelle il a mis fin à la filature et à la surveillance du plaignant. Selon le syndicat, l'employeur ne pouvait imposer de sanction au plaignant pour les infractions survenues aux mois d'octobre et de novembre 2005, puisqu'il n'avait pas sanctionné en temps opportun les infractions de même nature survenues antérieurement. L'employeur soutient pour sa part qu'il a été informé le 17 novembre 2005 des infractions commises en octobre et en novembre de la même année.
Décision
En ce qui concerne les infractions qui seraient survenues aux mois d'août et de septembre 2005, le premier avis, daté du 22 novembre suivant, a été donné en dehors du délai de 10 jours suivant la prise de connaissance de ces infractions. Or, ce délai est de rigueur et il entraîne la nullité de la mesure en cas de non-respect. Toutefois, la connaissance de l'employeur doit être telle qu'il ne puisse subsister d'ambiguïté quant à l'interprétation des faits. La convention collective ne l'oblige pas à mettre en action le processus disciplinaire dès les premiers soupçons d'une conduite déviante. Cette preuve peut parfois consister en la répétition du même fait. En l'espèce, l'employeur ne peut imposer de sanction au plaignant pour des infractions survenues aux mois d'août et de septembre 2005. Quant à celles survenues aux mois d'octobre et de novembre suivants, elles ont été relevées dans le délai de 10 jours suivant leur connaissance, celle-ci ayant été acquise le 17 novembre. Le fait que l'employeur ne puisse imposer, à partir du 22 novembre 2005, de mesure disciplinaire en ce qui a trait à des infractions commises en août et en septembre ne l'empêche pas de le faire pour celles qui se sont produites par la suite. Enfin, il sera décidé à l'audience si les infractions qui ne peuvent être reprochées au plaignant en raison du non-respect du délai de 10 jours prévu à la convention collective peuvent être utilisées en preuve à titre d'élément de corroboration ou d'élément aggravant eu égard aux infractions subséquentes. Toutefois, il y a lieu de souligner que la convention prévoit que seules les mesures disciplinaires dont le salarié a été avisé par écrit peuvent être déposées en preuve.
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 et Montréal (Ville de), (Jean-Claude Bourdon), SOQUIJ AZ-50468612
La mesure imposée par l'employeur – une lettre informant la plaignante que le conseil municipal avait résolu de procéder à son congédiement – est déclarée nulle; cela ne correspond pas à l’obligation prévue à la convention collective de fournir un « exposé écrit » des motifs.
La plaignante occupe des fonctions de commis-magasinière pour une municipalité. Elle s'est vu imposer verbalement une suspension sans solde à compter du 17 août 2007 à l'occasion d'une rencontre avec l'employeur. Celui-ci lui a reproché d'avoir remis à sa mère un document confidentiel qui ne pouvait être obtenu qu'en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le 20 août, elle a été convoquée par lettre à une séance spéciale du conseil municipal. La lettre confirmait sa suspension « pour les motifs qui vous ont été exposés » et mentionnait qu'il serait recommandé aux conseillers municipaux de procéder à son congédiement. Quelques minutes avant la tenue de la séance du conseil, l'employeur lui a remis le rapport relatant les actes reprochés qu'il entendait présenter. Le 28 août, la plaignante a reçu une lettre l'informant que le conseil avait résolu de procéder à son congédiement, qu'elle avait contrevenu à son obligation de loyauté envers l'employeur et que le lien de confiance était rompu. La résolution du conseil était jointe à la lettre. Le syndicat fait valoir que la plaignante n'a pas reçu d'avis écrit pour la suspension ni d'écrit lui exposant les motifs de son congédiement, alors que la convention collective prévoit que « toute mesure disciplinaire doit faire l'objet d'un écrit adressé au salarié concerné et contenant l'exposé des motifs », et que cette mesure « est de rigueur à moins d'une entente écrite au contraire. Le défaut de s'y conformer rend la mesure disciplinaire nulle, non valide et illégale [...]. » Il affirme que la lettre du 28 août ne contient pas l'exposé des motifs et que le rapport présenté au conseil municipal aurait dû y être joint. Quant à l'employeur, il prétend que la plaignante savait ce qu'on lui reprochait et qu'elle a reçu copie du rapport plusieurs minutes avant la tenue du conseil.
Décision
La suspension du 17 août doit être annulée parce que la plaignante n'a jamais reçu d'avis écrit, contrairement aux dispositions de la convention collective, qui sont claires à cet égard. Quant au congédiement, l'employeur avait l'obligation de fournir un « exposé écrit » des motifs à la plaignante. Or, la lettre du 20 août ne fait que mentionner la rencontre au cours de laquelle la plaignante a été suspendue pour « les motifs qui vous ont été exposés ». Quant au rapport remis au conseil, il n'a pas été repris dans la lettre de congédiement. Ainsi, selon la définition d'« exposé écrit », l'employeur n'a pas respecté la convention collective. Étant donné que celle-ci contient une clause de nullité, il s'agit d'une condition de fond qui permet d'accueillir non seulement le moyen préliminaire, mais aussi les griefs. Ainsi, la suspension et le congédiement sont nuls, illégaux et invalides.
Malartic (Ville de) et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 335 (Marjolaine Boutin), SOQUIJ AZ-50478563
Un employeur ne peut, à la simple demande du ministère dont il relève, retirer un employé de ses fonctions sans tenir compte des principes applicables en matière de relations du travail et de la convention collective.
Le plaignant, un technicien en service de garde, travaille pour un centre de la petite enfance (CPE). Le jour des événements, la mère d'un enfant confié à l'employeur s'est présentée sur les lieux du travail afin de porter plainte contre le plaignant, alléguant qu'il avait fait preuve d'agressivité à l'endroit de son enfant. Aucun formulaire de plainte n'a alors été rempli. À la suite de cet entretien, la mère a quitté les lieux et a porté plainte auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Par la suite, l'employeur a reçu deux appels téléphoniques : le premier, de la part d'une représentante du ministère de la Famille et des Aînés, et le second, d'une représentante de la DPJ. Toutes deux lui ont demandé de retirer immédiatement le plaignant de ses fonctions, ce qu'il a fait. Tout le processus s'est déroulé en moins d'une heure et demie. Le plaignant a été accusé de voies de fait et a signé une promesse remise à un agent de la paix afin de pouvoir être mis en liberté, laquelle prévoyait notamment qu'il ne devait pas se trouver en présence de la présumée victime. L'employeur prétend qu'il n'avait aucun pouvoir sur la situation, que le plaignant n'avait plus le droit d'être en présence de l'enfant et qu'il devait respecter l'ordonnance rendue. Il ajoute qu'il ne s'agissait pas d'une « décision de l'employeur » et que la convention collective ne s'appliquait pas.
Décision
Le geste de retirer le plaignant de ses fonctions résulte de l'action de l'employeur puisque aucune des personnes ayant communiqué avec celui-ci n'avait l'autorité pour ordonner un tel retrait, du moins pas directement. En effet, la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance ne permet pas au ministre de s'immiscer dans les relations entre l'employeur et ses employés. Elle lui permet d'intervenir sur le plan du permis du titulaire qui tolérerait une situation susceptible de mettre en péril la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à qui il fournit un service de garde. Le Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance comporte quant à lui des dispositions traitant des qualités requises pour travailler dans un CPE. Il prévoit qu'il appartient au titulaire du permis, l'employeur, de disposer du personnel qualifié lui permettant de remplir toutes les exigences prévues à la loi et aux règlements. C'est donc l’employeur, et non la représentante du Ministère, qui doit s'assurer de retirer la personne qui ne satisfait plus aux exigences. De plus, ce retrait doit s'effectuer en tenant compte des principes applicables en matière de relations du travail ainsi que des dispositions de la convention collective. L'employeur a allégué qu'on lui avait dicté la lettre à remettre au plaignant et qu'on lui avait conseillé de se référer à l'article 76 du règlement. Or, cet article traite d'un signalement de la DPJ dans le contexte d'un service de garde en milieu familial, et non d'un CPE. Il ne relevait pas des pouvoirs de la DPJ d'exercer le droit de direction de l'employeur. La Loi sur la protection de la jeunesse ne lui confère aucunement le pouvoir de retirer une personne, un tiers par rapport à l'enfant, de son milieu de travail, et encore moins d'imposer une mesure d'une durée indéfinie. En l'espèce, il est vrai qu'une entente multisectorielle entre la DPJ, le procureur de la Couronne, la police et l'employeur stipule le retrait des fonctions du plaignant. Toutefois, l'employeur n'a posé aucune question à ce dernier et n'a tenu aucune enquête qui lui aurait permis de déterminer si une faute avait été commise et, le cas échéant, la nature de la sanction à imposer. Ainsi, la mesure imposée était abusive et arbitraire. Toutefois, seuls les dommages découlant directement de la décision de l'employeur peuvent donner droit à une indemnité. Or, en signant volontairement la promesse remise à l'agent de la paix, le plaignant ne pouvait se trouver dans les locaux de l'employeur sans risquer de se placer en situation de non-respect des conditions. Il ne pouvait donc fournir sa prestation de travail et, ainsi que le reconnaît une certaine jurisprudence, il ne pourra être indemnisé à compter de cette date.
Syndicat des intervenantes en petite enfance de Montréal (CSQ) et Centre de la petite enfance Mon monde à moi (Éric Denault), SOQUIJ AZ-50479598
Lorsque la convention précise que l'employeur doit remettre à l'employé un avis d'infraction dans les 72 heures suivant le manquement et que l'avis de mesure disciplinaire doit être remis dans les 48 heures suivantes, il serait illogique d'en déduire, comme le fait le syndicat, que l'employeur disposait d'un délai de 5 jours ouvrables pour sévir; s'il avait été réellement soumis à une telle obligation, il n'aurait pas eu le temps de procéder à une enquête juste et impartiale ainsi que le requiert l'annexe.
Le 23 août 2007, le plaignant a été avisé qu'il ferait l'objet d'une suspension sans traitement de quatre jours parce qu'il s'était absenté du travail sans autorisation les 20 et 21 août. Le 4 septembre suivant, il a été congédié au motif qu'il avait travaillé chez un autre employeur au cours de ces deux journées. Le syndicat conteste ce congédiement. Il allègue que le plaignant a été sanctionné deux fois pour la même faute. De plus, il fait valoir que l'employeur n'a pas répondu par écrit au grief, contrairement à ce que prévoit la convention collective, et qu'il a transgressé la procédure prévue dans une annexe.
Décision
La prétention du syndicat selon laquelle le plaignant a fait l'objet d'une double sanction n'est pas retenue. En effet, il a été suspendu parce qu'il a faussement invoqué la maladie pour justifier son absence, mais il a été congédié pour une infraction tout à fait différente, soit parce qu'il avait travaillé pour un tiers. En ce qui a trait au respect de la procédure prévue à la convention, l'employeur a répondu au grief à l'intérieur de la période prévue pour ce faire. Il semble toutefois que le document transmis par télécopieur ait été égaré. D'autre part, l'annexe de la convention précise que l'employeur doit remettre à l'employé un avis d'infraction dans les 72 heures suivant le manquement et que l'avis de mesure disciplinaire doit être remis dans les 48 heures suivantes. Il serait illogique d'en déduire, comme le fait le syndicat, que l'employeur disposait d'un délai de cinq jours ouvrables pour sévir. S'il avait été réellement soumis à une telle obligation, il n'aurait pas eu le temps de procéder à une enquête juste et impartiale ainsi que le requiert l'annexe. Les clauses d'un contrat devant s'interpréter les unes par rapport aux autres, il y a lieu de conclure que les délais prévus à l'annexe doivent être calculés à compter de la date de l'infraction ou de celle de la prise de connaissance de l'infraction. En l'espèce, l'employeur a agi en temps utile. Cependant, il a transgressé la procédure en omettant de donner un avis d'infraction au plaignant avant de lui remettre celui de congédiement. Ce faisant, il a privé ce dernier de la possibilité de présenter des moyens de défense avant l'imposition de la sanction. En raison de cette dérogation, le congédiement est annulé. Il est ordonné à l'employeur de réintégrer le plaignant dans son emploi rétroactivement au 4 septembre 2007 et de lui verser le salaire ainsi que les avantages dont il a été privé, en soustrayant les revenus de travail qu'il a touchés.
Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 7065-15 (FTQ-CTC) et Fabnor inc. (Pierre Deroy), SOQUIJ AZ-50482799
L'omission de l'employeur d'inscrire le motif de la convocation à une rencontre disciplinaire dans l'avis transmis au plaignant n'entraîne pas la nullité de la mesure étant donné que le syndicat en avait été informé verbalement.
La plaignante a été convoquée à une rencontre disciplinaire, au cours de laquelle on lui a imposé une suspension de cinq jours. Le syndicat soutient que l'employeur a contrevenu à la procédure prévue à la convention collective et que la suspension doit donc être annulée. Il affirme que l'avis de convocation ne précisait pas le motif de la rencontre. Il s'agit, selon lui, d'un vice de fond entraînant la nullité de la mesure disciplinaire. L'employeur allègue que l'obligation de fournir le motif de l'avis de convocation est moins exigeante que celle qui s'applique aux motifs que doit contenir un avis disciplinaire. Il affirme que la plaignante n'a subi aucun préjudice en raison de son omission puisqu'il avait informé verbalement le syndicat des motifs de la rencontre et que celui-ci était donc en mesure d'assurer la défense de ses intérêts.
Décision
Conformément à la convention collective, l'avis de convocation doit être écrit et préciser le motif de la convocation. L'exigence de fournir le motif de la convocation dans l'avis équivaut à introduire le concept d'équité procédurale dans le processus d'imposition des mesures disciplinaires. Bien qu'une telle obligation soit impérative, la sanction de son inobservation n'entraîne pas nécessairement la nullité de la suspension. En effet, l'obligation n'a pas un caractère impératif absolu; ce caractère est plutôt directif. L'inobservation de l'obligation n'est pas fatale si le salarié a été informé autrement des motifs de la rencontre et s'il a eu l'occasion de se faire entendre de même que de faire valoir ses intérêts, ne subissant alors aucun préjudice. En l'espèce, il est établi que l'employeur avait informé le représentant syndical des motifs de la rencontre, se conformant ainsi aux exigences de l'équité procédurale. L'omission d'inscrire ceux-ci dans l'avis à cet effet constituait un vice de forme dont l'inobservation n'entraînait pas la nullité de la suspension.
Association syndicale du Collège Marie de France et Collège Marie de France (Diane Derail), SOQUIJ AZ-50487896
La reprise du processus disciplinaire après l'annulation du congédiement par le directeur général de la Commission scolaire, le directeur de l'école n'ayant pas ce pouvoir, est justifiée.
La plaignante, une enseignante, était une salariée permanente. Le 27 avril 2007, elle a été congédiée verbalement par le directeur de l'école, qui croyait qu'elle avait un statut de salariée surnuméraire. Le 9 mai suivant, son congédiement a été annulé par la Commission scolaire, car il avait été imposé de façon irrégulière, le directeur n'étant pas une personne autorisée en vertu de la procédure. Le 24 mai, elle a fait l'objet d'une suspension provisoire avec traitement. Le 12 juin, le Conseil des commissaires a décidé, par résolution, de résilier son contrat d'engagement, et l'avis de résiliation a été envoyé le surlendemain. Les 30 mai et 26 juillet, des griefs contestant les congédiements ont été déposés. Le syndicat a présenté un moyen préliminaire pour chacun d'eux. Il soutient que le processus disciplinaire ayant mené au congédiement verbal du 27 avril 2007 n'a pas été respecté et que l'employeur a imposé une double pénalité à la plaignante en la congédiant le 12 juin suivant.
Décision
Le congédiement effectué par le directeur d'école est nul puisqu'il n'était pas investi d'une délégation de pouvoirs provenant de la Commission scolaire. Il n'y a pas de présomption d'une telle délégation. La Commission pouvait en reconnaître la nullité. Elle pouvait également en informer la plaignante et le syndicat le 9 mai 2007. En conséquence, le grief déposé le 30 mai suivant et le moyen préliminaire y étant lié sont sans objet et rejetés. Quant au second moyen préliminaire, relatif au grief contestant le second congédiement, la reprise du processus disciplinaire, qui a mené au congédiement du 12 juin 2007, n'a pas conduit à une double pénalité. En effet, le premier congédiement a été annulé par l'employeur, et la plaignante a été réintégrée rétroactivement. De plus, la suspension provisoire du 24 mai suivant et le congédiement du 12 juin ne sont que les deux étapes d'une même mesure disciplinaire. En outre, le droit de l'employeur de reprendre le processus disciplinaire n'était pas prescrit selon la convention collective. En conséquence, les deux moyens préliminaires sont rejetés.
Syndicat de soutien du Pays-des-Bleuets (FISA) et Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (Karine Dion), SOQUIJ AZ-50508244
Le délai écoulé entre l'audience devant le comité de discipline et la décision d'imposer une suspension de dix jours à deux policiers est déraisonnable; en maintenant les plaignants dans l'incertitude pendant sept mois, l'employeur a exercé de façon abusive et irresponsable ses droits de direction.
Les deux plaignants sont des policiers patrouilleurs. Le 24 novembre 2005, ils ont été convoqués devant le comité de discipline pour avoir désobéi à un ordre. Le comité a rendu son rapport le 18 avril 2006. Le 6 juillet suivant, les plaignants ont été suspendus 10 jours. Le syndicat a invoqué un moyen préliminaire à l'encontre de cette mesure. Il affirme que le délai de 14 mois qui s'est écoulé entre les faits reprochés et l'imposition de la sanction est déraisonnable. Quant au fond, le syndicat allègue que les deux plaignants n'ont pas désobéi à un ordre clair et non équivoque.
Décision
La convention collective stipule que les salariés doivent être convoqués devant le comité de discipline au plus tard six mois après l'infraction. En l'espèce, ce délai a été respecté. La convention ne prévoit toutefois pas de délai pour imposer une sanction. Dans les faits, sept mois se sont écoulés entre l'audience devant le comité et l'imposition de la sanction. La jurisprudence a établi à six mois la durée du délai raisonnable entre la connaissance des faits pertinents par l'employeur et l'imposition d'une mesure disciplinaire. Ce dernier peut décider de ne pas sanctionner un salarié, même s'il l'a convoqué devant le comité de discipline. En l'espèce, en ne rendant aucune décision, l'employeur a maintenu les salariés dans l'incertitude durant sept mois, exerçant ainsi de façon abusive et irresponsable ses droits de direction. Le moyen préliminaire est accueilli et les suspensions sont annulées. Par ailleurs, l'employeur accuse les salariés d'insubordination, raison pour laquelle il leur a imposé une sanction disciplinaire. Or, l'insubordination est le refus d'obéir à un ordre clair donné par un supérieur hiérarchique. En l'espèce, le sergent s'attendait à ce que les plaignants se rendent sur les lieux d'un incident. Cependant, il ne leur en a pas donné l'ordre direct et non équivoque. Il s'agissait donc d'une situation ambiguë, et il n'y a pas eu de faute de la part des plaignants.
Sherbrooke (Ville de) et Association des policières et policiers de Sherbrooke (griefs individuels, Éric Beaudoin et un autre), SOQUIJ AZ-50510443
La règle de la progression des sanctions ne s'applique pas lorsque la seconde suspension ne découle pas d'une faute de même nature que celle à l'origine d'une première suspension.
Le plaignant conteste deux suspensions de deux jours qui lui ont été imposées respectivement au mois de janvier et au mois de février 2005. Dans le premier cas, l'employeur lui reproche d'avoir refusé d'exécuter une tâche à la demande de son supérieur immédiat, et ce, de façon agressive. Dans le second, l'employeur lui reproche d'avoir manqué de politesse et de respect en se présentant deux fois à la cafétéria pendant qu'une réunion de la direction s'y tenait. Il aurait alors été bruyant et aurait eu un comportement dérangeant.
Décision
L'incident ayant donné lieu à la première suspension est survenu alors qu'il existait une tension dans l'usine relativement à une nouvelle politique de l'employeur. Il semble que le plaignant acceptait normalement d'exécuter les tâches que lui demandait son supérieur immédiat. Toutefois, le 6 janvier 2005, il a refusé d'obtempérer à sa demande et n'a pas exécuté la tâche demandée. Son refus s'inscrivait dans une démarche de protestation contre l'instauration de la politique qui n'avait absolument aucun rapport avec la demande du supérieur immédiat. Or, celle-ci n'était contraire ni à la loi ni à la convention collective et elle n'exposait pas le salarié à un quelconque danger. Elle n'était pas équivoque, déraisonnable ou abusive. Pour ces motifs, l'employeur était fondé à imposer au plaignant une suspension de deux jours. Quant à la seconde suspension, elle ne découle pas d'une faute de même nature que celle qui est à l'origine de la première suspension. Le principe de la progression des sanctions ne pouvait donc s'appliquer. Dans le premier cas, le plaignant a défié l'autorité de son supérieur tandis que, dans le second, sa faute repose sur un manque de politesse et de respect. Il demeure que, dans les deux cas, la faute découle d'un esprit quelque peu frondeur. Le plaignant avait le droit d'accéder à la cafétéria. Toutefois, il devait respecter celui de l'employeur d'y tenir une réunion et satisfaire à son obligation de se comporter de façon respectueuse. Il est clair que le plaignant a fait preuve d'un manque de respect lors de sa première visite à la cafétéria en adoptant un comportement dérangeant. Toutefois, le Tribunal ne retient pas le reproche de l'employeur lié au fait que le plaignant aurait fait du bruit en manipulant quelques feuilles de papier lors d'une seconde visite. La gravité de la faute est moindre que celle qui avait donné lieu à la première suspension. Il y a donc lieu de substituer une suspension d’un jour à celle de deux jours.
Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 7885 et Venmar Ventilation inc. (Germain Daunais), SOQUIJ AZ-50344108
Exception à la règle de progression des sanctions
Malgré neuf avertissements écrits et une suspension de trois jours, la plaignante – une caissière – a continué à déroger aux procédures de caisse; dans les circonstances, l'employeur était fondé à la congédier sans appliquer la règle de la progression des sanctions.
La plaignante, une caissière, a été congédiée pour avoir modifié le prix d'un article en invoquant une erreur de prix sans obtenir préalablement l'autorisation du gérant. L'employeur soutient qu'elle a contrevenu aux directives relatives aux caisses. Selon lui, il s'agit d'une récidive d'un manquement similaire. Il souligne que, malgré le peu d'ancienneté de la plaignante, son dossier disciplinaire comporte de nombreux avertissements écrits et une suspension de trois jours pour diverses manifestations de désobéissance ou de refus de se conformer aux directives reçues. Il allègue que, à la suite du dernier incident, il était manifeste que la plaignante n'amendait pas son comportement malgré les nombreux avis disciplinaires. Il a donc décidé de la congédier. Le syndicat invoque la clause d'amnistie prévue à la convention collective et prétend que l'employeur ne pouvait invoquer les mesures disciplinaires imposées à la plaignante par le passé. Il ajoute que l'employeur a contrevenu à la règle de la progression des sanctions en imposant un congédiement sans d'abord imposer une longue suspension.
Décision
La clause d'amnistie prévue à la convention collective énonce que l'employeur ne tiendra pas compte des infractions passées si, depuis leur occurrence, l'employé a travaillé pendant 12 mois dans le cas d'une suspension ou pendant 6 mois dans le cas d'une réprimande écrite sans autre mesure disciplinaire de même nature. L'expression « de même nature » fait référence à des traits essentiels qui sont similaires. En l'espèce, la clause ne s'applique pas à la situation de la plaignante, compte tenu du délai entre les mesures disciplinaires de même nature. Relativement à l'application du principe de la progression des sanctions, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que ce principe est tempéré par certaines exceptions, notamment lorsque la faute commise est d'une gravité telle que le lien de confiance est irrémédiablement rompu et que la rationalité de cette rupture a été établie à la satisfaction du tribunal. C'est également le cas lorsqu'il est devenu manifeste, après considération du dossier disciplinaire du salarié, de ses multiples manquements répétés à la discipline, aux directives et aux exigences indiquées et de son indifférence à l'égard de toutes les mesures disciplinaires qui lui ont été imposées, qu'il ne veut pas s'amender ou en est incapable et qu'une nouvelle mesure disciplinaire moindre que le congédiement ne fera que retarder inutilement l'inéluctable. En l'espèce, en 21 mois d'emploi, la plaignante a reçu au moins un avertissement verbal, neuf avertissements écrits et une suspension de trois jours. En dépit de cette dernière mesure disciplinaire et de la mise en garde qui lui avait alors été faite selon laquelle, en l'absence d'une amélioration, elle allait être congédiée, elle a néanmoins récidivé deux mois plus tard en se rendant coupable d'un autre manquement aux procédures de caisse identique à celui qui lui avait valu cette suspension et cette mise en garde, soit une modification de prix sans l'autorisation d'un gérant. Dans ce contexte, l'imposition du congédiement respectait le principe de la progression des sanctions. Par ailleurs, il n'appartient pas à l'arbitre d'imposer à l'employeur une obligation de clémence et la preuve a démontré que ce dernier avait des raisons très sérieuses de croire qu'il était inutile de donner à la plaignante une nouvelle chance de corriger son comportement déviant. Le congédiement est donc maintenu.
Syndicat des métallos, section locale 7065 et Entreprises D.L. Léger (Canadian Tire), (Nancy Levasseur), SOQUIJ AZ-50504757
Le principe de la progression des sanctions n’est pas applicable lorsque le salarié a été avisé de ce qu’il ne devait pas faire, que l’employeur a mené des campagnes d'information à cet effet, qu’il a régulièrement distribué une documentation spécialisée et tenu des rencontres à ce sujet et que, chaque année, tous les employés doivent signer un engagement à la confidentialité.
Le plaignant, un comptable au service du ministère du Revenu, a été congédié au motif qu'il avait dérogé aux lois, règlements et directives concernant les normes d'éthique et de discipline. Au terme d'une enquête effectuée à la suite d'une plainte, l'employeur lui a reproché d'avoir fait usage, depuis plusieurs années, des banques de données du Ministère à des fins personnelles, d'avoir divulgué des renseignements fiscaux confidentiels à des tiers, d'avoir consulté le dossier fiscal de ses proches, d'avoir modifié les déclarations de revenus de ses proches, d'avoir consulté à plusieurs reprises son propre dossier fiscal et d'avoir fait plus de 800 appels téléphoniques personnels sur une période de cinq semaines. Le syndicat a fait valoir que, dès que survenait un incident, l'employeur examinait les faits passés et qu'il a ainsi pu adresser tous ces reproches au plaignant, tenant compte du plus petit au plus grand manquement, présentant un portrait grossier de ce dernier. Selon lui, l'employeur n'a pas tenu compte de circonstances atténuantes, de la tardiveté des reproches, de la gravité relative des manquements et de la progression des sanctions.
Décision
Le plaignant a reconnu avoir effectué les consultations qu'on lui reproche. Il a cependant tenté de fournir des explications visant à amoindrir la nature de ses manquements, même dans le cas des violations pour lesquelles des poursuites pénales ont été entreprises contre lui et auxquelles il a plaidé coupable. Or, dans ses tentatives d'expliquer ses agissements, il a transformé la vérité ou l'a présentée de façon partielle. Quant à la gravité des manquements, depuis 1996, l'employeur a une politique de « tolérance zéro », dont ses employés sont régulièrement informés. De plus, il y a lieu de tenir compte de la mission du ministère du Revenu et de l'article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu, lequel édicte la confidentialité des dossiers fiscaux. Par ailleurs, on ne peut retenir l'argument de tardiveté de l'intervention. L'employeur n'est certainement pas tenu d'enquêter sur la qualité du travail de ses employés alors qu'il n'a aucun motif de le faire. Pour ce qui est de la progression des sanctions, ce principe n'est pas applicable en l'espèce. En effet, le plaignant, employé depuis 25 ans, avait été informé de l'interdiction de consulter ses propres dossiers fiscaux ainsi que ceux d'autres contribuables. À compter de 1996, l'employeur a mené des campagnes d'information, a régulièrement distribué une documentation spécialisée et a tenu des rencontres sur ces sujets. De plus, chaque année, tous les employés doivent signer un engagement à la confidentialité. Or, le plaignant a pris des renseignements dans des dossiers fiscaux et les a divulgués à un tiers pour qui ces renseignements avaient une importance financière. Les explications non crédibles qu'il a fournies établissent qu'il n'a pas compris l'importance de ses manquements ni celle du préjudice qu'il a créé à son employeur. Ainsi, s'il avait été réintégré, il y aurait eu de fortes possibilités de récidive. Quant aux multiples appels téléphoniques personnels, bien qu'il ne s'agisse pas d'un reproche de la même nature que les précédents, il demeure que le plaignant a certainement passé un très grand nombre d'heures à faire ces appels au lieu de les consacrer au travail pour lequel il était rémunéré.Syndicat de la fonction publique du Québec et Québec (Gouvernement du) (Ministère du Revenu), (Jean-Maurice Juste), SOQUIJ AZ- 50424636
Le plaignant – un pompier forestier en situation d'autorité – a fait preuve d'irresponsabilité et de négligence grave en abandonnant un pompier sur les lieux d'un incendie de forêt; le principe de la progression des sanctions ne s'applique pas et son congédiement est confirmé.
Le plaignant travaillait à titre de pompier forestier. Il conteste une suspension aux fins d'une enquête et un congédiement. L'employeur lui reproche d'avoir laissé un pompier combattant sur les lieux d'un incendie forestier alors qu'il agissait à titre de chef de lutte et qu'il avait la responsabilité de son équipe. Il lui reproche aussi son insouciance et son irresponsabilité lorsqu'il s'est absenté sans prévenir et, une autre fois, lorsqu'il a fait en sorte de ne pouvoir être joint par les membres de l'équipe dont il avait la charge. L'employeur soutient que le plaignant a commis une faute grave en mettant en péril la santé et l'intégrité physique d'un collègue sans aucune justification. Par son comportement, il a rompu le lien de confiance.
Décision
L'employeur a le mandat de protéger les forêts québécoises, en vue d'assurer leur pérennité, ainsi que les populations et les biens des personnes. La plupart du temps, les pompiers forestiers interviennent dans des lieux isolés et pas toujours facilement accessibles. Il est important que les pompiers forestiers appelés à exercer des fonctions de commandement durant une intervention suivent le plan de combat établi et que les combattants sous leur responsabilité soient persuadés que les directives qu'ils recevront ne compromettront pas leur sécurité ni leur vie. En l'espèce, le plaignant a fait preuve d'irresponsabilité et de négligence grave : il ne s'est aucunement soucié de la sécurité et de la vie d'un combattant sous ses ordres en le laissant sur les lieux d'un incendie non maîtrisé, et ce, sans moyen de communication, sans outils de combat et sans instructions. Un tel comportement constitue une faute grave qui rompt le lien de confiance – tant avec l'employeur qu'avec les collègues – et justifie une dérogation au principe de la progression des sanctions. L'employeur ne peut attendre que le plaignant commette une autre faute de même nature afin de mettre fin à son emploi. Il a l'obligation d'assurer la santé et la sécurité des salariés. Par ailleurs, il devait congédier le plaignant s'il voulait conserver la confiance du public. Enfin, le plaignant a adopté un comportement insouciant et irresponsable à au moins deux autres reprises.
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 1210 (FTQ) et Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), base de Roberval (Frédéric Waltzing), SOQUIJ AZ-50383339
Le plaignant ayant refusé de se présenter au travail alors qu’il avait été inscrit à l’horaire du dimanche, il s’agissait d'un acte d'insubordination ayant pris place dans un contexte de défi à l'autorité, soit une faute grave permettant à l’employeur de déroger à la règle de la progression des sanctions.
Le plaignant est boucher au service de l'employeur depuis 12 ans. Il a été inscrit à l'horaire de travail pour le 1er juillet 2004 malgré sa demande à l'effet contraire. Lorsqu'il a constaté ce fait, il a avisé l'employeur qu'il ne viendrait pas travailler ce jour-là. Le 1er juillet, il ne s'est pas présenté au travail et il n'a pas communiqué avec l'employeur. Le 5 juillet suivant, il a été suspendu pendant deux jours.
Décision
Le supérieur du plaignant devait faire face aux impératifs de son service pour la journée du 1er juillet. Le magasin était ouvert et il avait besoin de cinq bouchers pour combler ses besoins. C'est à l'employeur qu'il revenait d'établir les besoins en matière de personnel. Pour ce faire, ce dernier a d'abord demandé des volontaires, ce qui n'a pas permis d'obtenir le nombre suffisant de bouchers. Il a donc appliqué la convention collective en affectant les salariés par ordre inverse d'ancienneté. Si on se limite à cette disposition, le plaignant ne pouvait refuser de se présenter au travail. Par ailleurs, le motif avancé par ce dernier – à savoir qu'il n'avait pas à travailler lors d'un jour férié – ne saurait faire échec à l'application de la convention. Le plaignant a par ailleurs soutenu que, le 1er juillet n'étant pas un jour férié « étoilé » dans la convention collective, l'employeur ne pouvait avoir recours à la procédure précédemment décrite. Toutefois, ce jour férié devait également être, selon la convention, rémunéré au taux majoré des heures supplémentaires, ne laissant d'autre choix à l'employeur que d'appliquer la procédure édictée à cet égard, ce qu'il a fait. Le plaignant a également soutenu qu'on ne pouvait l'obliger à travailler au sein de plus d'une équipe au cours d'une même semaine. Il était de fait affecté de jour et l'affectation du 1er juillet chevauchait le quart de nuit et celui de jour. Or, la convention stipule que le travail effectué au cours d'un jour férié ne fait pas partie de la semaine normale de travail et que ce travail est rémunéré à taux majoré. L'employeur s'est donc conformé aux clauses applicables lors de l'affectation du plaignant. Par ailleurs, ce dernier a délibérément refusé d'obtempérer à une demande de l'employeur. Son refus était bien réfléchi et il n'a offert aucune explication pour justifier son geste. Il s'agit donc d'un acte d'insubordination ayant pris place dans un contexte de défi à l'autorité. Ce comportement constitue une « cause grave » au sens de la convention collective, permettant à l'employeur de déroger à la règle relative à la progression des sanctions qui y est prévue. Dans les circonstances, la sanction ne paraît pas démesurée ou discriminatoire.
Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et Alimentation Montée St-Jean inc. (Michel Paolucci), SOQUIJ AZ-50349505
La notion de progression des sanctions ne peut recevoir application que dans les cas de fautes ou d'écarts de conduite qui présentent peu de gravité lorsqu'ils sont considérés séparément, mais deviennent plus sérieux en raison de leur répétition; elle n'est pas applicable dans les cas de fautes lourdes ou graves.
Les plaignants, au nombre de sept, ont été congédiés le 2 mai 2005 au motif qu'ils avaient à plusieurs reprises consommé des drogues illicites – de la marijuana et, dans un cas, de la cocaïne – pendant leurs périodes de repas et qu'ils avaient commis des « vols de temps » en prolongeant les pauses repas. Cette sanction leur a été imposée après qu'ils eurent reconnu les faits reprochés à la suite d'une enquête effectuée à la demande de l'employeur. Le 7 avril précédent, la politique de l'entreprise concernant l'usage d'alcool et de drogues avait été portée à leur attention. Celle-ci mentionne l'interdiction d'être au travail sous l'influence de l'alcool ou de drogues et précise que des sanctions pouvant aller jusqu'au congédiement sont prévues en cas de contravention.
Décision
Les plaignants ont admis s'être rendus à plusieurs reprises dans une taverne à proximité de l'usine pour y prendre leur repas, que certains d'entre eux consommaient alors une bière ou deux et que tous fumaient ensuite une ou deux cigarettes de marijuana avant de retourner au travail. Pour ce qui est du vol de temps, de nombreux autres salariés prolongeaient la période de repas sans que l'employeur sévisse à leur endroit. En ce qui concerne la politique relative à l'usage d'alcool et de drogues, elle est bien fondée compte tenu de la nature des fonctions confiées aux salariés, de l'équipement utilisé et de l'éventualité que des accidents graves puissent se produire. Cette politique reflète également les obligations imposées à l'employeur à l'article 217.1 du Code criminel. Toutefois, elle n'est pas requise comme condition préalable pour qu'un employeur puisse légitimement sévir. Quant à la notion de progression des sanctions, elle n'est pas pertinente en l'espèce, puisqu'elle ne peut recevoir application que dans les cas de fautes ou d'écarts de conduite qui présentent peu de gravité lorsqu'ils sont considérés séparément, mais deviennent plus sérieux en raison de leur répétition. Cette notion n'est pas applicable dans les cas de fautes lourdes ou graves. En l'espèce, les fautes reprochées aux plaignants étaient suffisamment graves pour que l'employeur soit fondé à sanctionner leurs écarts de conduire en ayant recours à une mesure sévère. Par ailleurs, sauf dans un cas où l'un des plaignants a reçu un avis lui enjoignant d'améliorer la qualité de son travail, aucun de ceux-ci n'avait reçu d'avis quelconque. Par conséquent, les sanctions doivent être modifiées et même si l'employeur était fondé à faire montre de sévérité à leur endroit, leurs années de service – plus de quatre ans dans le cas du dernier embauché parmi eux – auraient dû être prises en considération. La réintégration des plaignants est donc ordonnée, sans compensation depuis la date de leur congédiement. Ils devront par ailleurs renoncer au droit à l'intimité et à la dignité de la personne prévu à l'article 10 du Code civil du Québec et aux articles 1 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et permettre à l'employeur de procéder à des tests de dépistage impromptus, à défaut de quoi l'emploi de ceux qui refuseraient prendra fin le jour même du refus.
Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 6617 et Compagnie Komatsu international (Canada) inc. (griefs individuels, Maxime Campeau et autres), SOQUIJ AZ-50368394
Conséquences de la règle de la progression des sanctions
Le corollaire de la règle de la progression des sanctions est que la sévérité des sanctions doit s'accroître jusqu'à atteindre le congédiement lorsqu'un salarié de plus en plus sévèrement puni démontre – par ses récidives – qu'il n'y a raisonnablement plus d'espoir qu'il s'amende.
Le plaignant, un camionneur affecté à la livraison, a été embauché en 1990. Dans les mois précédant son congédiement, il a reçu plusieurs avertissements au sujet de ses retards répétés ainsi qu'un avis écrit et trois suspensions au même motif. Le plaignant n'a pas contesté ces mesures. Le 17 novembre 2005, il a communiqué avec son supérieur à 6 h 05 pour l'aviser de son absence alors que son quart de travail débutait à 6 h. Il a été congédié le lendemain. L'employeur qualifie l'absence du 17 novembre d'incident culminant. Il ajoute qu'il a respecté le principe de la progression des sanctions et qu'il était vain d'espérer que le plaignant modifie son comportement. De son côté, le syndicat fait valoir que l'absence du plaignant n'était pas injustifiée – celui-ci allègue avoir été souffrant –, mais qu'il l'a tout simplement signalée tardivement. Par ailleurs, il fait valoir plusieurs circonstances atténuantes en faveur du plaignant.
Décision
La doctrine de l'incident culminant s'appuie sur le poids cumulé des manquements successifs. Il est vrai que, pris isolément, l'incident du 17 novembre n'est qu'une affaire de quelques minutes. Toutefois, l'essentiel du problème est que cet incident n'est justement pas isolé. Il s'inscrit dans une série de manquements qui témoignent de la part du plaignant d'une attitude souvent insensible à ses obligations de ponctualité et d'assiduité au travail. L'employeur a commencé à sanctionner ces manquements en mai 2005, d'abord par des avertissements et ensuite par des suspensions. Or, il est tout à fait légitime pour un employeur de s'attendre que son personnel soit présent au travail et d'exiger qu'un salarié incapable d'y être le prévienne avec diligence. Il doit cependant respecter la règle de la progression des sanctions. Le corollaire de cette règle est que la sévérité des sanctions doit s'accroître jusqu'à atteindre le congédiement lorsqu'un salarié de plus en plus sévèrement puni démontre – par ses récidives – qu'il n'y a raisonnablement plus d'espoir qu'il s'amende. En l'espèce, l'incident du 17 novembre jumelé à ceux qui l'ont précédé – si sérieux soit-il – ne fonde pas un congédiement. En effet, dans les six mois précédents, le plaignant a été l'objet de cinq mesures disciplinaires d'une sévérité relative : un avis verbal, un avis écrit et trois suspensions totalisant neuf jours. Le fait qu'il n'ait pas contesté ces mesures constitue une forme de reconnaissance de son problème ainsi qu'une manifestation de son désir d'y remédier. D'autre part, le congédiement d'un salarié comptant 15 ans d'ancienneté pour un incident suivant de peu une suspension d'une durée relativement courte, soit cinq jours, pour une question de ponctualité et d'assiduité, ne respecte pas le principe obligatoire de la progression des sanctions. Par contre, le plaignant n'ayant pas témoigné de façon franche, ce qui constitue une circonstance aggravante, il est réintégré sans indemnité, ce qui équivaut à une suspension de 20 mois.
Cascades Ressources, groupe papiers fins inc. et Teamsters/Conférence des communications graphiques, section locale 555M (Francis Martin), SOQUIJ AZ-50446007
COMMENT REPÉRER LES DÉCISIONS MENTIONNÉES DANS CET ARTICLE À L’AIDE D’AZIMUT, DOCUMENTATION JURIDIQUE?
Chacune des décisions mentionnées dans cet article contient une référence AZ (p. ex., AZ-50233881). Pour trouver une décision, accédez simplement à l’écran Choix de banque du service Juris.doc, inscrivez le numéro à huit chiffres dans la case correspondante et cliquez sur 
COMMENT REPÉRER D’AUTRES DÉCISIONS SUR CE SUJET À L’AIDE D’AZIMUT, DOCUMENTATION JURIDIQUE?
Accessible tant dans la Banque de résumés SOQUIJ que dans la Banque de textes intégraux du service Juris.doc, le Plan classification annoté vous permet d’effectuer vos recherches à partir d’un domaine de droit précis, tel que le droit du travail.
Simple et efficace, celui-ci retrouve rapidement les décisions à l’aide de rubriques et sous-rubriques, à la manière d’une table des matières.
Pour trouver les décisions mentionnées dans le présent article, faites éclater les sous-rubriques Grief (1) et Mesure disciplinaire ou non disciplinaire (2).
Choisissez entre les décisions traitant des formalités issues de la convention collective (3) et celles issues de la jurisprudence (4).
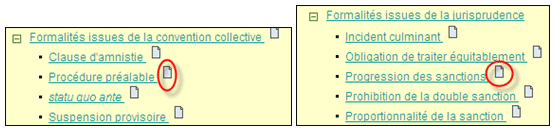
Ensuite, consultez les fiches d’annotation, en cliquant sur l’icône située à droite des sous-rubriques pour obtenir des renseignements sur la question de la procédure préalable et de la progression des sanctions.
Lancez votre recherche en cliquant sur l’une des deux rubriques désirées. Si vous désirez circonscrire davantage votre recherche, cliquez sur le bouton Raffiner par mots clés.
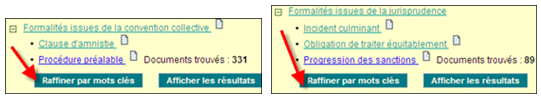
À l’écran Mots clés, écrivez les termes choisis pour raffiner votre recherche, puis cliquez sur le bouton Rechercher et afficher.
Enfin, visualisez les résultats obtenus et sélectionnez ceux qui vous semblent pertinents à l’aide des manchettes d’indexation.
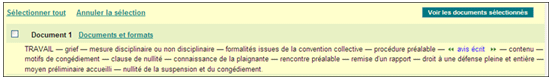
Pour toute question relative à l'utilisation d'AZIMUT, communiquez avec le Service d'aide aux utilisateurs au 514 842-AIDE ou, sans frais, au 1 800 356-AIDE, de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi. Si vous n’êtes pas encore abonné à AZIMUT, profitez du rabais offert aux membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.
Monique Desrosiers, avocate, Coordonnatrice, Secteur droit du travail et droit social, Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
Source : VigieRT, numéro 34, janvier 2009.