Les problèmes sociaux et économiques reliées au jeu pathologique sont une préoccupation importante des différents niveaux de gouvernement. Cette prise en charge explique peut-être le fait qu’on ne retrouve plus, depuis quelques années, de cas qui se sont rendus jusqu’à l’arbitrage de griefs. Plusieurs principes ont cependant été énoncés, notamment le fait que le jeu pathologique diffère de l’alcoolisme ou de la toxicomanie quant aux conséquences sur la prestation de travail, particulièrement en ce qui a trait au risque de récidive.
Quant à la « gestion » des employés aux prises avec des problèmes d’alcool, un survol de l’année 2007 montre qu’elle est toujours aussi exigeante : cure de désintoxication, entente de réintégration conditionnelle, entente de dernière chance, obligation d’accommodement et respect des droits prévus à la Charte des droits et libertés de la personne.
Entente de dernière chance et respect des droits garantis par la Charte
Le plaignant travaillait pour l'employeur depuis vingt ans et occupait des fonctions de releveur de compteurs depuis environ quinze ans. Il souffre d'alcoolisme et a suivi huit cures de désintoxication de 1990 à 2006, assumées en grande partie par l'employeur. En octobre 2000, une première entente de réintégration conditionnelle a été signée par les parties. En avril 2006, le plaignant a fait une rechute et a de nouveau amorcé une cure de désintoxication. Une nouvelle entente de réintégration conditionnelle ainsi qu'un protocole médical ont été signés par les parties, prévoyant notamment le congédiement immédiat en cas de non-respect. En juillet, le plaignant a contrevenu à ses engagements et il a été congédié en mois d’août. L'employeur prétend que l'arbitre est lié par ces ententes et qu'il doit décliner compétence, d'autant plus que la preuve des violations n'est pas contredite.
DÉCISION : L'entente de « dernière chance » est un instrument extrêmement utile aux parties pour gérer des cas litigieux à répétition. Conçue à partir de la théorie du point culminant et de la gradation des sanctions, elle peut éviter à un salarié de perdre son emploi tout en assurant à son employeur que sa clémence ne lui sera pas un jour fatale. La jurisprudence est largement majoritaire à l'effet que l'arbitre doit se conformer aux règles juridictionnelles que les parties y prévoient et qui, généralement, se limite à vérifier si le salarié a respecté ou non les dispositions de l'entente et à confirmer ou infirmer, selon les résultats de cette enquête, que le congédiement est fondé ou non. Cependant, de plus en plus d'arbitres affirment qu'une entente de dernière chance ne peut porter atteinte à des droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne, qui est placée au-dessus de toutes les lois par son caractère quasi-constitutionnel et d'ordre public et qui, depuis l'arrêt Parry Sound, doit être considérée comme faisant partie de la convention collective. Ni l'arbitre, ni l'employeur, ni le syndicat ne peuvent faire abstraction des droits fondamentaux d'un salarié lorsqu'il est question d'une entente de « dernière chance ». Or, un des droits fondamentaux est ne pas subir de discrimination en raison d'un handicap dont on est affecté. N'étant pas contesté que la maladie peut constituer un handicap et n'étant pas contesté non plus que l'alcoolisme est reconnu comme une maladie, il faut conclure qu'une entente de dernière chance est une mesure discriminatoire si elle vise à sanctionner de façon automatique et irrémédiable par un congédiement l'inconduite et les manquements d'un salarié à celle-ci occasionnés par son alcoolisme. En l'espèce, en imposant au plaignant une perte d'emploi automatique en cas de manquement à des engagements pris directement en relation avec son alcoolisme, et en limitant le pouvoir de l'arbitre de vérifier si le plaignant a réellement commis une faute justifiant son congédiement, les parties sont allées à l'encontre des dispositions de la Charte relative à la discrimination fondée sur un handicap. Ainsi, le tribunal doit examiner la nature et la gravité des événements reprochés et la capacité du plaignant à assumer de façon normale sa prestation de travail dans le contexte des exigences imposées par l'employeur et toujours en rapport avec son état de santé. Or, bien que le plaignant souffre d'un alcoolisme profond, aucun reproche n'a été formulé quant à la qualité et à la quantité du travail accompli par celui-ci. En tout temps, il a fourni une prestation de travail assidue et ne s'est jamais présenté sous l'effet de l'alcool. De 2000 à 2006, il a eu une longue période sans rechute, sans absences injustifiées, sans intervention dans son dossier, et a respecté les termes de sa première réintégration conditionnelle. La rechute de juillet 2006 – provoquée par une perte de contrôle momentanée et non par l'insouciance ou la mauvaise volonté – et son absence injustifiée méritent une sanction sévère, mais certainement pas un congédiement. L'obligation d'accommodement de l'employeur devait durer jusqu'à ce que les manquements du plaignant soient considérés excessifs. Ainsi, l'absence du plaignant depuis le 11 juillet 2006 sera considérée comme un congé sans rémunération et le retour au travail devra se faire après un examen médical et un dépistage de drogue et d'alcool qu'il devra passer avec succès sous peine d'être considéré inapte à assumer sa prestation de travail. De plus, les ententes conclues continueront à s'appliquer, sauf en ce qui concerne les paragraphes contrevenant à la Charte.
Syndicat des employé-ées de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec (SCFP/FTQ), section locale 2000 et Hydro-Québec (Richard Viens), SOQUIJ AZ-5046-6477
Entente de réintégration conditionnelle
En août 2002, le plaignant, un agent de bureau dans la fonction publique, a fait l'objet d'un premier congédiement en raison d'absences sans autorisation attribuables à un problème d'alcool. En juin 2004, une entente de réintégration conditionnelle conclue avec le syndicat prévoyait, entre autres obligations, celle de se soumettre à une cure de désintoxication et évoquait la possibilité d'un nouveau congédiement en cas d'absences non autorisées. Peu après son retour au travail, le plaignant a recommencé à s'absenter, de sorte que, en mars 2005, l'employeur l'a congédié.
DÉCISION : L'entente doit produire ses effets et il n'y a pas lieu pour l'arbitre d'intervenir. À peine deux mois après son retour au travail, le plaignant s'est absenté sans autorisation, de façon régulière, les jeudis ou vendredis qui coïncidaient avec la semaine de paie. Bien que l'employeur ait rapidement exigé qu'il justifie ses absences à l'aide d'une attestation médicale, le plaignant a omis de le faire à quelques reprises, notamment en février et mars 2005. Dans plusieurs cas, l'employeur a même choisi d'autoriser après coup les absences, alors qu'il aurait pu ne pas le faire. Il a donc fait preuve de patience à l'égard du plaignant et il n'a pas agi à la première occasion. Contrairement à d'autres ententes du même type, cette entente ne prévoyait pas que le plaignant serait congédié à la première absence sans autorisation et près de dix mois se sont écoulés entre sa réintégration et son deuxième congédiement. Dans l'intervalle, l'employeur a adopté une approche plus administrative que disciplinaire, mais a finalement dû avoir recours au congédiement, en mars 2005, lorsqu'il a constaté que le plaignant ne poursuivait pas une démarche sérieuse de réhabilitation et qu'il n'était pas suffisamment motivé pour faire les efforts nécessaires. En effet, plutôt que de retourner en cure fermée, il a choisi de recevoir un suivi thérapeutique à l'externe, démarche qui s'est rapidement avérée insuffisante. De plus, aucune preuve n'a été présentée pour expliquer ce choix.
Syndicat de la fonction publique du Québec et Québec (Ministère du Revenu), (Daniel Lapalme), SOQUIJ AZ-50401135
Cure de désintoxication
Le 23 juin 2005, le plaignant — un préposé aux commandes — et l'un de ses collègues ont été surpris par des enquêteurs de l'employeur à consommer de la drogue et de l'alcool, lors de leur pause santé, sur le terrain de stationnement de l'entreprise. Au mois de septembre suivant, l'employeur l'a rencontré pour discuter de l'opportunité d'une seconde cure de désintoxication. Devant le refus du plaignant, il lui a écrit, le 14 octobre, que si un arbitre annulait sa démission, il considérerait cette décision comme une cause de congédiement.
DÉCISION : Les motifs invoqués par l'employeur — consommation de drogue et d'alcool sur les lieux du travail et le refus de suivre une cure de désintoxication — ne justifient pas le congédiement. En effet, lorsque le plaignant a été surpris à consommer de la drogue et de l'alcool, cela faisait à peine six mois qu'il avait suivi une cure de désintoxication à la suite d'un diagnostic principal de toxicomanie. L'employeur était disposé à le réintégrer à la condition qu'il suive une seconde cure. Toutefois, cette exigence était excessive compte tenu de l'incident du 23 juin 2005. Enfin, l'argument de l'employeur selon lequel le plaignant était irrécupérable ne peut être retenu. Il doit plutôt être considéré comme récupérable, à condition de recevoir une sanction susceptible de le faire réfléchir sérieusement sur ses obligations à l'égard de son employeur et de ses collègues ainsi que sur les conséquences de récidive de sa part. Le fait de consommer de la drogue au travail est une faute grave, et une sanction sévère est nécessaire. Cependant, le congédiement est abusif en l'espèce et il y a lieu d'y substituer une suspension de 14 mois.
Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 503 et Jardin Mérite Québec (Cédric Maranda), SOQUIJ AZ-50404551
Politique de « tolérance zéro »
Le plaignant a été renvoyé chez lui peu après son arrivée au travail lorsque son contremaître a constaté qu'il avait les yeux rouges, qu'il avait l'air fatigué et qu'il sentait l'alcool. L'employeur a ensuite déduit sept heures de sa banque de congés flottants. Selon l'employeur, son geste était purement préventif et non disciplinaire et il a agi conformément à ses droits de direction, à ses directives internes et aux dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).
DÉCISION : L'arbitre a évalué la preuve et il en tiré des conclusions logiques. Il a refusé de conclure que l'odeur d'alcool dégagée par le plaignant conjuguée à ses yeux rouges et à son air fatigué était des éléments suffisants pour inférer que celui-ci était « sous l'effet de l'alcool ». De son côté, l'employeur n'a présenté aucune preuve de l'inaptitude du plaignant. En ce qui a trait au fait que l'arbitre a exigé que l'employeur fasse la démonstration que les facultés physiques ou intellectuelles du plaignant étaient altérées en raison de sa consommation d'alcool alors que le fardeau de preuve appartenait au plaignant, puisque la décision de le renvoyer chez lui était une mesure administrative et non disciplinaire, cet argument ne peut être retenu. L'interprétation de la portée de la règle de conduite imposée par l'employeur et l'application du fardeau de la preuve sont des questions qui relèvent clairement du champ de compétence de l'arbitre; or, son analyse et ses explications sont rationnelles. L'employeur a également invoqué une erreur manifeste du fait que l'arbitre aurait passé outre aux dispositions d'ordre public de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, et particulièrement à son article 51. Même si le raisonnement de l'arbitre ne fait pas précisément référence à l'article 51 LSST, cela ne veut pas dire qu'il n'en a pas tenu compte. En effet, en concluant que le plaignant n'était pas sous l'effet de l'alcool et qu'il n'avait donc pas enfreint le règlement de l'employeur, l'arbitre n'avait pas à aller plus loin dans l'analyse de la législation, dans la mesure où son appréciation de la preuve lui dictait une telle conclusion.
Par ailleurs, même s'il eût peut-être été préférable que l'arbitre explique les différences dans le fardeau de preuve associées selon le type de mesure, il n'en demeure pas moins qu'il a considéré que l'employeur n'avait pas de motifs raisonnables pour renvoyer le plaignant chez lui et le priver d'une rémunération. Enfin, lorsque l'arbitre mentionne que les termes de son règlement — politique de « tolérance zéro » — ne sont peut-être pas assez rigoureux pour atteindre son objectif, il ne s'agit que d'un obiter. Ainsi, le résultat auquel en arrive l'arbitre en accueillant le grief n'est pas contraire à la preuve et ses inférences font partie de l'éventail des conclusions possibles auxquelles il pouvait logiquement arriver.
Sanimax ACI inc. c. Poulin, SOQUIJ AZ-50435288
Obligation d’accommodement et nouvelle expertise médicale
Le 14 septembre 2004, la plaignante, une releveuse de compteurs, a été congédiée aux motifs qu'elle avait consommé des boissons alcooliques durant les heures de travail, qu'elle avait engendré des pertes de temps en allant chez elle pendant les heures de travail et qu'elle était incapable de fournir une prestation de travail normale et sécuritaire. Devant l'arbitre, le syndicat a déposé une expertise médicale en date du 28 octobre 2005 dans laquelle le médecin affirmait que, au moment du congédiement, la plaignante présentait un problème de dépendance à l'alcool et aux médicaments. L'arbitre a accepté le dépôt de cette preuve et il n'a pas retenu la prétention de l'employeur selon laquelle, lors du congédiement, celui-ci ignorait le problème de dépendance alcoolique de la plaignante. Il a finalement conclu que le congédiement était fondé. L'employeur soutient que l'arbitre ne pouvait recevoir en preuve une expertise médicale effectuée 13 mois après le congédiement. Pour sa part, la plaignante fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'un événement ou d'un fait postérieur, mais plutôt la confirmation médicale d'un état que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître lorsqu'il a pris sa décision de la congédier.
DÉCISION : L'arbitre s'est penché de façon expresse sur l'objection de l'employeur à la production de l'expertise par la plaignante et il a rendu une décision écrite sur cette question. Se référant, à bon droit, à l'arrêt de la Cour suprême dans Cie minière Québec Cartier c. Québec (Arbitre des griefs), (C.S. Can., 1995-07-20), SOQUIJ AZ-95111087, J.E. 95-1525, D.T.E. 95T-881, [1995] 2 R.C.S. 1095, il a reçu cette preuve, estimant qu'elle était pertinente puisqu'elle visait à établir que la plaignante était alcoolique lorsqu'elle a été congédiée. Ainsi, l'expertise médicale, bien que portant sur un examen subséquent au congédiement, était recevable afin de permettre à l'arbitre de décider si le congédiement était raisonnable et approprié au moment où il a été décidé. La présente affaire est différente de l'arrêt précité puisque la plaignante n'a pas tenté de faire la preuve de sa réhabilitation, mais plutôt de confirmer par une expertise médicale les problèmes qu'elle éprouvait au moment de son congédiement, problèmes que l'employeur connaissait ou pouvait facilement connaître vu les faits portés à sa connaissance. Il ne s'agissait donc pas d'un événement subséquent, mais bien de l'illustration médicale d'un fait qui existait lors du congédiement. L'arbitre n'a commis aucune erreur en recevant en preuve l'expertise médicale et en tenant compte de celle-ci dans sa décision.
Par ailleurs, l'employeur a également fait valoir que l'arbitre avait décidé que le congédiement reposait sur une cause juste et raisonnable pour ensuite annuler sa décision. Or, une lecture attentive de celle-ci démontre les raisons pour lesquelles l'arbitre ne s'est pas arrêté à cette conclusion car, selon lui, elle n'était pas finale. Il a évalué la preuve médicale pertinente et l'a considérée avec l'ensemble de la preuve, pour conclure que l'employeur devait revoir sa décision à la lumière de cette nouvelle information. En raison de sa connaissance de l'état de la plaignante au moment du congédiement, l'arbitre a conclu que l'employeur savait — ou devait savoir — qu'il lui faudrait prendre des mesures d'accommodement. Pour décider si le congédiement reposait sur une cause juste et suffisante, il devait examiner la nouvelle preuve médicale parce qu'elle était pertinente afin de déterminer s'il y avait un lien entre les reproches ayant mené au congédiement et l'alcoolisme. Or, il a conclu à l'absence d'un lien direct entre la dépendance alcoolique de la plaignante et ses difficultés à offrir une prestation normale de travail. Ces constatations factuelles ne sont pas incorrectes, déraisonnables ou manifestement déraisonnables. L'employeur devait, devant la connaissance évidente du problème d'alcool de son employée, appliquer les mesures d'accommodement qui s'imposaient et non pas la congédier.
Hydro-Québec c. Tremblay, SOQUIJ AZ-50452734
Obligation d’accommodement et entente de dernière chance
Le plaignant a été embauché en 2000 à titre d'employé polyvalent remplaçant et il a été mis à pied le 13 septembre 2003. Un mois auparavant, on l'avait rencontré au sujet de son manque d'assiduité et l'employeur, avisé de son problème de toxicomanie, avait conclu avec lui une entente de dernière chance. Dans ce contexte, le plaignant a suivi une cure de désintoxication payée par l'employeur pendant sa période de mise à pied. Il a été rappelé à titre d'opérateur de presses le 25 janvier 2004. Le 27 avril suivant, il est arrivé en retard et son superviseur a discuté avec lui, puis l'a accompagné jusqu'à son poste de travail. Le superviseur a ensuite vérifié sa carte de pointage pour constater qu'elle n'avait pas été pointée. Il a alors avisé la direction et l'employeur a vérifié toutes les cartes du plaignant depuis son rappel au travail pour constater que ce dernier n'avait pas pointé de façon régulière. Il a été congédié le 28 avril au motif que l'omission régulière de pointer contrevenait aux engagements pris lors de l'entente de la dernière chance d'août 2003. Le syndicat fait valoir que l'employeur avait l'obligation d'accommoder le plaignant et qu'il ne pouvait le congédier pour le seul retard du 27 avril. De son côté, l'employeur allègue que le plaignant s'était officiellement engagé à respecter les politiques qui lui étaient applicables et que toute omission de sa part entraînerait son congédiement immédiat.
DÉCISION : L'employeur ne pouvait invoquer les manquements à l'obligation de pointer ou les retards au travail entre le 21 février et le 26 avril sans autre analyse. Il ne pouvait faire fi des difficultés du plaignant eu égard à sa toxicomanie. Dès qu'il a été informé d'une difficulté avec une carte de pointage du plaignant, il se devait d'intervenir auprès de ce dernier afin de lui fournir l'aide, le soutien et l'encadrement nécessaires pour qu'il respecte le mieux possible ses engagements. En somme, il devait se demander s'il y avait encore lieu d'accommoder le plaignant. Si l'employeur était d'opinion qu'il s'agissait de manquements disciplinaires, il se devait de faire enquête pour s'assurer que les nouveaux manquements constatés n'avaient rien à voir avec le problème qui avait été reconnu à l'été 2003. En outre, le fait pour l'employeur d'avaliser les cartes de temps du plaignant sans intervenir a fort probablement eu pour effet de laisser croire à celui-ci qu'il pouvait continuer à se comporter de cette façon plutôt que de faire les efforts pour apporter les correctifs nécessaires à sa conduite fautive. L'employeur ne pouvait donc pas considérer les manquements du 27 avril et ceux qui ont précédé comme une suite motivant l'application de la décision de congédier ni comme un fait culminant pouvant entraîner la même conséquence. Quant à l'obligation d'accommodement, pour qu'elle ne s'impose pas à l'employeur, il aurait fallu qu'il démontre que la situation créait une contrainte excessive. Or, ce dernier n'a pas fait enquête et a plutôt décidé d'appliquer de façon automatique la conclusion prévue à l'entente de dernière chance.
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 143 et Goodyear Canada inc. (Benoît Trudel), SOUIJ AZ-50436923
Problème de jeu pathologique et compétence de l’arbitre
La plaignante, caissière dans une banque, a été congédiée pour s'être approprié des sommes d'argent de 2000 $ et de 500 $. Elle a reconnu avoir commis les vols. Sa conduite découle de sa passion maladive pour le jeu, qu'elle a développée quelques mois avant son congédiement. Peu auparavant, elle avait parlé de son problème à son mari et avait commencé à assister à des réunions de joueurs anonymes. Après son congédiement, elle a entrepris une psychothérapie. Devant l'arbitre, elle a admis des récidives de jeu. Après avoir considéré les facteurs aggravants — le vol portant atteinte au lien de confiance, la nature du poste occupé et le manque de franchise, car elle n'avait pas avoué une rechute récente devant l'arbitre — et atténuants — son honnêteté en général et le fait que le vol soit contraire à ses propres valeurs, la pathologie dont elle souffrait lors des vols, son état de détresse à ce moment, sa longue ancienneté et son dossier disciplinaire vierge —, l'arbitre a annulé le congédiement et a ordonné sa réintégration, mais sans indemnité. Il a conclu que le risque de récidive de vol était très minime, car la plaignante n'était pas foncièrement malhonnête et que le vol découlait plutôt de sa maladie et de ses problèmes financiers, lesquels étaient maintenant résolus. Il s'est appuyé sur une preuve d'expert. Il a aussi conclu que le risque de récidive de jeu, s'il existait, ne comportait pas les mêmes risques pour l'employeur que le risque de récidive d'autres maladies, comme l'alcoolisme ou la toxicomanie, qui peuvent nuire à la prestation de travail de l'employé. L'employeur demande la révision judiciaire de cette décision.
DÉCISION : Selon la preuve d'expert que l'arbitre pouvait retenir, les risques de récidive de vol étaient minimes même s'il existait des risques de récidive de jeu. Selon cette preuve, les risques de récidive de jeu n'emportaient pas nécessairement des risques de récidive de vol. Il n'était pas non plus déraisonnable de conclure que la pathologie du jeu diffère de l'alcoolisme ou de la toxicomanie quant aux conséquences de ces maladies pour l'employeur — absences répétées, atteinte à la prestation de travail. Cette comparaison n'est pas dénuée de toute logique ni manifestement déraisonnable. Quant au lien de confiance, l'arbitre avait le pouvoir de décider s'il était rompu ou non, quelle que soit l'opinion de l'employeur à ce sujet. En effet, s'il en était autrement et s'il suffisait à l'employeur d'affirmer l'impossibilité de continuer l'emploi, les textes de la convention collective et du Code canadien du travail reconnaissant à l'arbitre le pouvoir de modifier la sanction et d'y substituer celle qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances seraient dénués de toute portée pratique. Par ailleurs, la sanction que l'arbitre a substituée au congédiement, soit une réintégration sans indemnité, équivaut à une suspension de deux ans et demi. L'arbitre a examiné les facteurs atténuants et aggravants de même que les risques de récidive et il a retenu que la plaignante suivait une thérapie, qu'elle avait pris conscience de sa maladie et qu'elle avait réglé tous ses problèmes financiers, ce qui diminuait les risques de récidive de vol. C'est dans ce contexte que l'arbitre a conclu que le lien de confiance devait subsister et qu'il y avait lieu d'ordonner la réintégration de la plaignante. Le processus décisionnel suivi respecte la compétence de l'arbitre et sa décision n'est pas manifestement déraisonnable.
Banque Laurentienne du Canada c. Lussier
(Banque Laurentienne du Canada et Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 434), SOQUIJ AZ-50084054
Problème de jeu pathologique et obligation d’accommodement
Le syndicat allègue que le jeu pathologique constitue une maladie qui doit être reconnue comme un handicap et que l'employeur avait une obligation d'accommodement. Il avance que ce dernier aurait pu resserrer les mesures de contrôle.
DÉCISION : Le salarié qui ne souffre d'aucun handicap doit satisfaire à toutes les obligations qui découlent de son contrat de travail, qu'il s'agisse d'obligations liées à la prestation de travail — l'assiduité, la qualité du travail — ou d'obligations liées au comportement — la loyauté, la civilité ou l'honnêteté. Le salarié souffrant d'un handicap peut être empêché, en raison de ce handicap, de remplir toutes ces obligations. L'obligation d'accommodement à l'égard d'un salarié souffrant d'un handicap suppose d'évaluer les possibilités d'assouplir les obligations qui découlent du contrat de travail afin de lui permettre de conserver son emploi malgré l'incapacité qui résulte de ce handicap, à savoir qu'il manque à l'une ou l'autre de ses obligations. L'étendue de l'obligation d'accommodement de l'employeur — et les mesures d'accommodement qui pourront être envisagées — varie selon la nature du handicap du salarié et la nature des manquements aux obligations découlant du contrat de travail. En l'espèce, la maladie dont souffre le plaignant est le jeu pathologique et le manquement aux obligations découlant de son contrat de travail concerne son obligation d'honnêteté. Il s'agit d'une maladie sur laquelle le salarié peut exercer un certain contrôle. D'autre part, le manquement du plaignant à son obligation d'honnêteté constitue un manquement volontaire. Une telle situation doit être traitée différemment de celle d'un salarié qui, involontairement, est incapable d'effectuer certaines tâches de son emploi. Il est difficile d'imaginer comment un employeur peut envisager une mesure d'accommodement à l'égard d'un salarié qui manque à son obligation d'honnêteté. Le fait de resserrer les mesures de contrôle n'est pas une mesure d'accommodement mais d'autoprotection.
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) et Québec (Ville de), (Serge Messier), SOQUIJ AZ-50334929
Problème de jeu pathologique allégué comme moyen de défense
Le plaignant a été congédié le 25 juin 1998. Il soutient qu'il a commis les vols dans le but d'aller jouer au casino et de s'acheter des billets de loterie parce qu'il était dépendant de sa maladie. L'employeur s'oppose à la recevabilité de toute preuve de faits postérieurs à la date du congédiement.
DÉCISION : L'objection de l'employeur vise, d'une part, la preuve que le plaignant souffrait de dépendance pathologique au jeu et, d'autre part, la preuve de sa réhabilitation. Dans le premier cas, même si le diagnostic a été posé après le congédiement, la preuve porte sur la période où les vols ont été commis, soit avant le congédiement en question. Il ne s'agit donc pas de faits postérieurs et l'objection est rejetée à cet égard. Dans le second cas, il s'agit effectivement de faits postérieurs au congédiement. Il faut évaluer la pertinence de cette preuve pour décider de sa recevabilité. Même si l'employeur n'avait pas obtenu, au moment du congédiement, le diagnostic de dépendance pathologique au jeu, le plaignant lui avait fait savoir qu'il avait un problème. Il savait ou aurait dû savoir qu'il y avait une possibilité que ce dernier soit diagnostiqué en tant que joueur pathologique, auquel cas la question de la réhabilitation aurait pu ou aurait dû être considérée. Au moment du congédiement, l'employeur ne peut faire l'autruche pour ensuite invoquer son ignorance de la maladie et de la question sous-jacente de la réhabilitation. En conséquence, le plaignant peut présenter sa défense de dépendance pathologique au jeu, laquelle comporte nécessairement l'étude de la possibilité de réhabilitation.
En règle générale, en matière de dépendance pathologique, deux types de situations se présentent. Le premier type concerne des cas où le congédiement découle du dossier d'absentéisme ou du rendement au travail. L'état de santé de l'employé est alors examiné tant pour expliquer la situation vécue avant et au moment du congédiement que pour faire des pronostics sur les chances de réhabilitation. Quant au second type, duquel fait partie le cas de l'espèce, il s'agit de situations où un employé est congédié pour avoir volé, fraudé ou autrement commis des actes répréhensibles. La défense de jeu pathologique est alors invoquée dans le but d'expliquer que, même si l'employé était conscient qu'il commettait des infractions, celles-ci relèvent de sa dépendance. Dans cette catégorie, la jurisprudence fait généralement trois distinctions. Premièrement, elle distingue les cas de vols ou de fraudes de peu de valeur, commis pendant une courte période de temps, des cas de vols ou de fraudes d'objets coûteux, commis à répétition et durant une longue période de temps. Deuxièmement, elle distingue les cas où le vol ou la fraude touche l'employeur en tant que propriétaire des biens des cas où un tiers est visé, telle la clientèle, auquel cas l'acte nuit directement à la réputation de l'employeur. Troisièmement, dans cette dernière situation, la jurisprudence distingue selon que les infractions s'attaquent ou non à la mission même de l'entreprise. En l'espèce, le législateur a créé la Société canadienne des postes et lui a donné une mission particulière, à savoir livrer correctement le courrier, et ce, en toute sécurité. Lorsqu'un employé ouvre et vole du courrier, comme l'a fait le plaignant, pendant une longue période de temps, ce n'est pas seulement le lien de confiance entre l'employeur et lui qui est en cause, mais également la relation de confiance entre la clientèle et cet employé. Puisqu'un tel manquement préjudicie à la réputation de la Société à l'égard de sa clientèle, il touche également la relation de confiance entre la Société canadienne des postes et sa clientèle. En l'espèce, l'employeur a le devoir de s'assurer que ses employés respectent sa mission et ne mettent pas en péril le lien de confiance que doivent avoir la Société canadienne des postes et ses employés avec la clientèle et la société en général. Même si le plaignant a donné à l'employeur de bons et loyaux services, qu'il était atteint d'une maladie et que son cas est pathétique, les vols ont duré près de deux ans et totalisent environ 5000 $. La réputation de l'employeur en est directement atteinte, et le plaignant a trahi la mission de la Société canadienne des postes. En conséquence, le lien de confiance est définitivement rompu et les griefs sont rejetés.
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et Société canadienne des postes (Delisle et Société canadienne des postes), SOQUIJ AZ-99142115
Distinction entre la dépendance au jeu et la relation d’abus au jeu
L'employeur reprochait à la plaignante de s'être approprié sans autorisation plusieurs milliers de dollars en falsifiant des chèques, en détournant des fonds et en utilisant une carte de crédit lui appartenant. Il soutient que la plaignante ne peut bénéficier de facteurs atténuants. Il ajoute que la preuve démontre qu'elle n'a pas commis les gestes illégaux en raison d'une maladie psychiatrique, mais plutôt d'un comportement d'« abus du jeu », qui ne peut être pardonné. Pour sa part, le syndicat affirme que la plaignante souffrait d'une dépendance pathologique, d'un lourd passé médical et d'un état de dépression au moment des événements qui lui sont reprochés. Il affirme aussi qu'elle comptait 27 ans d'ancienneté et qu'elle avait un dossier disciplinaire vierge.
DÉCISION : La preuve révèle que la plaignante s'est approprié une somme de 35 456,76 $, en sus des 10 000 $ qu'elle a remboursés, en falsifiant des chèques, en détournant des fonds et en utilisant une carte de crédit. Or, étant donné qu'elle occupait le poste de responsable du budget dans une école et qu'il lui incombait de traiter les chèques, les conciliations bancaires, les factures et les dépôts, l'employeur a jugé que ses comportements rompaient le lien de confiance nécessaire au maintien du lien d'emploi. Le syndicat prétend qu'elle a agi sous l'influence d'une dépendance pathologique au jeu. Toutefois, deux médecins experts estiment qu'elle entretenait avec le jeu une relation d'abus et non de dépendance. Ces témoins expliquent que l'abus du jeu ne constitue pas une maladie et ils concluent que la plaignante était pleinement consciente lorsqu'elle commettait les gestes qui lui sont reprochés. Par conséquent, le Tribunal ne retient pas l'argument selon lequel cette dernière souffrait de dépendance pathologique et qu'un tel fait constituait un facteur atténuant. Il ressort de la preuve qu'elle a abusé de la confiance que lui manifestait l'employeur afin d'exécuter ses manœuvres frauduleuses. Ses bons et loyaux services ainsi que son dossier disciplinaire vierge ont constitué des instruments facilitant le détournement des fonds plutôt que des facteurs atténuants. Par ailleurs, bien qu'elle ait avoué en partie ses fautes, elle a continué de nier certains détournements de fonds en dépit de la preuve présentée. Les fonctions de la plaignante et la gravité objective des fautes constituent des facteurs aggravants. Pour ces motifs, le congédiement est maintenu.
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île et Syndicat du personnel de soutien de la Pointe-de-l'Île, SOQUIJ AZ-50216629
COMMENT TROUVER LES DÉCISIONS MENTIONNÉES DANS CET ARTICLE?
- Accéder au site Internet Azimut de SOQUIJ
- Sélectionner la banque Juris.doc.
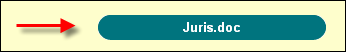 |
- Entrer votre code d'accès et votre mot de passe.
COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE?
Deux façons s'offrent à vous...
- Chacune des décisions mentionnées dans cet article a une référence AZ
(par exemple AZ-50404551). Pour retrouver cette décision, il faut :
- accéder à l’écran Choix de banque de Juris.doc;
- utiliser la case de recherche par référence AZ;
- accéder à l’écran Choix de banque de Juris.doc;
 |
- Pour effectuer une recherche portant sur l’alcool et le jeu, il faut :
- accéder à l’écran de recherche par Mots clés de la banque Juridictions en relations du travail;
 |
- Inscrire vos mots clés.
1ere recherche
 |
2e recherche
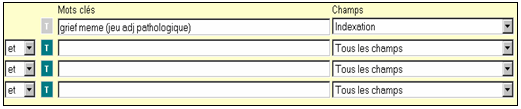 |
Pour toute question relative à l'utilisation d'AZIMUT, Documentation juridique, communiquez avec le Service d'aide aux utilisateurs au 514 842-AIDE ou, sans frais, au 1 800 356-AIDE, de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi.
Me Monique Desrosiers, coordonnatrice, Secteur droit du travail et droit social, Direction de l’information juridique à la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
Source : VigieRT, numéro 24, janvier 2008.


