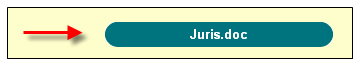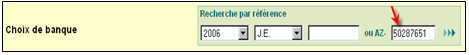L’année 2006 aura été riche en développements, tant en ce qui concerne les relations du travail que l’interprétation des nombreuses lois et règles qui viennent encadrer la gestion des ressources humaines et la représentation des membres d’un syndicat. Voici une brève revue des faits saillants de l’année en fonction des différents sujets couverts par le service
L'employeur n'a pas le droit d'intervenir dans un débat sur le caractère représentatif même s'il prétend que des adhésions ont été obtenues par des manœuvres d'intimidation de la part du syndicat; il ne peut non plus assister à l'audience, car il ne s'agit pas d'un débat contradictoire et que l'appartenance des salariés à l'association est confidentielle.
L'employeur demande à la Commission des relations du travail (CRT) de déclarer qu'il a le droit de participer à l'enquête sur le caractère représentatif parce que sa démarche vise à faire reconnaître le caractère illégal de gestes du syndicat, lesquels ont permis à ce dernier d'obtenir l'adhésion d'une majorité de salariés en violant les dispositions de l'article 13 du Code du travail (C.tr.). Subsidiairement, il a aussi fait valoir qu'il a le droit d'être présent dans la salle lors de l'audience portant sur le caractère représentatif. De leur côté, les salariés demandent à la CRT de leur fournir copie des rapports préparés par l'agent de relations du travail à la suite de deux sondages qu'il a menés auprès des salariés visés par l'unité de négociation recherchée par le syndicat.
DÉCISION : L'article 32 C.tr. édicte que, lors de la détermination du caractère représentatif d'une association, les seules parties intéressées sont les salariés compris dans l'unité de négociation ou l'association de salariés intéressée. L'employeur n'est donc pas une partie intéressée à l'enquête portant sur la détermination du caractère représentatif, ce qu'il reconnaît. Il fait cependant valoir que le syndicat ou ses représentants ont contrevenu à l'article 13 C.tr. et qu'il a par conséquent le droit d'intervenir pour demander à la CRT de rejeter les adhésions obtenues sous l'emprise d'intimidation ou de menaces, ou encore en violation de la Charte des droits et libertés. Or, déterminer si des adhésions ont été obtenues sous l'emprise de la menace ou de l'intimidation, c'est évaluer leur qualité, cette question étant incluse dans l'examen du caractère représentatif. L'employeur cherche donc à contourner l'application de l'article 32 C.tr. De plus, il n'a pas l'intérêt pour se plaindre et il ne peut plaider pour autrui. Seuls les salariés sont en mesure de prétendre qu'ils ont été victimes d'intimidation ou de menaces pour être amenés à signer une formule d'adhésion.
La demande de l'employeur afin d'assister aux audiences de la CRT sur le caractère représentatif est rejetée. Il est vrai que la Cour supérieure, à la suite d'une requête des salariés, a ordonné la tenue d'une audience publique. Toutefois, cette obligation doit être exécutée conformément aux dispositions du Code du travail, qui prévoit des exceptions à ce principe en matière d'accréditation. Ainsi, l'article 117 C.tr. édicte que, avant d'accréditer une association de salariés, l'agent de relations du travail doit permettre aux parties intéressées de présenter leurs observations et de produire des documents. Il ne peut cependant tenir une audience pour permettre aux parties de se faire entendre. Les modifications apportées au Code n'ont rien changé quant aux dispositions relatives à l'enquête à mener pour trancher une requête en accréditation. Il s'agit d'une enquête de nature administrative et non d'un débat contradictoire. L'article 23 de la Charte ne s'applique donc plus. En outre, le fait que l'employeur n'ait pas le statut de partie intéressée quant au caractère représentatif écarte l'application des principes de justice naturelle. Par ailleurs, l'article 36 C.tr. impose l'obligation de taire l'appartenance à une association de salariés au cours de la procédure d'accréditation. Or, pour vérifier si les conditions énoncées à l'article 36.1 sont remplies, la CRT doit évaluer la validité de cette appartenance. Aussi, pour assurer la confidentialité des adhésions, seuls pourront demeurer dans la salle d'audience les représentants de l'association de salariés et les salariés intervenants.
La demande des salariés afin d'obtenir copie des rapports de l'agent de relations du travail est rejetée. Le « rapport de toute enquête » auquel fait référence l'article 30 C.tr. vise uniquement celui préparé au cours de l'enquête mentionnée à l'article 29, portant sur une contravention appréhendée à l'article 12. Dans le contexte d'une requête en accréditation, l'article 28 parle plutôt de vérification par l'agent de relations du travail. Il est prévu que l'agent peut effectuer un sondage ou une recherche sur toute question relative à l'accréditation. Ces démarches sont distinctes de l'enquête et ne sont pas visées par l'article 30. En outre, seuls les articles 28 et 30 prévoient l'obligation pour l'agent des relations du travail de préparer un rapport. En l'espèce, un rapport a été produit conformément à l'article 28 et remis aux parties à la suite d'un premier sondage.
Conseil du Québec — Unite Here et Groupe Dynamite inc., SOQUIJ AZ- 50394456
Il n’y a pas de transmission des droits et obligations de l'ancien employeur au nouveau du fait que l'entretien ménager a été confié en sous-traitance car, outre les fonctions et le droit d'exploitation, il n'y a pas eu cession des autres éléments caractéristiques de l'entreprise.
Le syndicat a été accrédité en 1982 pour représenter tous les concierges salariés de l'école. En 2004, cette dernière a décidé de confier en sous-traitance l'entretien ménager. En décembre, un contrat a été accordé à Services CB Star, entreprise présidée par un ancien administrateur de l'école, et ce, à compter du 1er mars 2005. Le 28 février, tous les salariés d'entretien de l'école ont été licenciés. Le 7 avril suivant, le syndicat a déposé une requête : afin que soit écartée l'application du troisième alinéa de l'article 45 C.tr. selon les dispositions de l'article 46 C.tr., afin qu'il soit déclaré que CB Star est liée par l'accréditation et la convention collective et afin que soit écartée l'application du premier paragraphe de l'article 45.2 C.tr. de telle sorte que CB Star demeure liée par la convention collective jusqu'à l'expiration de celle-ci.
DÉCISION : Pour que s'applique l'article 45 C.tr., il faut déterminer si, au-delà des fonctions ou du droit d'exploitation, d'autres éléments caractéristiques de l'entreprise visée par la concession ont fait l'objet d'un transfert. L'examen de ces éléments ne doit pas se faire de façon purement quantitative, mais en les pondérant pour tenir compte de leur importance relative. Par ailleurs, l'absence d'autres éléments caractérisant l'entreprise, à l'exclusion des fonctions ou du droit d'exploitation, ne saurait suffire pour constater la transmission des droits et obligations. Il serait réducteur de limiter ces autres éléments caractéristiques à l'équipement, qu'il s'agisse, comme en l'espèce, des seaux, balais et autres instruments utilisés par les salariés dans leur travail. En effet, comme dans toute autre entreprise, une entreprise d'entretien ménager possède, outre les fonctions et l'équipement, d'autres moyens pour permettre « substantiellement la poursuite en tout ou en partie d'activités précises ». Parmi ceux-ci, les salariés constituent un élément prépondérant. Or, aucun d'eux n'a été transféré. Il faut également tenir compte du savoir-faire qui contribue à caractériser les activités et ce n'est pas parce que les directrices de l'école peuvent à l'occasion modifier la routine établie par CB Star qu'il y a un transfert d'expertise de l'école à cette dernière. Ainsi, en l'absence de transfert de quelque autre élément caractéristique de l'entreprise que les fonctions, il est impossible de conclure à une concession justifiant la transmission des droits et obligations. Quant à la requête du syndicat visant l'application du dernier alinéa de l'article 46 C.tr., lequel accorde à la Commission des relations du travail le pouvoir d'écarter l'application du troisième alinéa de l'article 45, cette disposition impose comme condition que la requête ait été déposée au plus tard le 30e jour suivant la prise d'effet d'une concession partielle d'entreprise. Il s'agit donc d'un délai pour agir qui doit être considéré comme impératif; l'omission de s'y conformer empêche l'exercice du recours. En l'espèce, le syndicat a fait valoir que le point de départ de la computation du délai est le jour où il a pris connaissance des faits à l'origine du recours. Or, l'article 46 indique que cette cause d'action est la prise d'effet de la concession partielle et la preuve démontre que ce dernier savait dès le 1er mars — si ce n'est le 28 février — que l'entretien ménager se poursuivait à l'école et qu'il n'était plus assuré par les salariés qu'il représente. Même s'il ne connaissait pas, dès ce moment, l'identité du remplaçant, le syndicat n'a pas agi avec diligence afin de l'identifier. Sa requête est par conséquent irrecevable et doit être rejetée.
ion des employées et employés de service, section locale 800 et 9066-7148 Québec inc.
(Services CB Star), SOQUIJ AZ-50385122
L'employeur — une entreprise de fabrication et de distribution de câbles électriques à haute tension — a contrevenu aux dispositions anti-briseurs de grève en affectant un salarié informaticien à des fonctions normalement dévolues à d'autres salariés alors en grève.
L'employeur exploite une entreprise de fabrication et de distribution de câbles d'énergie à haute tension. La convention collective est expirée depuis le 22 mars 2006 et le droit à la grève est acquis depuis le 22 juin. Le 13 juillet, le syndicat a déclenché une grève et, le 16 août suivant, il a demandé qu'une enquête soit tenue afin de vérifier si des personnes non visées par l'unité d'accréditation accomplissaient des tâches relevant des salariés en grève. Le rapport de l'enquêteur n'a révélé aucune infraction précise aux dispositions anti-briseurs de grève.
DÉCISON : Selon les prétentions du syndicat, la première personne visée par la requête est un salarié faisant partie de l'unité de négociation. Celle-ci est au service de l'employeur depuis 1978 et fait partie du personnel cadre à titre de superviseur des inventaires depuis septembre 2005. Or, l'interdiction prévue à l'article 109.1 a) C.tr. vise l'embauche d'une personne après la date du début de la phase des négociations, soit le 22 mars 2006. La requête porte également sur des mécaniciens industriels au service d'un sous-traitant qui exécutent différentes tâches dans l'établissement. L'interdiction prévue à l'article 109.1 b) C.tr. vise l'utilisation, dans l'établissement où il y a grève, des services de personnes travaillant pour des tiers afin de remplir les fonctions des salariés en grève. Or, en l'espèce, l'employeur a recours à des fournisseurs habituels, lesquels ne font pas exécuter par leurs employés des tâches liées à la production, à la réception et à l'expédition, au contrôle de la qualité et à l'entretien normalement accomplies par les salariés faisant partie de l'unité de négociation. La troisième personne visée par la requête est un informaticien engagé par l'employeur et ne faisant pas partie de l'unité de négociation. Il a été vu dans le secteur de l'expédition, travaillant à la préparation de tourets de fils électriques et conduisant un chariot élévateur. Or, ces fonctions n'entrent pas dans celles dévolues à un informaticien, mais sont celles de salariés en grève. Il y a donc violation à l'article 109.1 g) C.tr. Cette situation doit être redressée, même provisoirement.
Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 6687 et Nexans Canada inc., SOQUIJ AZ-50392657
ASSOCIATION DE SALARIÉS ET DROIT D’ASSOCIATION
Le syndicat n'a pas fait un examen sérieux du cas du plaignant, qui demandait une application particularisée de la clause de la convention collective prévoyant la perte d'ancienneté et d'emploi après une période d'absence de 36 mois, et ne s'est pas assuré que l'employeur avait rempli son obligation d'accommodement raisonnable; la plainte en vertu de l'article 47.3 C.tr. est accueillie.
Le plaignant, un opérateur de machinerie lourde, s'est absenté du travail en raison de problèmes lombaires. Selon la convention collective qui lui est applicable, un salarié perd son ancienneté et son emploi à la fin d'une période d'absence pour maladie ou accident de 36 mois. Dans son cas, cette période venait à échéance au mois de mai 2004. Son médecin l'ayant informé qu'une intervention chirurgicale, qui devait être pratiquée au début du mois de juin 2004, pourrait lui permettre de reprendre son travail dès le mois de septembre suivant, le plaignant s'est adressé au directeur des ressources humaines de l'employeur, le 10 mai 2004, afin d'obtenir une prolongation de la période d'absence prévue à la convention. Quelques jours plus tard, il a rencontré le président du syndicat. Celui-ci, affirmant être convaincu que l'employeur pouvait rompre le lien d'emploi compte tenu des termes clairs de la convention, a toutefois accepté de faire une demande écrite d'extension du délai. Le 28 mai suivant, le plaignant a été informé de la perte de son ancienneté et de sa fin d'emploi. Il allègue que le syndicat a manqué à son devoir de représentation en ne déposant pas de grief pour contester le refus de l'employeur de prolonger la période d'absence prévue à la convention ainsi que la rupture du lien d'emploi. De façon préliminaire, l'employeur fait valoir que la plainte est tardive parce qu'elle a été déposée plus de six mois après la fin d'emploi.
DÉCISION : Le délai de six mois prévu à l'article 47.3 C.tr. commence à courir à compter de la prise de connaissance, par le salarié, du manquement au devoir de représentation. En l'espèce, ce n'est que lors d'une rencontre formelle ayant eu lieu le 25 janvier 2005 que le syndicat a avisé le plaignant qu'il ne déposerait pas de grief. En effet, depuis le mois de mai 2004, le plaignant avait été tenu dans l'ignorance des intentions réelles du syndicat. La plainte ayant été déposée le 1er avril 2005, elle n'est pas prescrite. Quant au fond, l'importance d'une mesure telle qu'une fin d'emploi, l'âge du plaignant (58 ans) et le cumul de 23 années de service chez l'employeur constituent des éléments qui auraient dû inciter le syndicat à agir avec beaucoup de sérieux et de prudence, et ce, d'autant plus qu'à l'époque l'état du droit était incertain. La demande de prolongation de délai du plaignant — qui est atteint d'un handicap en raison de sa condition lombaire — constituait une demande d'application particularisée de la convention correspondant à une mesure d'accommodement. Un syndicat doit contribuer avec l'employeur et le salarié dont les droits fondamentaux sont compromis en raison d'une application rigide de la convention collective. Il doit, entre autres choses, s'assurer que l'employeur a rempli son obligation d'accommodement raisonnable. En l'espèce, le syndicat a fait abstraction de la situation particulière du plaignant. Il l'a laissé agir seul et multiplier les démarches auprès de l'employeur en lui répétant qu'il serait toujours temps de déposer un grief si les discussions échouaient. Il n'a aucunement considéré qu'il y avait risque d'atteinte à des droits fondamentaux ni pris en considération les obligations de l'employeur dans un tel contexte. En omettant de faire un examen attentif et sérieux du cas du plaignant, le syndicat a agi de façon arbitraire et négligente, contrevenant ainsi à l'article 47.2 C.tr. Le tribunal autorise le plaignant à présenter sa réclamation à un arbitre comme s'il s'agissait d'un grief, et ce, aux frais du syndicat. Ce dernier devra lui rembourser les frais engagés pour la présentation de la plainte.
Maltais et Section locale 22 du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP), SOQUIJ AZ-50379761
L'article 36 C.tr. ne peut être déclaré inopérant compte tenu du tort qui risquerait d'être causé aux salariés ayant adhéré à l'association en croyant, avec raison, que leur appartenance ne serait pas dévoilée, en particulier à l'employeur.
Pendant l'audience relative à une demande d'ordonnance provisoire visant à faire cesser toute entrave de l'employeur aux campagnes de syndicalisation de ses établissements et à lui interdire d'annoncer la fermeture de l'un de ses commerces ou d'en fermer un, le coordonnateur des campagnes de recrutement syndical a été appelé à témoigner sur le déroulement de celles-ci. Au cours de son contre-interrogatoire, le procureur de Wal-Mart lui a demandé le nom de la personne qui avait communiqué avec les organisateurs syndicaux de l'un des établissements. Le procureur des requérants s'est opposé à cette question, qui risquait d'entraîner la divulgation du nom d'une personne ayant adhéré au syndicat. La Commission des relations du travail (CRT) a accueilli son objection, estimant que l'article 36 C.tr. était applicable. Elle doit maintenant trancher l'objection préliminaire en tenant compte de l'argument de Wal-Mart fondé sur son droit à une défense pleine et entière garanti par l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne.
DÉCISION : La confidentialité des adhésions syndicales est au coeur du régime de droit mis en place afin d'assurer aux salariés le plein exercice de leur liberté d'association. Elle appartient à la personne qui adhère et elle seule peut y renoncer. En l'espèce, même si le témoin contre-interrogé par Wal-Mart voulait dévoiler le nom de certaines personnes, il n'aurait pas le droit de le faire à moins que l'article 36 C.tr. ne soit déclaré inopérant. Or, cela ne constitue pas la solution à retenir, bien que Wal-Mart ait raison d'invoquer son droit à une défense pleine et entière. En effet, le tort qui risquerait d'être causé aux personnes ayant adhéré à l'association en croyant, avec raison, que leur appartenance ne serait pas dévoilée, en particulier à l'employeur, serait trop grand. La solution est plutôt de n'admettre aucune preuve — tant en interrogatoire principal qu'en contre-interrogatoire — qui conduirait inévitablement à la divulgation de l'appartenance d'une personne à l'association, à moins que la CRT n'ait reçu, au préalable, la preuve d'une renonciation expresse de la part de la personne en cause. La difficulté d'application de cette règle ne fait pas le poids face à la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel de l'appartenance des salariés à une association.
Boutin et Wal-Mart Canada inc., SOQUIJ AZ-50370002
La Cour supérieure confirme qu'un accordéoniste engagé à titre de salarié pour faire de l'animation dans une cabane à sucre n'est pas un artiste au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et que son employeur ne peut non plus être qualifié de producteur.
La requérante, Cabane à sucre chez Dany, a engagé un accordéoniste à titre d'employé permanent et rémunéré comme tel pour qu'il joue de la musique d'ambiance dans son établissement. À la suite d'une requête pour jugement déclaratoire par la Guilde des musiciens du Québec, la CRAAAP a rendu une décision déclarant que l'accordéoniste était un artiste au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et que la requérante était un producteur. Cette dernière demande la révision judiciaire de cette décision. Selon elle, la CRAAAP a erré en omettant de considérer les critères de base qui distinguent un salarié d'un travailleur autonome et en déclarant que la présomption prévue à l'article 6 de la loi, une fois établie, est irréfragable.
DÉCISION : Selon la CRAAAP, dès qu'une personne s'accompagne d'un instrument pour en amuser quelques autres ou créer une musique d'ambiance, dans un lieu à vocation restreinte, elle devient automatiquement un artiste assujetti à la loi puisque son employeur doit être réputé un producteur, dans quelque circonstance que ce soit. Toutefois, tout comme dans le cas de l'organiste du Centre Bell à l'occasion d'une partie de hockey, les gens ne vont pas nécessairement à la cabane à sucre pour entendre de la musique. Or, un artiste est défini comme étant une personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services moyennant rémunération, à titre de créateur ou d'interprète. Par ailleurs, l'article 6 édicte que, pour l'application de la loi, l'artiste qui s'oblige habituellement envers un ou plusieurs producteurs au moyen de contrats portant sur des prestations déterminées est réputé pratiquer un art à son propre compte. Ainsi, cet article crée une présomption, à savoir un moyen additionnel de preuve tel que prévu aux articles 2846 à 2849 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Or, pour que la présomption trouve application, certains éléments factuels doivent être présents. De plus, dès le moment où la CRAAAP évalue les faits et applique la présomption prévue à l'article 6, elle sort de son champ d'expertise pour entrer dans le domaine général de l'interprétation du droit. Il en découle que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter ou encore celle de la décision correcte. Or, en déclarant que l'accordéoniste est un artiste au sens de la loi, la CRAAAP a omis de considérer les critères de base qui distinguent un salarié d'un travailleur autonome. Elle a erronément interprété l'article 6 dans le but de créer une présomption qu'elle qualifie d'absolue et selon laquelle l'artiste conserve sa qualité de personne pratiquant à son compte parce qu'il s'oblige envers un producteur au moyen de contrats pour des prestations déterminées. Elle a donc commis une erreur qui donne à l'article 6 une portée non prévue par le législateur en ce qu'elle confond l'exécution par un artiste « au moyen de contrats portant sur des prestations déterminées » et les directives données par un employeur à un salarié dans le contexte de son emploi. Au surplus, la CRAAAP a négligé de tenir compte de la preuve démontrant l'absence de contrat portant sur des prestations déterminées, de sorte que l'interprétation qu'elle fait de l'article 6 constitue une erreur fondamentale et sa décision est manifestement déraisonnable.
9009-0531 Québec inc. (Cabane à sucre Chez Dany) c. Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs, SOQUIJ AZ-50363920 (Requête pour permission d'appeler accueillie (C.A., 2006-06-06), 500-09-016624-066, 2006 QCCA 909).
La Cour d'appel conclut à la validité de toutes les mesures actives de la Loi sur l'assurance-emploi; le législateur fédéral n'entend pas s'arroger le pouvoir de légiférer en matière de formation et d'instruction visant le retour à l'emploi non plus qu'en matière de recherche d'emploi, d'innovation et de soutien au maintien de l'emploi ou au retour sur le marché du travail.
Dans un premier temps, les appelants, des syndicats, réclament que plusieurs dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi mettant en œuvre des mesures actives, telles que les prestations d'emploi, le service national de placement, le travail partagé et les programmes de formation, soient déclarées inconstitutionnelles et invalides. Ils font valoir que ces mesures ne font pas partie de la compétence constitutionnelle du Parlement canadien en matière d'assurance-chômage. Ils précisent que, bien que le gouvernement fédéral puisse mettre en place un régime d'assurance contre le chômage, celui-ci n'a pas le pouvoir d'adopter des mesures pour combattre ce dernier. Dans un deuxième temps, les appelants invoquent l'inconstitutionnalité des articles 66, 66.1 et 66.2 de la Loi, qui régissent les cotisations exigées, lesquelles ont produit des surplus évalués à plus de 40 milliards de dollars. Ils ajoutent que le versement par le gouvernement fédéral de ces cotisations et de ces surplus dans les coffres du Trésor public est illégal.
DÉCISION : M. le juge en chef Robert : Conformément aux enseignements de la Cour suprême dans le Renvoi relatif à la Loi sur l'assurance-emploi (Can.), art. 22 et 23, (C.S. Can., 2005-10-20), 2005 CSC 56, SOQUIJ AZ-50337879, J.E. 2005-1889, D.T.E. 2005T-973, [2005] 2 R.C.S. 669, il faut rechercher le caractère véritable ou la caractéristique dominante de la Loi et déterminer ensuite à laquelle des rubriques de compétence cette caractéristique se rapporte le plus. En l'espèce, tant par leurs objets que par leurs effets, les mesures actives mises en œuvre par la Loi ont pour caractéristique essentielle de favoriser le rattachement des chômeurs au marché du travail. Ce retour au travail est un élément clé d'un régime d'assurance-chômage viable, axé non seulement sur l'indemnisation du risque de chômage, mais également sur la maîtrise de ce risque. Depuis sa création, le régime contient des mesures actives. Le retour au travail des chômeurs faisait partie à l'origine des objectifs du système d'assurance-chômage. Cependant, cette constatation n'est pas suffisante pour assurer la constitutionnalité des dispositions contestées. Chacun des moyens privilégiés pour assurer le retour au marché du travail doit aussi être vérifié sur le plan de la rubrique de compétence constitutionnelle. D'abord, le pouvoir d'instituer un service de placement prévu par le premier paragraphe de l'article 60 de la Loi relève de la compétence constitutionnelle du Parlement en matière d'assurance-chômage puisque ce type de service fait partie de la Loi depuis ses débuts. D'autre part, les articles 24 et 25 prévoyant respectivement des programmes de formation ou de travail partagé rattachent les chômeurs au marché du travail en étendant leurs prestations grâce à une présomption d'aptitude au travail en leur faveur. Or, la définition de ce qui constitue cette aptitude aux fins de l'assurance-chômage est une prérogative qui se trouve au coeur de la compétence en cette matière. Par ailleurs, les paragraphes 59 a), b) et d) de la loi — qui visent les subventions salariales, les suppléments de rémunération et les partenariats pour la création d'emploi — sont aussi constitutionnellement valides puisque, à l'instar des prestations d'assurance versées dans le contexte des programmes de formation et de travail partagé, ces mesures utilisent des moyens conformes aux caractéristiques essentielles du régime d'assurance-chômage. Cependant, les paragraphes 59 c) et e) de la Loi, qui s'apparentent à une activité de formation par l'entremise de subventions du travail indépendant et de la création d'entreprise ainsi que de subventions de perfectionnement, visent des programmes qui ne s'inscrivent pas dans une logique d'assurance ou de remplacement du revenu. Ces types de mesures actives sont donc ultra vires de la compétence du Parlement en matière d'assurance-chômage. Toutefois, cette seconde catégorie de prestations de même que les articles 60 (4) et 61 de la Loi, qui portent sur le financement des mesures de soutien et de la recherche en matière de stratégie d'adaptation et de retour au marché du travail — lesquelles ne font pas partie des moyens et objectifs du service de placement tels qu'ils ont été définis à l'origine —, ont été validement adoptés par le gouvernement fédéral en vertu de son pouvoir de dépenser. Ce dernier demeure une justification suffisante puisque les mesures actives ne sont accompagnées d'aucun système de réglementation et ne peuvent être assimilées à une tentative de régir un domaine de compétence provinciale.
MM. les juges Gendreau et Brossard : Les articles 66, 66.1 et 66.2 de la Loi bénéficient d'une validité constitutionnelle. Ces dispositions ont toujours eu pour objet le financement du régime de l'assurance-emploi. En l'espèce, la question du rapport entre le coût du service et la somme recueillie ne se pose pas puisque le Parlement a toute la compétence voulue afin de prélever des deniers par tous modes ou systèmes de taxation. Dès lors, si les cotisations exigées en application de la Loi sur l'assurance-emploi ne sont pas des frais, elles sont une taxe directe ou indirecte, et l'une et l'autre sont intra vires des pouvoirs du Parlement. Or, l'article 91 paragraphe 2A de la Loi constitutionnelle de 1867 accorde la compétence législative au Parlement en matière d'assurance-chômage. De plus, le pouvoir de ce dernier de prélever les deniers pour pourvoir à ce programme découle de l'article 91 paragraphe 3. Il n'a d'ailleurs aucune limitation dans le mode ou la forme qu'il choisit. Or, dans tous les cas, les prélèvements ont été imposés par la Loi ou un organisme qu'elle autorise expressément et ne visaient pas à permettre l'exercice d'une compétence provinciale. La prétention des appelants voulant que les paramètres définis à l'article 66 de la Loi n'aient pas été respectés par le gouvernement fédéral dans la détermination des contributions relève du domaine du droit administratif plutôt que de celui du droit constitutionnel. Par ailleurs, la prétention des appelants selon laquelle les surplus accumulés appartiennent aux cotisants et non au Trésor public et doivent servir à l'amélioration de la couverture du régime et à aucune autre fin n'est pas fondée. Le mécanisme de fixation du taux de cotisation, prévu aux articles 66, 66.1 et 66.2 de la Loi, implique la possibilité de créer un surplus visant à garantir une certaine stabilité tout au long des différents cycles économiques. Or, la législation qui régit la structure et les mécanismes de la gestion financière de l'État est soumise à l'une des composantes constitutionnelles essentielles, à savoir la nécessité de dépenser la totalité des crédits votés annuellement par le Parlement. À la fin de chaque exercice financier, tout crédit voté mais non dépensé dans un poste donné doit alors être imputé à un autre poste qui serait déficitaire ou attribué au remboursement de la dette nationale. C'est ce qui est fait avec les surplus accumulés au compte d'assurance-emploi, mais sans toucher d'aucune façon la créance du compte à l'endroit du Trésor public. La mauvaise foi future du gouvernement ne peut être présumée à travers la crainte que ce dernier refuse de couvrir un déficit du régime advenant une crise économique prolongée. Au surplus, même si une augmentation des cotisations ou une diminution des prestations devait être décidée plutôt que de faire bénéficier le compte d'assurance-emploi des surplus cumulatifs, il s'agirait alors d'une question d'ordre strictement politique à l'égard de laquelle les tribunaux n'ont aucune compétence.
Confédération des syndicats nationaux c. Canada (Procureur général), SOQUIJ AZ-50398097
Le Cégep de Trois-Rivières pouvait exiger que la secrétaire de l'École de français puisse parler et écrire l'anglais; le niveau de connaissance requis était cependant trop élevé.
L'employeur a procédé à l'affichage d'un poste de secrétaire à l'École de français afin d'assurer le remplacement temporaire de la titulaire de ce poste. L'affichage comportait l'exigence d'une bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite. Le syndicat conteste cette exigence et soutient que le poste devait être attribué à la plaignante, celle-ci possédant la plus grande ancienneté. Il admet que le poste en question peut nécessiter une certaine connaissance de l'anglais mais affirme que le niveau de connaissance exigé par l'employeur est trop élevé. L'employeur contrevient, selon lui, à la Charte de la langue française. De plus, il s'oppose à la recevabilité en preuve d'un témoignage relatif à des faits postérieurs au grief. De son côté, l'employeur explique que l'École de français accueille de nombreux étudiants anglophones et que la secrétaire doit répondre aux demandes de ces étudiants ainsi que de leurs parents. Subsidiairement, il fait valoir que l'arbitre ne possède pas le pouvoir de déterminer le niveau d'anglais que requiert le poste.
DÉCISION : Compte tenu de la nature du litige, l'objection à la recevabilité d'une preuve de faits postérieurs doit être rejetée. En effet, le Tribunal doit apprécier le poste en question non seulement au moment de l'affichage, mais antérieurement et postérieurement à tel affichage puisque ce poste, bien qu'il ait évolué dans le temps, se situe dans un continuum. Sa juste compréhension implique qu'il soit analysé dans son ensemble.
Quant au fond, si l'exigence de pouvoir parler et écrire l'anglais se justifie, le niveau de connaissance fixé par l'employeur est trop élevé. L'article 46 de la Charte, qui est réputé faire partie intégrante de toute convention collective en vertu de l'article 50, interdit à un employeur d'exiger la connaissance ou un niveau de connaissance précis d'une langue autre que le français, « à moins que l'accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance ». Cet article établit une exception au principe de l'usage du français au travail et il doit donc être interprété de façon restrictive. Le fardeau de démontrer la nécessité de la connaissance d'une autre langue que le français incombe à l'employeur en vertu de l'alinéa 5 de l'article 46. Le critère de nécessité est très exigeant. L'employeur doit démontrer non seulement que la connaissance ou qu'un niveau de connaissance précis de la langue anglaise est nécessaire pour l'accomplissement des tâches de secrétaire à l'École de français, mais aussi qu'il ne peut exister d'autres moyens raisonnables susceptibles d'éviter de nier à son personnel le droit que lui reconnaît la Charte d'exercer ses activités en français. Cette dernière obligation de moyens découle de l'article 4 de la Charte. Or, la preuve composée notamment du témoignage d'un salarié ayant occupé le poste de secrétaire en question révèle que les tâches de la secrétaire ne nécessitent pas le niveau de connaissance de l'anglais exigé par l'employeur. Il peut être souhaitable que la personne qui occupe ce poste puisse s'exprimer tant oralement que par écrit dans un anglais le plus correct possible et la clientèle ne peut que bénéficier de cette situation. Toutefois, la Charte oblige à distinguer ce qui pourrait être souhaitable de ce qui est nécessaire. L'alinéa 6 de l'article 46 prévoit expressément que l'arbitre peut rendre toute ordonnance propre qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances. En l'espèce, la plaignante possède le niveau de connaissance de la langue anglaise nécessaire pour le poste de secrétaire à l'École de français. Le Tribunal ordonne donc que le poste lui soit attribué s'il est toujours dépourvu de son titulaire et qu'elle soit indemnisée pour les sommes dont elle a été privée.
Syndicat des employés du Cégep de Trois-Rivières (CSN) et Cégep de Trois-Rivières (Gloria Hussey), SOQUIJ AZ-50390754
Telus Québec inc. étant une entreprise de compétence fédérale, elle n'est pas assujettie à la Charte de la langue française en ce qui a trait à la langue du travail.
Le plaignant soutient que Telus Québec inc. a rejeté sa candidature au poste de représentant au recouvrement ou à celui de représentant dans un centre d'appels au motif qu'il ne maîtrisait pas l'anglais. Telus fait valoir qu'elle est une entreprise de compétence fédérale non assujettie à la Charte.
DÉCISION : Il est établi que Telus a fait l'objet d'une accréditation accordée par le Conseil canadien des relations industrielles. Il s'agit d'un élément sérieux indiquant que les relations du travail dans le domaine des télécommunications relèvent, en vertu des articles 92 paragraphe 10 et 91 paragraphe 29 de la Loi constitutionnelle de 1867, de la compétence fédérale exclusive. Or, dans Côté et Banque de Montréal (C.T., 1983-06-27), SOQUIJ AZ-83144064, D.T.E. 83T-606, il a été décidé que la langue de travail constituait une condition de travail. Par conséquent, la langue de travail chez Telus relève des relations du travail sous l'empire des lois fédérales.
Girard et Telus Québec inc., SOQUIJ AZ-50372990
La Commission des relations du travail n'a pas compétence pour se prononcer sur l'application de l'article 45 C.tr. puisque, en 2002, la Cour d'appel a déclaré que l'employeur — Nutribec ltée — était une « entreprise fédérale ».
En octobre 2004, Nutribec ltée a fermé son établissement de Québec et a licencié tous ses salariés, dont les six requérants. Ces derniers soutiennent que la société Aliments Porvico ltée a poursuivi les activités de Nutribec au même endroit. Ils ont demandé à leur syndicat de s'adresser à la CRT afin qu'elle décide de la transmission des droits et obligations (art. 45 du Code du travail) de Nutribec à Porvico et de l'application par cette dernière de leur convention collective. Invoquant l'inaction de leur syndicat, ils allèguent avoir l'intérêt pour intervenir eux-mêmes, à la place de ce dernier. Nutribec et Porvico demandent à la CRT de décliner compétence puisque les tribunaux ont déclaré qu'elles sont des entreprises fédérales aux fins des relations du travail et que, par conséquent, elles ne sont pas assujetties au Code du travail.
DÉCISION : Nutribec est une entreprise spécialisée dans la fabrication industrielle d'aliments pour animaux. Le 25 septembre 2002, la Cour d'appel, à la demande de 40 minoteries du Québec, a déclaré que celles-ci étaient des entreprises de compétence fédérale parce que déclarées ouvrages à l'avantage général du Canada à l'article 76 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (Nutribec ltée c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (C.A., 2002-09-25), SOQUIJ AZ-50145797, J.E. 2002-1848, D.T.E. 2002T-941, C.L.P.E. 200LP-86, [2002] C.L.P. 467, [2002] R.J.Q. 2593). Cette déclaration fait en sorte que le syndicat ne peut exercer les droits pouvant résulter de l'accréditation qu'il détient depuis 1995 et qui lui a été accordée sous le régime du Code du travail. L'acte public de reconnaissance qu'est l'accréditation n'a pas d'effet juridique et la CRT doit décliner compétence.
Guérin et Union des employées et employés de service, section locale 800, SOQUIJ AZ-50345408
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (compétence)
Le recours en révision devant la Commission des relations du travail en vertu de l'article 127 paragraphe 3 C.tr. n'est pas un véritable droit d'appel susceptible de procurer un remède adéquat qui justifierait le refus du redressement recherché en révision judiciaire.
L'employeur a contesté la description de l'unité d'accréditation retenue par la Commission des relations du travail (CRT) dans sa décision d'accréditation. La juge de première instance a rejeté la demande en révision judiciaire au motif que l'employeur n'avait pas épuisé tous ses recours devant la CRT. Selon elle, il aurait dû demander la révision de la décision à une formation de trois commissaires, en vertu de l'article 127 paragraphe 3 du Code du travail (C.tr.). La juge a ajouté un argument prenant appui sur la restriction à la révision judiciaire dans la mesure où un droit d'appel existe. Celui-ci soulève un débat quant au sens du mot « appel », utilisé au deuxième alinéa de l'article 846 du Code de procédure civile (C.P.C.). Selon l'employeur appelant, cet article a codifié la règle de l'épuisement des recours tirée de la common law et, comme le recours en révision n'est pas un appel, la juge ne pouvait rejeter la requête en révision judiciaire.
DÉCISION : M. le juge Rochon : La Cour supérieure occupe un rôle central dans l'organisation judiciaire; elle est le tribunal de droit commun investi du pouvoir de contrôle et de surveillance des tribunaux, des corps politiques et des compagnies. Dès les origines du Code de procédure civile, l'existence d'un droit d'appel a été un motif pour refuser le recours au bref de certiorari. Jusqu'à la codification de 1966, ce droit d'appel mentionné aux chapitres des brefs de certiorari et de prohibition était l'appel à une cour de justice, soit la Cour d'appel, la Cour supérieure ou la Cour du Québec. L'article 846 C.P.C., adopté en 1966, n'a pas changé l'état du droit à cet égard et celui-ci n'a pas été modifié substantiellement depuis. Ainsi, la règle générale veut que la Cour supérieure refuse le redressement recherché en révision judiciaire s'il existe un véritable droit d'appel susceptible de procurer un remède adéquat. Le dernier alinéa de l'article 846 C.P.C. est l'expression législative partielle de la théorie de l'épuisement des recours telle qu'elle est appliquée par la Cour supérieure dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de surveillance. Bien que cette théorie soit issue de la common law, la Cour suprême du Canada a expressément reconnu son application au Québec. Contrairement à la prétention de l'employeur appelant, la codification de la règle au dernier alinéa de l'article 846 C.P.C. n'a pas pour effet d'exclure les principes généraux applicables au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure énoncés en Angleterre ou dans les autres provinces. Une conclusion préliminaire doit être tirée du syllogisme juridique de l'appelant : on doit distinguer le droit d'appel prévu à l'article 846 C.P.C. du droit de révision pour vice de fond énoncé à l'article 127 paragraphe 3 C.tr., qui n'est pas un droit d'appel à une cour de justice mais un processus de révision administratif limité. Cette conclusion ne met pas fin au débat. La théorie de l'épuisement des recours est l'une des manifestations de la nature discrétionnaire du pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Celle-ci pourra décider d'intervenir dans le litige ou s'abstenir de le faire s'il existe un recours approprié susceptible de remédier à l'illégalité commise. Le juge doit alors examiner la nature et l'étendue du recours administratif subsidiaire et non le fond du litige. En l'espèce, la juge de première instance n'a pas analysé le caractère approprié du recours administratif en vertu de l'article 127 paragraphe 3 C.tr. Sur le seul constat de son existence, elle a reproché à l'employeur appelant de ne pas l'avoir utilisé. En omettant d'évaluer le caractère approprié du recours, la juge a refusé de tenir compte d'un élément central de son analyse et, de ce fait, elle n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire en l'appuyant sur des éléments pertinents, ce qui autorise l'intervention de la Cour. Il n'y a ouverture au recours en vertu de l'article 127 paragraphe 3 C.tr. qu'en cas d'erreur grossière et, en règle générale, un processus de révision, qui est étroitement balisé, ne peut être considéré comme un recours approprié. Par conséquent, l'appel doit être accueilli et, par économie des ressources judiciaires, le dossier sera renvoyé à la juge de première instance afin qu'elle statue sur la requête en révision judiciaire.
Compagnie Wal-Mart du Canada c. Commission des relations du travail, SOQUIJ AZ-50363828 (Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2006-04-06), 500-17-024474-051, 2006 QCCS 1886, SOQUIJ AZ-50367331)
La Cour d'appel augmente le délai de congé d'un cadre licencié à 24 mois; celui-ci ne peut servir à combler les 14 mois de service qui lui manquaient pour bénéficier d'un programme de congé en préretraite.
Le salarié a travaillé pour le Canadien Pacifique de 1971 à 1978 puis de 1981 à 2001. Au moment de sa cessation d'emploi, il était directeur commercial et bénéficiait d'un salaire annuel de 123 183 $, en plus d'un boni. Il a refusé de signer une quittance en faveur de l'employeur en contrepartie du versement par celui-ci d'un délai de congé équivalant à 71 semaines, prévu par sa politique générale de résiliation. Il a reçu 23 889 $ à titre d'indemnité de cessation d'emploi. Au moment des événements, il était âgé de 52 ans et il lui manquait 14 mois pour avoir droit à un régime de congé de préretraite au cours duquel il aurait reçu la moitié de son salaire sans avoir à travailler pour l'employeur. La Cour supérieure a accueilli en partie l'action en dommages-intérêts du salarié en condamnant l'employeur à lui verser 102 712 $ pour un délai de congé de 15 mois, moins les revenus qu'il avait gagnés en travaillant à son compte. Le salarié conteste cette décision et réclame que l'indemnité attribuée soit augmentée à 513 389 $. Il soutient que la juge de première instance a erré en ne lui accordant pas les bénéfices du congé de préretraite et, subsidiairement, en lui refusant un préavis de 27 mois ainsi que des dommages moraux. L'employeur, par l'entremise d'un appel incident, allègue que la juge a erré en sous-évaluant l'obligation du salarié de réduire ses dommages.
DÉCISION : Mme la juge Bich, à l'opinion de laquelle souscrit la juge Mailhot : Lorsque l'employeur rompt unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée, l'article 2091 du Code civil du Québec l'oblige à verser une indemnité de délai de congé raisonnable. En l'espèce, le salarié doit bénéficier d'un délai de congé de 24 mois, y compris un boni pour l'année 2002. Bien qu'il se situe à la limite supérieure des possibilités raisonnables, ce préavis est justifié par l'âge du salarié, sa compétence hors pair, son dossier professionnel exemplaire, son statut de cadre supérieur, sa longue ancienneté au sein de l'entreprise ainsi que par son salaire élevé. Peu d'emplois s'offrent à lui et il a réalisé des efforts soutenus pour réduire ses dommages. De plus, l'employeur lui avait laissé entendre que son avenir professionnel était assuré si les objectifs de rentabilisation étaient atteints. De cette somme, il faut déduire le salaire gagné en juillet et en août 2001, l'indemnité déjà versée par l'employeur ainsi que les avantages sociaux accordés. Au chapitre de la réduction des dommages, les revenus que le salarié gagnait à titre de travailleur autonome ne doivent pas être totalement retranchés de l'indemnité. D'une part, ce dernier touchait déjà des revenus annuels au moment où il était au service de l'employeur. D'autre part, la politique générale de résiliation de l'employeur, qui autorise le salarié à travailler à l'extérieur durant la période de délai de congé qu'elle prévoit, est une partie intégrante du contrat de travail. Le salarié n'est pas tenu de réduire ses dommages durant les 71 semaines que cette politique lui aurait normalement accordées; il n'est tenu à le faire que pour la portion excédant le délai de congé prévu. Il bénéficie donc d'une indemnité nette de 214 094 $. Par ailleurs, le régime de congé en préretraite constitue un avantage qui ne peut être traité comme les avantages ordinairement liés à l'emploi. Sa nature est différente de ceux-ci puisqu'il s'agit d'une modalité de cessation d'emploi plutôt que d'un bénéfice associé à l'exécution du travail. Or, en août 2001, le salarié, à qui il manquait 14 mois de travail, ne satisfaisait pas au ratio exigible, lequel constituait l'une des conditions prévues par l'employeur pour se prévaloir du congé en préretraite. Ce dernier était fondé à lui accorder seulement un délai de congé raisonnable, il n'était pas tenu de retarder la terminaison du contrat du salarié jusqu'à la date où il aurait atteint le ratio nécessaire. Le droit au congé de préretraite et le droit relatif au délai de congé sont mutuellement exclusifs, étant les deux volets d'une alternative qui se concrétise au moment de la cessation d'emploi. Enfin, l'employeur a abusé de sa faculté de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il a agi d'une manière désinvolte et cavalière, mettant fin abruptement et sans avertissement au contrat de travail du salarié. De plus, il s'est entêté à lui refuser un délai de congé et à exiger une quittance dont les termes sont excessifs et inutiles. Afin d'éviter la surcompensation, l'employeur est condamné à verser 5000 $ au salarié à titre de dommages moraux.
M. le juge Nuss : Un employé qui a été congédié sans cause d'un emploi à durée indéterminée et qui n'a pu travailler durant son délai de congé doit recevoir, en plus du salaire qui lui est dû, une compensation pour les bénéfices qu'il aurait normalement retirés s'il était resté au service de l'employeur durant cette période. En l'espèce, le programme de congé en préretraite est l'un des avantages qui doivent être accordés au salarié. Dans la mesure où un délai de congé de 15 mois lui a été accordé en première instance alors qu'il aurait satisfait aux conditions requises pour accéder aux congés de préretraite au terme d'une période de 14 mois, le juge devait lui accorder une indemnité pour l'ensemble du salaire perdu à l'occasion de ce congé. L'indemnité totale à laquelle le salarié a droit se répartit en fonction de deux périodes consécutives. La première, couvrant les 14 mois nécessaires à l'obtention du congé de préretraite, s'élève à 103 072 $. Elle comprend un délai de congé de 14 mois ainsi qu'un boni pour l'année 2002, soit un total de 159 778 $, duquel il faut soustraire le salaire payé entre juillet et août 2001, l'indemnité déjà versée par l'employeur, les revenus gagnés à l'extérieur ainsi que les avantages sociaux payés par ce dernier. Quant à la seconde période, correspondant au congé de préretraite, le salarié doit toucher une indemnité représentant la moitié de son salaire annuel durant 3 ans et 10 mois ainsi qu'une indemnité additionnelle. Par ailleurs, l'employeur est condamné à lui verser 20 000 $ à titre de dommages moraux puisqu'il était abusif de sa part d'avoir tenté de se dégager de ses obligations à l'égard du régime de retraite et d'accorder par la suite un délai de congé manifestement inadéquat au moment de la cessation d'emploi.
Brisebois c. MacDonald, SOQUIJ AZ-50396451
À l'exception d'une clause accessoire déclarée illégale, la sentence arbitrale ayant déterminé les conditions de travail des cols bleus de la Ville de Montréal est confirmée.
À la suite de la constitution de la nouvelle Ville de Montréal, le 1er janvier 2002, le syndicat a été accrédité pour représenter tous les cols bleus au service des anciennes villes fusionnées. Les parties n'ayant pu s'entendre sur les termes d'une convention collective, un arbitre a été nommé par le ministre afin de trancher le différend. Il a rendu sa décision le 2 octobre 2004, laquelle tient lieu de convention collective. Il a essentiellement retenu les conditions de travail proposées par la Ville. Cette convention, entrée en vigueur au moment du dépôt de la sentence, expirera le 31 août 2007. Le 22 décembre 2004, la Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire déposée par le syndicat. Le 15 mars 2005, la Cour d'appel a accueilli la requête pour permission d'appel, limitant toutefois le débat aux cinq questions suivantes : 1) la durée de la convention collective; 2) les garanties accordées aux salariés par l'article 7 de la Charte de la Ville de Montréal; 3) la disposition législative quant à l'harmonisation des conditions de travail; 4) la méthode retenue par l'arbitre aux fins de l'harmonisation; et 5) la réouverture de la convention collective en cours de durée et l'imposition d'un nouvel arbitrage à défaut d'entente.
DÉCISION : M. le juge Forget : Le législateur, par l’entremise d'une loi particulière, a choisi de régler une question délicate et complexe — la fusion de 29 municipalités et de 29 unités de négociation — à l'aide de l'arbitrage. Or, l'arbitrage de différend est un domaine hautement spécialisé. La norme de contrôle applicable en l'espèce varie selon la nature du problème soulevé. Ainsi, la décision relative à la durée de la convention est soumise à la norme de la décision raisonnable puisque l'interprétation et l'application de l'article 92 du Code du travail (C.tr.) constituent une question de droit, un facteur qui milite en faveur d'une déférence moins grande. Quant à la conclusion relative au caractère transitoire de l'article 7 de la Charte, elle est soumise à la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable. En effet, l'arbitre devait interpréter et appliquer cet article en fonction des dispositions de la Loi sur l'organisation territoriale municipale et de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais, un exercice qui relevait expressément de son mandat. La même norme s'applique en ce qui a trait aux troisième et quatrième questions soulevées par le présent appel, soit la nécessité d'harmoniser les conditions de travail et la méthode pour ce faire; l'arbitre se trouvait alors au coeur de son mandat. Quant à la décision portant sur la réouverture de la convention, elle est soumise à la norme de la décision correcte. Elle porte sur une question de compétence, les parties n'ayant présenté aucune demande à l'arbitre à ce propos.
1) La Ville a raison d'alléguer que la décision a imposé les termes d'une « première convention collective », laquelle a une durée de trois ans puisqu'elle n'a pris effet qu'à compter du jour de son dépôt. L'arbitre a voulu agir en équité à l'égard des salariés qui n'avaient pas reçu d'augmentation salariale en 2002 en leur accordant une somme forfaitaire, ce qui est conforme à une certaine pratique chez les arbitres de différends. Sa décision est raisonnable. 2) L'article 7 de la Charte énonce que les employés des anciennes villes fusionnées deviennent, sans réduction de traitement, des employés de la nouvelle Ville et conservent leur ancienneté ainsi que leurs avantages sociaux. Cette disposition doit être lue avec l'article 176.20.1 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale. De cette façon, on peut constater que le législateur visait trois objectifs : protéger les emplois des salariés, harmoniser les conditions de travail entre ceux des anciennes villes maintenant regroupées et éviter d'augmenter le total des dépenses annuelles. Pour l'arbitre, la proposition syndicale était absurde : il ne pouvait réussir à harmoniser les conditions de travail sans augmenter les coûts s'il ne réduisait pas les conditions de travail les plus avantageuses de certains salariés. C'est ce qui lui a fait conclure que l'article 7 de la Charte n'avait qu'une portée transitoire. Son raisonnement se défend. Il n'est pas déraisonnable, et encore moins manifestement déraisonnable. 3) L'arbitre a retenu l'argument de la Ville selon lequel l'harmonisation des conditions de travail avait un caractère obligatoire et non facultatif comme le prétend le syndicat. Il n'est pas nécessaire de partager son opinion pour conclure que sa décision n'est pas manifestement déraisonnable. 4) En choisissant la méthodologie de la « meilleure offre » plutôt que de tenter de dégager un compromis, l'arbitre agissait au coeur même de sa compétence spécialisée. Sa décision à cet égard n'est pas manifestement déraisonnable. 5) Ayant appris en cours de mandat que d'anciennes municipalités avaient choisi d'être reconstituées, l'arbitre s'est cru obligé d'imposer un mécanisme de révision de la proposition d'harmonisation et, en cas d'impasse, un arbitrage liant les parties. Le syndicat a raison d'alléguer qu'aucune disposition législative ne permettait à l'arbitre de déléguer ses pouvoirs à un tiers et d'imposer un tel arbitrage. Ce faisant, il a usurpé la fonction législative. Par conséquent, la clause 38.02 de la convention collective est annulée, ce qui n'a cependant pas pour effet d'invalider la sentence arbitrale dans tous ses autres aspects.
M. le juge Beauregard : Afin de déterminer les limites de la compétence d'un décideur dans une matière donnée, il faut se demander si le législateur a voulu qu'une telle matière relève de la compétence conférée au tribunal. En l'espèce, il est manifeste que l'arbitre avait compétence pour écrire la convention collective sur laquelle les parties n'avaient pu s'entendre. Le législateur a tout de même imposé des limites à cette compétence : 1) la convention ne pouvait durer plus de trois ans; 2) en application de l'article 7 de la Charte, les salariés des anciennes villes étaient devenus des employés de la nouvelle Ville sans réduction de salaire et ils conservaient leur ancienneté ainsi que leurs avantages sociaux; et 3) l'harmonisation des conditions de travail qu'allait pouvoir faire l'arbitre ne devait pas entraîner une augmentation du total des dépenses annuelles de la nouvelle Ville. Or, le législateur n'a certes pas voulu conférer à un arbitre le pouvoir d'appliquer l'article 7 de telle façon qu'il puisse, à son gré, faire payer à certains employés le prix de la fusion, laquelle n'avait pas pour objectif de régler des questions de salaires. Quant à l'article 176.20.1 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, son but premier était de prohiber l'augmentation des dépenses comme conséquence de l'harmonisation. L'arbitre avait compétence pour interpréter l'article 7 de la Charte, mais sa décision à cet égard devait être correcte. Une question aussi fondamentale que celle portant sur la réduction des salaires des employés ne saurait être soumise à la norme de contrôle de l'erreur manifestement déraisonnable. Si l'arbitre ne pouvait augmenter les coûts, il ne pouvait non plus réduire les salaires pour parvenir à l'harmonisation. Si l'une des trois contraintes devait céder le pas, c'était celle relative à l'harmonisation. Au soir de la fusion, les employés moins payés que d'autres ne pouvaient avoir aucune expectative d'un traitement meilleur que celui qu'ils avaient auparavant. Cependant, tous les employés pouvaient avoir l'expectative que leur traitement ne serait pas diminué. Étant donné que la réduction du salaire de certains employés était au coeur de la sentence arbitrale et que plusieurs autres clauses de la convention en sont tributaires, il faut casser la sentence dans son entier.
M. le juge Dufresne : L'article 7 de la Charte est essentiellement une mesure transitoire visant à confirmer le statut et les conditions de travail des employés des municipalités fusionnées à l'instant où la ville résultant de la fusion prend naissance. Une telle disposition vise à assurer stabilité et continuité dès le premier jour de la nouvelle Ville. D'autre part, la Loi sur l'organisation territoriale municipale prévoit les mécanismes qui permettent d'arrêter les termes d'une première convention collective. Ainsi, si les parties ne s'entendent pas à ce sujet, une procédure de règlement du différend s'applique. Or, des contraintes et des limites ont été imposées à l'arbitre par le législateur. Ainsi, l'harmonisation des conditions de travail devait se faire sans augmentation du total des dépenses annuelles de la Ville en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Le législateur aurait pu prévoir que l'harmonisation ne devait entraîner aucune réduction du traitement ou d'avantages sociaux pour les employés de la nouvelle Ville; il a plutôt choisi de s'en abstenir. Par conséquent, seule la clause 38.02 de la décision doit être annulée.
À l'exception d'une clause accessoire déclarée illégale, la sentence arbitrale ayant déterminé les conditions de travail des cols bleus de la Ville de Montréal est confirmée.
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) c. Lavoie, SOQUIJ AZ-50353815 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2006-07-20), 31374)
Le CN n'a pas assumé son obligation d'accommodement à l'endroit d'une chef de train — d'abord, durant sa grossesse et, ensuite, afin de lui permettre de trouver un mode de garde approprié pour son enfant; il doit notamment lui verser 15 000 $ à titre de dommages moraux et 10 000 $ à titre d'indemnité spéciale pour avoir eu un comportement inconsidéré.
La plaignante exerçait les fonctions de chef de train de manœuvre dans une cour de triage. En février 2002, elle a appris qu'elle était enceinte. Son médecin a alors recommandé que des modifications soient apportées à ses tâches. L'employeur l'a placée en congé sans solde et, une semaine plus tard, il lui a offert une première mesure d'accommodement, qui ne respectait pas les restrictions médicales imposées. Une seconde offre a été faite, mais elle a été refusée par le syndicat, car elle ne respectait pas des règles de sécurité et requérait que la plaignante obtienne un statut d'ancienneté privilégiée, ce qui aurait causé des problèmes parmi ses collègues. Par la suite, le syndicat a proposé d'autres postes qu'elle aurait été en mesure d'occuper, mais l'employeur a rejeté ces propositions. Il en a résulté que la plaignante a été en congé sans solde pendant trois mois et demi. À la fin de mai 2002, l'employeur lui a offert un poste de conducteur de véhicule de transport, qu'elle a accepté. Compte tenu de son horaire, elle a eu de la difficulté à faire garder son autre enfant, âgée de deux ans. Ce problème s'étant présenté trois samedis consécutifs en juin, elle a demandé, à titre d'accommodement, que son horaire soit modifié pendant les trois semaines en question. L'employeur lui a alors offert d'utiliser trois congés sans solde, ce qu'elle a été forcée d'accepter.
DÉCISION : L'employeur a exercé de la discrimination à l'endroit de la plaignante en omettant de lui fournir un accommodement en ce qui a trait à sa grossesse et à ses obligations parentales. Les deux offres d'accommodement ont été rejetées puisque ni l'une ni l'autre ne répondait à ses besoins. De plus, il a été prouvé qu'elle avait été traitée différemment ou qu'elle avait été défavorisée par rapport à d'autres employés qui ne présentaient pas la même caractéristique qu'elle, soit être enceinte. Or, il n'a pas démontré qu'il croyait sincèrement que cela était nécessaire à la réalisation de ses objectifs et qu'il a agi sans avoir eu l'intention de faire preuve de discrimination à l'égard de la plaignante. De plus, il a omis de suivre une grande partie de sa propre politique sur cette question et il n'a pas démontré qu'il avait examiné en profondeur toutes les possibilités d'accommodement à offrir à cette dernière. En cette matière, les employeurs doivent être innovateurs et faire preuve de flexibilité et de créativité. L'employeur ne s'est donc pas acquitté de son fardeau de démontrer qu'il lui était impossible de fournir à la plaignante un accommodement qui tiendrait compte de sa grossesse sans qu'elle subisse de contrainte excessive. Quant au syndicat, il n'a pas entravé les efforts d'accommodement, d'autant moins que son obligation de faciliter celui-ci ne naît que lorsque sa participation est nécessaire pour le rendre possible. Par ailleurs, la prétention de la plaignante voulant qu'elle ait été victime de discrimination en raison de sa situation familiale s'avère également fondée. Elle avait en effet trouvé un service de garde pour son autre enfant en février mais, compte tenu du retard de l'employeur à lui offrir un accommodement, il n'y avait plus de place disponible à la fin du mois de mai. L'offre de l'employeur d'avoir recours à des congés sans solde plutôt que d'accommoder la plaignante en modifiant son horaire était discriminatoire. Il s'agissait d'une modeste demande qui résultait de sa conduite fautive antérieure, sans compter que d'autres employés, dans des situations comparables, avaient été traités différemment. De plus, l'employeur n'a pas prouvé l'exigence professionnelle justifiée. Même s'il avait un objectif de productivité il n'a pas démontré qu'il aurait subi une contrainte excessive s'il avait adapté l'horaire de la plaignante. Il lui est donc ordonné : de revoir sa politique en matière d'accommodement et de s'assurer que les individus et les groupes chargés de sa mise en œuvre la respectent; d'indemniser la plaignante pour la perte de son salaire et d'avantages pendant son congé sans solde; de verser à cette dernière 15 000 $ à titre de préjudice moral et 10 000 $ à titre d'indemnité spéciale ainsi que de lui rembourser ses frais juridiques raisonnables, et ce, en vertu du pouvoir conféré par l'article 53 (2) c) de la Loi d'ordonner à l'employeur d'indemniser la victime « des dépenses entraînées par l'acte ». Quant au syndicat, il n'a pas droit au remboursement de ses frais juridiques, n'ayant pas allégué avoir été victime d'un acte discriminatoire. En ce qui concerne sa demande d'obtenir une déclaration selon laquelle il n'a commis aucune faute quant aux mesures adoptées afin de fournir un accommodement à la plaignante, le Tribunal ne possède aucune compétence pour ce faire.
Hoyt et Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, SOQUIJ AZ-50394836
Étant donné l'article 74 de la Loi sur l'équité salariale, l'arbitre de griefs a pleine compétence pour vérifier la conformité des rajustements salariaux tels qu'établis par le comité conjoint sur l'équité salariale.
La convention collective liant les parties a été signée le 3 juillet 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier précédent. Les pourcentages d'augmentation salariale sont de 3 % pour 2003 et 2004 et de 4 % pour 2005. Outre ces augmentations, dans le cas des préposés aux chambres, des rajustements de salaire de 0,15 $ de l'heure ont été prévus à la date de la signature de la convention. Parallèlement à ces négociations, les parties ont formé un comité conjoint sur l'équité salariale qui, après étude des écarts salariaux de diverses catégories d'emploi, est arrivé, le 15 décembre 2003, à établir les modalités de versement des rajustements salariaux pour les préposés aux chambres de 0,94 $ l'heure, payables en cinq versements égaux de 0,19 $ les 21 novembre de chaque année, de 2001 à 2005. À compter du 21 novembre 2003, l'employeur n'a versé qu'une augmentation de 0,04 $ l'heure, soit la différence entre celle de 0,15 $ prévue à la convention et celle de 0,19 $ déterminée par le comité sur l'équité salariale. Le syndicat réclame l'augmentation de 0,19 $ l'heure en plus de celle de 0,15 $.
DÉCISION : En agissant comme il l'a fait, l'employeur a modifié rétroactivement les taux de salaire pour intégrer ce versement relatif à l'équité salariale puisque, à compter de novembre 2003, il a versé 0,04 $ et non pas 0,19 $. Par ailleurs, le Tribunal a compétence pour décider du présent litige étant donné que, en matière de grief, il peut être appelé à appliquer ou à interpréter une loi si nécessaire. D'une part, l'article 74 de la Loi sur l'équité salariale prévoit que les rajustements salariaux ainsi que leurs modalités de versement font partie de la convention collective. D'autre part, la convention a prévu des augmentations salariales indépendamment de l'application de la Loi sur l'équité salariale. Il appartient donc au Tribunal de s'assurer que les rajustements ont été intégrés à la convention et que les augmentations qui y sont prévues ont été versées. Or, l'ajout de 0,15 $ au taux salarial convenu pour 2003 ne peut être considéré comme une avance sur l'équité salariale puisque des augmentations de même nature ont été accordées à différentes classes d'employés à prédominance masculine. Il en est de même pour l'année 2004. En utilisant l'augmentation négociée et contenue à la convention collective, l'employeur a violé tant la loi que la convention. Enfin, il a fait valoir que sa façon de faire respectait l'énoncé se trouvant sur Internet de la Commission de l'équité salariale quant à l'application de l'article 74 de la Loi. Or, cet énoncé ne lie aucunement le Tribunal. En conséquence, l'employeur doit modifier les taux de salaire des préposés aux chambres pour les années 2003, 2004 et 2005 afin d'intégrer, en novembre 2003 et 2004, un versement de 0,19 $ pour chacune de ces années et tenir compte de la conséquence que l'ajout de 0,15 $ peut entraîner pour les années 2004 et 2005.
Syndicat démocratique des salariés du Château Frontenac (CSD) et Fairmont Le Château Frontenac (grief collectif), SOQUIJ AZ-50368818
Le fait que les parties aient omis de stipuler dans la convention collective les conséquences de la fermeture de l'entreprise n'a pas pour effet de rendre applicable l'article 2091 C.C.Q., relatif au délai de congé raisonnable.
G. et F. avisent leurs employés qu'elles cesseront d'exploiter leur entreprise et donnent à chacun d'eux des préavis qui respectent les délais fixés par la Loi sur les normes du travail (L.N.T.). Les conventions collectives ne comportent aucune clause régissant la fermeture d'entreprise, mais celle de G. précise que l'employeur doit donner les préavis prévus par la L.N.T. en cas de mise à pied pour plus de six mois. Par voie de griefs, les syndicats représentant les deux groupes de salariés prétendent que le délai des préavis n'est pas raisonnable au sens de l'article 2091 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et réclament une indemnité de quatre semaines par année de service pour chacun des employés. Les arbitres rejettent les objections préliminaires des employeurs en concluant qu'ils ont compétence pour trancher les griefs et pour déterminer si les préavis donnés satisfont aux exigences des articles 2091 et 2092 C.C.Q. En Cour supérieure, la demande de révision judiciaire de F. est accueillie, alors que celle de G. est rejetée. La Cour d'appel infirme la première décision de la Cour supérieure et confirme la deuxième. Elle conclut que les arbitres ont compétence pour entendre les griefs puisque la règle prévue aux articles 2091 et 2092 est incorporée implicitement dans les conventions collectives.
DÉCISION : Mme la juge Deschamps, à l'opinion de laquelle souscrivent les juges Bastarache, Binnie et Charron : Si une règle est incompatible avec le régime collectif des relations du travail, elle ne peut être incorporée dans la convention collective et elle doit être exclue. Si elle s'avère compatible et qu'il s'agit d'une norme supplétive ou impérative, l'arbitre aura compétence pour l'appliquer. La subordination du contrat individuel au régime collectif permet de réconcilier les intérêts collectifs avec les intérêts individuels là où ces derniers peuvent subsister sans entraver la bonne marche des relations collectives. Par le mécanisme de l'incorporation des normes impératives compatibles et le recours aux conditions implicites, le régime collectif forme un ensemble juridique cohérent. Tout ce qui est inscrit au C.C.Q. n'est donc pas incorporé implicitement dans la convention collective — seulement ce qui est compatible. [24-30]
En l'espèce, les arbitres ne sont pas compétents pour entendre les griefs déposés par les syndicats. Il existe trois raisons pour lesquelles la règle de l'article 2091 C.C.Q. n'est pas compatible avec le régime collectif de travail. Premièrement, les conditions de travail des employés syndiqués sont négociées collectivement d'avance par le syndicat et l'employeur, alors que le préavis prévu par le C.C.Q. est convenu de façon individualisée lors de la cessation d'emploi. Le délai de congé constitue indéniablement une condition de travail et outre les normes minimales édictées par la L.N.T., sa durée est une matière qui doit être déterminée dans le cadre des négociations entre le syndicat et l'employeur. Le fait que les parties aient omis de stipuler dans la convention collective les conséquences de la fermeture de l'entreprise n'a pas pour effet de rendre applicable le droit commun en matière de contrats individuels de travail. L'aspect consensuel du délai de congé de l'article 2091, la nature individuelle de celui-ci et le moment de la détermination de son caractère suffisant, soit après la cessation d'emploi, sont trois éléments essentiels de la règle du C.C.Q. qui font ressortir son incompatibilité avec le régime collectif. Deuxièmement, le droit des employés de réclamer un délai de congé raisonnable en vertu du droit commun est la contrepartie du droit de l'employeur de mettre fin au lien d'emploi en payant le préavis, sans devoir fournir de cause juste et suffisante. Puisqu'en matière de rapports collectifs de travail, l'employeur est limité dans son droit de congédier et que la réintégration est la réparation la plus courante, il s'ensuit que le droit de l'employé au préavis raisonnable de l'article 2091, est inapplicable. Enfin, l'historique législatif de l'article 2091 permet aussi de conclure que le législateur n'a pas voulu intégrer au régime collectif le délai de congé prévu à cette disposition. La proposition avancée avant l'adoption du C.C.Q., selon laquelle le nouveau code devrait servir de cadre général à toutes les relations du travail, individuelles ou collectives, a été rejetée. Les tribunaux ne devraient pas imposer leur vision là où le législateur a choisi de ne pas imposer la règle de l'article 2091 C.C.Q. au régime collectif. [9] [32] [35-47] [55-61]
M. le juge LeBel, dissident, à l'opinion duquel souscrivent la juge en chef McLachlin et le juge Fish : Bien que l'accréditation d'un syndicat dans une entreprise transforme la dynamique des relations du travail en écartant la liberté contractuelle des salariés, cela ne signifie pas que les règles du C.C.Q. sur le contrat individuel de travail cessent de s'appliquer et ne forment plus des parties du contenu implicite de la convention collective. Un contrat individuel survit à l'accréditation d'un syndicat et au régime de la convention collective. Puisque les lois du travail, en dépit de leur prolixité et de leur complexité, ne couvrent pas tous les aspects des relations du travail, même lorsqu'elles se situent dans un cadre collectif, le régime du C.C.Q. les complète et supplée aux silences ou aux lacunes des conventions collectives. Les droits découlant du contrat individuel d'emploi et ceux protégés par le régime collectif peuvent s'harmoniser dans le respect de la hiérarchie des règles de droit. [51] [76] [111]
En principe, la convention collective contient l'ensemble des conditions de travail incluses expressément par les parties lors de la négociation collective, mais la faculté des parties de négocier librement les normes substantielles les régissant est restreinte par l'obligation de respecter ou d'incorporer à la convention les droits ou les valeurs protégés par les chartes et les règles de droit imposées par le législateur, y compris certains principes généraux du droit commun, notamment ceux qui ont un caractère d'ordre public. Plusieurs lois québécoises contiennent des dispositions relatives au droit du travail qui sont d'ordre public, dont la L.N.T., qui énonce des seuils minimums que toute convention collective doit respecter, et le C.C.Q. En vertu des articles 2091 et 2092 C.C.Q., le salarié jouit du droit à un délai de congé raisonnable et il ne peut renoncer à ce droit. Puisque les articles 2091 et 2092 sont d'ordre public de direction et que la convention collective ne peut contenir de dispositions qui contreviennent à l'ordre public (art. 62 du Code du travail), l'arbitre doit, lorsqu'il est saisi d'un grief à cet effet, évaluer la suffisance des indemnités tenant lieu de délai de congé au regard du C.C.Q. [77] [113] [126]
En l'espèce, les arbitres désignés dans les deux affaires sont compétents pour entendre les griefs. Rien ne s'oppose à ce que des salariés assujettis à une convention collective puissent bénéficier du droit au préavis raisonnable prévu au C.C.Q. Loin d'être incompatibles avec le régime collectif de droit du travail, les articles 2091 et 2092 le complètent et offrent un recours aux salariés qui perdent leur emploi sans que leur employeur les indemnise adéquatement. Deux situations sont susceptibles de se présenter. Lorsque la convention collective contient, comme dans le cas de G., une disposition prévoyant le délai de congé auquel les salariés auront droit advenant la fermeture de l'entreprise ou une autre situation donnée, l'arbitre doit évaluer si la mesure prévue à la convention (ici, le renvoi aux délais de congé de la L.N.T.) est conforme à l'article 2091. S'il conclut au bien-fondé du grief du syndicat, il peut alors imposer un délai de congé qu'il estime raisonnable. Si par contre, comme dans le cas de F., la convention collective est muette quant à l'indemnité tenant lieu de délai de congé à verser aux salariés advenant la fermeture de l'entreprise, l'arbitre doit évaluer si, au regard de l'article 2091, le délai de congé minimum prévu à l'article 82 L.N.T. est suffisant ou si les circonstances de l'espèce militent en faveur d'une durée plus longue. [125] [128-129]
NDLR : © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2006. Reproduit avec la permission du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Le fait que les parties aient omis de stipuler dans la convention collective les conséquences de la fermeture de l'entreprise n'a pas pour effet de rendre applicable l'article 2091 C.C.Q., relatif au délai de congé raisonnable.
Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., SOQUIJ AZ-50353146
Même si la convention prévoit qu'un salarié n'ayant pas terminé sa probation ne peut contester son congédiement au moyen de la procédure de grief, l'arbitre est compétent pour décider si cette mesure disciplinaire lui a été imposée pour une cause juste et suffisante au sens de l'article 124 L.N.T. puisque celui-ci se trouve implicitement incorporé à la convention collective.
Depuis avril 2001, le plaignant occupait un poste occasionnel d'aide sylvicole dans une pépinière. Le 2 décembre 2003, lors d'une rencontre annuelle d'évaluation, on lui a mentionné les points à améliorer, son rendement ayant été jugé insatisfaisant. Au mois de juin précédent, l'employeur lui avait reproché de réduire la cadence des travaux de rempotage et, au cours de l'automne, il avait encore eu à intervenir auprès du plaignant, qui avait une attitude arrogante envers sa chef d'équipe. Le 18 décembre 2003, le plaignant a été congédié. Il avait alors accumulé 180 jours de service. L'employeur s'oppose à l'arbitrabilité du grief au motif que, selon la convention collective, un salarié doit avoir cumulé 260 jours de service pour avoir droit à la procédure d'arbitrage. Le syndicat allègue que l'article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) constitue un droit substantiel en matière d'emploi qui est intégré implicitement, depuis l'arrêt Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324 (C.S. Can., 2003-09-18), 2003 CSC 42, SOQUIJ AZ-50192747, J.E. 2003-1790, D.T.E. 2003T-923, [2003] 2 R.C.S. 157, dans la convention collective. Il soutient qu'il en est de même pour l'article 2094 du Code civil du Québec (C.C.Q.). À son avis, ces dispositions font en sorte que l'arbitre a compétence pour décider du grief même si la convention exclut le recours à cette procédure pour le plaignant.
DÉCISION : Il est vrai que, depuis l'arrêt Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux, la tendance favorise l'incorporation de toutes les normes en matière d'emploi aux conventions collectives, et ce, même lorsqu'elles sont incompatibles. Toutefois, dans Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc. (C.S. Can., 2006-01-27), 2006 CSC 2, SOQUIJ AZ-50353146, J.E. 2006-299, D.T.E. 2006T-132, la Cour suprême est venue préciser que tout ce qui est inscrit au Code civil du Québec n'est pas incorporé implicitement dans la convention collective, mais seulement ce qui est compatible. En l'espèce, le congédiement disciplinaire du plaignant constitue indéniablement une condition de travail qui relève des négociations collectives et pour laquelle les parties ont établi des normes objectives, dont la durée d'emploi préalable. Selon l'enseignement de l'arrêt Isidore Garon ltée, il y a lieu de conclure à l'incompatibilité de l'article 2094 C.C.Q., qui ne peut dès lors être considéré comme implicitement incorporé dans la convention. En effet, cet article s'applique au contrat individuel de travail et comporte des remèdes distincts de ceux négociés dans la convention collective. Il en est différemment de l'article 124 L.N.T. En l'espèce, l'exercice du recours en cas de congédiement disciplinaire est conditionnel à une durée de service préalable. Toutefois, cette condition d'ouverture à l'arbitrage ne pourra être retenue que si elle ne contrevient pas à une norme minimale du travail. Or, l'article 124 L.N.T. constitue une norme d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent négocier une norme moins avantageuse. Cet article se trouve à être incorporé à toute convention collective. La norme de durée de service négociée par les parties en l'espèce est inférieure à celle que prévoit l'article 124 L.N.T. En effet, en vertu de cet article, la notion de « service continu » comprend, dans le cas d'emplois saisonniers, l'inclusion d'une période pendant laquelle il y a eu interruption du travail en raison du caractère saisonnier de l'emploi. Or, il est établi que le plaignant était rappelé régulièrement et qu'il a effectué neuf périodes d'emploi entre le 23 avril 2001 et la date de son congédiement, le 18 décembre 2003. Il a donc cumulé les deux années de service requises en vertu de l'article 124 L.N.T., ce qui donne ouverture au présent recours.
Quant au fond, la preuve démontre qu'il y a eu un différend entre la chef d'équipe et le plaignant, qui, par la suite, a adopté une attitude arrogante à son endroit. Cependant, l'employeur n'a pas mis en preuve de paroles déplacées ni établi une attitude misogyne de la part de ce dernier. De plus, il semble que la rencontre de juin 2003 ait porté ses fruits puisqu'il a noté une amélioration du comportement du plaignant par la suite. Quant au reproche relatif au rendement insatisfaisant, il est établi que, à deux reprises avant son congédiement, le plaignant a fait l'objet d'une évaluation satisfaisante. Enfin, au début de décembre 2003, lorsque l'employeur lui a soumis les points à améliorer, il n'était pas question de congédiement. Ce n'est que le 18 décembre suivant que la même évaluation a conduit à cette mesure. Or, en matière disciplinaire, il revient à l'employeur de faire la preuve d'un comportement grave justifiant un congédiement sans appliquer la progression des sanctions. Cette preuve n'a pas été faite. Le congédiement du plaignant était injustifié.
Syndicat de la fonction publique du Québec et Québec (Gouvernement du), (Claude Mireault), SOQUIJ AZ-50355222 (Requête en révision judiciaire accueillie quant au dossier 500-17-030831-062 et requête en révision judiciaire rejetée quant au dossier 500-17-029991-067 (C.S., 2006-08-30), 500-17-029991-067 et 500-17-030831-062, 2006 QCCS 5230, SOQUIJ AZ-50397005, J.E. 2006-2217, D.T.E. 2006T-1000. Requête pour permission d'appeler et en réunion de dossiers accueillie (C.A., 2006-10-24), 500-09-017087-065 et 500-09-017086-067)
En l'absence de dispositions dans la convention collective reconnaissant le droit du syndicat, l'adoption, la gestion et le retrait d'une politique sur le harcèlement psychologique relèvent exclusivement de l'employeur, lequel est néanmoins tenu de respecter le monopole de représentation du syndicat dans la gestion des dossiers relatifs à cette question.
En mai 2004, l'employeur a remis au syndicat un projet de politique sur le harcèlement psychologique. Ce dernier a alors fait part de ses craintes au sujet de la personne-ressource désignée pour répondre aux plaintes des employés ou des étudiants. Cette politique comporte une procédure en trois étapes pour le traitement des plaintes, soit une première étape visant les plaintes non officielles, une deuxième concernant les plaintes officielles et une troisième relative au processus décisionnel par lequel l'employeur doit mettre en œuvre les sanctions jugées appropriées. Le 19 octobre suivant, l'employeur a remis au syndicat la version finale de la politique, laquelle a été adoptée par le conseil d'administration du cégep le 22 octobre. En novembre, le directeur du campus a avisé un enseignant et une conseillère en orientation de leur nomination à titre de personnes-ressources. À compter du mois d'avril 2005, diverses situations mettant en cause des enseignants ont donné lieu à des plaintes non officielles; un représentant de l'employeur s'est alors substitué à l'une des personnes-ressources afin de traiter deux de ces plaintes. Celles-ci ont cependant mené à un constat d'absence de harcèlement psychologique et, devant l'insatisfaction des plaignants et du syndicat, celui-ci a déposé un grief, le 7 juin suivant, par lequel il conteste la façon dont l'employeur a géré ces dossiers.
DÉCISION : L'article 81.19 L.N.T. impose à l'employeur deux obligations : la mise en place de moyens visant à 1) prévenir et 2) à faire cesser le harcèlement psychologique. Il lui confère une certaine discrétion quant au choix de ces moyens dans la mesure où ceux-ci sont suffisants. L'adoption d'une politique visant à contrer le harcèlement psychologique constitue un moyen auquel peut recourir un employeur pour remplir ses obligations juridiques. Il faut toutefois s'interroger sur la participation du syndicat dans l'application de la politique en question. Celui-ci joue un rôle crucial dans la gestion des dossiers de harcèlement. Cependant, l'adoption d'une politique sur le harcèlement psychologique est, en principe, un droit qui appartient en exclusivité à l'employeur. En l'espèce, il n'existe pas de clause dans la convention accordant au syndicat le droit de prendre part à la mise sur pied d'une telle politique. Quant au droit de consultation conventionnelle par l’entremise des comités des relations du travail, il est restreint aux matières mentionnées dans la convention. Le syndicat ne peut obtenir, par son grief, le rôle actif lui étant dévolu qui est expressément prévu en matière de harcèlement sexuel. Il peut cependant exercer son droit de représentation et s'attaquer à la politique s'il estime que la convention a été violée. Or, pour ce qui est de la gestion quotidienne des plaintes relatives au harcèlement psychologique, la preuve a révélé que l'employeur a enfreint sa propre politique. En effet, dès le moment où une plainte est déposée, l'employeur doit faire preuve de retenue, se retirer et laisser le processus prévu à sa propre politique suivre son cours. Il faut donc conclure : 1) que l'employeur n'est pas tenu d'inclure le syndicat dans le processus d'adoption, de gestion et de retrait d'une telle politique; 2) qu'il est néanmoins tenu de respecter le monopole de représentation du syndicat lors de la gestion de ces dossiers, ce qu'il a fait en l'espèce; 3) qu'une politique doit être conforme aux prescriptions de la convention collective et qu'elle ne peut d'aucune façon retarder, limiter ou autrement intervenir dans la procédure interne d'arbitrage de griefs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; 4) que l'employeur est tenu de respecter sa propre politique et que, dès lors, il ne peut se substituer à quelque personne-ressource que ce soit, ce qui est survenu à deux reprises en l'espèce; et 5) que la preuve ne permet pas d'accorder de dommages-intérêts.
Champlain Regional College St. Lawrence Campus Teacher's Union et Cégep Champlain — Campus St-Lawrence (Champlain Regional College — St. Lawrence Campus) (grief syndical), SOQUIJ AZ-50390128
Des griefs réclamant une rémunération au taux des heures supplémentaires pour des congés pour jours fériés en sus de la semaine normale de travail sont rejetés; l'article 56 L.N.T., étant incompatible avec la convention collective, ne saurait s'appliquer.
Dans chacun des sept griefs, le syndicat a reproché à l'employeur d'avoir contrevenu à la convention collective et à la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) en ne rémunérant pas les salariés d'entretien au taux majoré des heures supplémentaires pour les heures excédant la semaine normale de travail de 40 heures. Ainsi, chaque fois qu'un jour férié survient en début ou en fin de semaine, le dimanche ou le samedi, le syndicat a fait valoir que l'employeur aurait dû verser une rémunération au taux majoré soit pour l'un des jours travaillés, soit pour le jour férié.
DÉCISION : Le syndicat appuie sa prétention sur l'article 56 L.N.T., qui prévoit que, aux fins du calcul des heures supplémentaires, les jours fériés sont assimilés à des jours de travail. Par ailleurs, la convention collective compte dix jours statutaires fériés, alors que la loi en prévoit sept. Or, le syndicat n'est pas dans une bonne position quant à sa réclamation. En effet, la convention collective contient une disposition prévoyant que les jours fériés sont rémunérés au taux normal. Par ailleurs, dans Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc. (C.S. Can., 2006-01-27), 2006 CSC 2, SOQUIJ AZ-50353146, J.E. 2006-299, D.T.E. 2006T-132, la Cour suprême a décidé que, si une règle est incompatible avec le régime collectif des relations du travail, celle-ci ne peut être incorporée dans la convention collective et elle doit être exclue. Ainsi, tout ce qui est inscrit au Code civil du Québec n'est donc pas incorporé implicitement dans la convention collective, mais uniquement ce qui est compatible. En l'espèce, le syndicat propose que des règles conventionnelles clairement énoncées soient mises de côté pour y introduire une norme de rémunération au-delà de la semaine normale de travail pour les jours fériés. De toute évidence, il y a incompatibilité entre certaines normes de la convention collective et une norme particulière de la Loi sur les normes du travail. S'appuyant sur le principe de l'ordre public pour la norme du travail, le syndicat fait valoir qu'il faut donner préséance à celle-ci plutôt qu'aux dispositions de la convention collective. Toutefois, en l'espèce, il n'est pas possible d'assimiler les jours fériés ou les congés annuels à des jours de travail au sens de l'article 56 L.N.T., et ce, compte tenu du libellé clair, limpide et précis de la clause de la convention collective qui stipule que ces journées sont rémunérées au taux normal, comme toute journée normale de travail.
Métro Richelieu, division Distagro (entrepôt) et Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 503 (FTQ), (griefs collectifs). SOQUIJ AZ-50378195 (Requête en révision judiciaire, 2006-06-09 (C.S.), 200-17-007099-062)
L'employeur, qui a réclamé aux salariés des sommes versées en trop à la suite d'une erreur dans l'application d'une entente de redressement salarial, a omis de prendre les mesures administratives requises pour s'assurer du traitement adéquat des demandes d'information; l'étendue de la restitution est réduite de moitié à l'égard d'un salarié ayant subi un préjudice en raison de cette négligence.
L'employeur a déposé 39 griefs patronaux afin de réclamer des sommes versées en trop à des enseignants à la suite d'une entente de redressement salarial intervenue entre le gouvernement du Québec et la Centrale de l'enseignement du Québec. Le syndicat prétend que les griefs sont prescrits puisqu'ils ont été déposés après le délai de six mois prévu à l'article 71 du Code du travail (C.tr.). De plus, il soutient que la convention collective prévoit une procédure particulière pour la récupération des sommes versées en trop, laquelle n'a pas été suivie par l'employeur. Ce dernier réplique que ses griefs équivalent à une action en restitution de l'indu et que, conformément à l'article 2925 du Code civil du Québec (C.C.Q.), le délai de prescription d'une telle action est de trois ans à compter de la découverte de l'erreur.
DÉCISION : L'employeur a versé des sommes en trop à la suite d'une erreur de traitement informatique qu'il ne pouvait raisonnablement anticiper. Lorsque la répétition de l'indu résulte d'une erreur commise à l'occasion de l'application d'une convention collective, deux courants jurisprudentiels s'opposent quant à la prescription applicable. Le premier courant préconise l'application du délai de trois ans prévu à l'article 2925 C.C.Q. Cette approche découle essentiellement du fait que le recours en réception de l'indu tire sa source du droit civil. Le second courant établit que le recours en réception de l'indu découlant de l'application de la convention collective doit être exercé auprès de l'arbitre de griefs exclusivement et que, en l'absence d'un délai prévu à la convention collective, le délai en vertu de l'article 71 C.tr. trouve alors application. Dans les deux cas, le délai de prescription commence à courir au moment de la découverte de l'erreur. En l'espèce, l'employeur a pris connaissance de l'erreur au mois de mai 2001 et il a formulé ses griefs cinq mois plus tard. L'article 71 s'applique puisque la réclamation de l'employeur découle de l'application de la convention collective et que celle-ci ne prévoit aucun délai particulier. Il est vrai que la convention collective prévoit une procédure afin que l'employeur opère compensation des sommes dues par un salarié. Or, il doit s'agir de dettes certaines, liquides et exigibles. Il est reconnu qu'une dette contestée n'est plus certaine. L'employeur était donc fondé à recourir à la procédure d'arbitrage. En vertu de l'article 100.12 b) C.tr., l'arbitre a le pouvoir de fixer les modalités de remboursement d'une somme qu'un employeur a versée en trop à un salarié. Par ailleurs, l'article 1699 C.C.Q. — disposition compatible avec la convention collective — confère au Tribunal un vaste pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, l'employeur a omis de prendre les mesures administratives requises pour s'assurer d'un traitement adéquat des demandes d'information et une enseignante visée par la réclamation a subi un préjudice en raison de cette négligence. En effet, elle a fait l'achat d'une piscine — bien non essentiel dont la valeur est maintenant grandement dépréciée et qu'elle ne peut rapporter —, ce qu'elle n'aurait pas fait n'eût été la somme qui lui a été versée en trop. Dans ces circonstances, la remise intégrale de la somme versée en trop est inéquitable et l'étendue de la restitution doit être réduite de moitié.
Syndicat de l'enseignement du Lanaudière et Commission scolaire des Samares (griefs patronaux), SOQUIJ AZ-50375809
Le bénévolat ne relève pas du domaine des relations du travail parce que les principaux éléments d'un contrat de travail ne sont pas présents; toutefois, en l'espèce, la preuve n'a pas établi que les travailleurs étaient de véritables bénévoles.
La CCQ a ordonné la suspension des travaux sur l'emplacement d'un terrain de camping, une compagnie incorporée dont le requérant est l'unique administrateur et actionnaire. Ce dernier tire ses revenus de cette seule entreprise. Il investit chaque année en améliorations de toutes sortes, dont la dernière consiste en la construction d'un centre récréatif multifonctionnel à l'usage des campeurs regroupant différentes activités, dont une bibliothèque, un cinéma ainsi que des salles pour jouer aux cartes, pour faire du karaoké et pour danser. Il a obtenu la collaboration bénévole de plusieurs campeurs — dont certains ont déjà travaillé dans l'industrie de la construction — pour bâtir le centre. Une vingtaine de personnes y travaillent bénévolement.
Aucune des exceptions énoncées à l'article 49 de la Loi sur le bâtiment ne s'applique. Les travaux en litige n'ont pas été exécutés par un entrepreneur titulaire d'une licence et ils ne constituent pas des travaux de construction d'une maison unifamiliale ou d'un ouvrage destiné à l'usage personnel d'une personne physique ou à celui de sa famille. Cette seule conclusion pourrait suffire pour maintenir l'ordonnance de suspension des travaux. Cependant, le requérant a allégué que les bénévoles n'avaient pas à détenir de certificats de compétence. Selon l'arrêt Québec (Commission de l'industrie de la construction) c. C.T.C.U.M. (C.S. Can., 1986-10-09), SOQUIJ AZ-86111070, J.E. 86-998, D.T.E. 86T-768, [1986] 2 R.C.S. 327, la première chose à examiner pour décider si la Loi s'applique est la nature des travaux. Or, les travaux d'érection d'un bâtiment servant de centre récréatif sur un terrain de camping sont des travaux de construction. La personne qui fait exécuter ces travaux est un employeur et celle qui les exécute, un salarié. Le salarié qui travaille pour un employeur a droit à un salaire. Par contre, le véritable travailleur bénévole qui offre ses services gratuitement n'a pas droit à un salaire et il ne pourra être considéré comme un salarié au sens de la Loi. Le bénévolat ne relève pas du domaine des relations du travail parce que les principaux éléments d'un contrat de travail n'y sont pas présents. Une entente de bénévolat se fait de façon non officielle, par exemple lors d'une corvée d'entraide. La question de savoir si des travailleurs sont de véritables bénévoles est une question de fait. En particulier, il doit y avoir de la part des bénévoles une absence d'intention de recevoir une contrepartie. En l'espèce, le requérant a lui-même effectué des travaux de construction. À titre d'unique administrateur et actionnaire de sa compagnie à but lucratif, il reçoit des dividendes. De plus, le centre récréatif donnera un actif supplémentaire. Ainsi, le requérant est une personne intéressée, qui n'a pas manifesté une absence d'intention de recevoir une contrepartie. Il n'est donc pas un véritable bénévole. D'autre part, même s'il a prétendu que les campeurs étaient libres de leur temps, il exerçait un contrôle sur le déroulement des travaux et, à l'occasion, il faisait affaire avec des entrepreneurs spécialisés. Quant aux autres travailleurs, la preuve n'est pas suffisante pour conclure qu'ils n'ont pas de contrepartie ou qu'ils n'avaient pas l'intention d'en recevoir une. Ils sont donc des salariés au sens de la Loi, et le requérant, par l’entremise de sa compagnie, est leur employeur. Par conséquent, il n'y a pas lieu de lever l'ordonnance de suspension des travaux.
Camping Granby inc. c. Commission de la construction du Québec, SOQUIJ AZ-50389825
En l'absence de preuve par l'employeur qu'il a pris les moyens nécessaires afin de s'assurer que ses directives étaient suffisantes pour garantir la sécurité de ses employés et qu'elles étaient suivies, sa défense de diligence raisonnable ne saurait être recevable.
L'employeur exploite une usine de sciage de bardeaux. En octobre 2003, un travailleur a subi une amputation au niveau de l'avant-bras lorsque sa manche est entrée en contact avec la lame de la scie à déligner les bardeaux pour laquelle il recevait alors une formation. Une enquête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a démontré que la machine n'avait pas été initialement conçue pour rendre inaccessible la zone dangereuse conformément à l'article 182 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Avant cet accident, en août 2003, un inspecteur de la CSST avait visité l'établissement et aucune recommandation n'avait été faite à l'employeur quant à la machine en question, celle-ci n'ayant alors pas fait l'objet d'une vérification. À la suite de son enquête, la CSST a porté une plainte pénale contre l'employeur.
DÉCISION : L'usine de sciage de bardeaux se situe dans un secteur de travail spécialisé. Il est donc du devoir de l'employeur de s'assurer du respect des lois et de la réglementation applicables à ses opérations, notamment celles découlant de l'article 51 LSST et du règlement. Or, au moment de l'achat de la scie à déligner, il n'y avait aucun dispositif de protection entre la planchette à déligner et le bâti de la machine, de sorte qu'il s'agissait d'une zone dangereuse à laquelle avait accès le travailleur. Les arguments de l'employeur quant à ce premier point sont donc irrecevables, d'autant que le texte de l'article 182 du règlement est sans équivoque : une machine doit être munie d'un dispositif de protection lorsqu'elle est conçue ou construite de manière à rendre sa zone dangereuse accessible. Quant à la défense de diligence raisonnable, elle ne saurait être recevable en l'espèce. En effet, la simple allégation que le directeur de l'entreprise assurait la sécurité en étant présent à l'usine est insuffisante pour y donner ouverture. Il n'y a aucune preuve que l'employeur a pris les moyens pour s'assurer que ses directives étaient suivies et suffisantes afin d'assurer la protection de ses employés. (Déclaration de culpabilité et amende de 500 $)
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Bardeaux Lajoie inc., SOQUIJ AZ-50388505
Financement : revue de la jurisprudence quant aux situations où les délais occasionnés par le système de santé ont pour effet d'obérer injustement l'employeur; en l'espèce, un délai de 28 mois avant une intervention chirurgicale imputable au départ à la retraite du chirurgien est déraisonnable.
L'employeur demande la révision d'une décision de la CLP ayant déclaré qu'il devait être imputé de la totalité des coûts des prestations encourues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 17 octobre 2002. Au soutien de sa requête, il allègue qu'il n'a pu se faire entendre. Il prétend également que sa demande de partage est recevable. Il soumet enfin qu'il est obéré injustement en raison du long délai entre la survenance de la lésion et l'intervention chirurgicale.
DÉCISION : Pour ce qui est de la requête en révision, le 12 septembre 2006, l'employeur avait transmis une argumentation écrite à la CLP et un accusé de réception lui a été adressé le lendemain, indiquant que l'argumentation aurait été transmise à la première commissaire. Or, celle-ci a rendu sa décision sans qu'elle ait eu en sa possession l'argumentation écrite de l'employeur, comme elle le mentionne dans sa décision. Ce dernier n'a donc pas été entendu parce que son argumentation n'a pas été remise à la commissaire avant qu'elle ne rende sa décision. La décision rendue le 18 septembre 2006 est donc révoquée et le tribunal en révision rend la décision qui aurait dû être rendue en tenant compte de l'argumentation de l'employeur.
En ce qui a trait à la recevabilité de la demande de partage des coûts, l'employeur invoque une période d'attente pour l'intervention chirurgicale exceptionnellement longue. En effet, le travailleur a subi une lésion professionnelle (rupture de la longue portion du biceps droit ainsi qu'une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) le 17 octobre 2002. Le 27 mars 2003, une intervention chirurgicale au niveau de l'épaule est envisagée. L'opération devait être effectuée en septembre ou octobre 2003. Mais le travailleur est toujours en attente le 11 novembre 2003. Le 10 mai 2004, le chirurgien qui devait pratiquer l'opération a pris sa retraite. Le dossier du travailleur a été confié à un confrère du chirurgien et le nom du travailleur a de nouveau été mis sur une liste d'attente à l'hôpital où exerce ce dernier. Le travailleur sera finalement opéré le 31 octobre 2005, soit plus de deux ans après qu'on ait prévu son intervention. Dans ce contexte, la connaissance par l'employeur d'un fait essentiel ne peut être présumée avant le moment où une personne raisonnable pouvait considérer que la période d'attente avant l'opération dépassait de toute évidence ce à quoi on est en droit de s'attendre même dans un système de santé comme le nôtre. En l'occurrence, l'élément qui excède le cadre normal est le prolongement du délai d'attente causé par la fin des activités professionnelles du chirurgien vers le 10 mai 2004. Ce n'est que le 18 janvier 2005 que l'employeur apprendra que le temps d'attente pour l'intervention chirurgicale peut prendre encore de six mois à un an. Selon l'article 3 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification de la cotisation de l'employeur et de l'imputation du coût des prestations (le règlement), la demande de l'employeur doit être faite dans les six mois de la connaissance du fait essentiel, mais avant l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2. Ce délai est ici respecté, car l'employeur a produit sa demande le 6 juin 2005, soit dans les six mois de la connaissance du fait essentiel et avant le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle l'accident est survenu. Sa demande est donc recevable.
Quant au fond, l'annulation des interventions chirurgicales du chirurgien pour cause de maladie et la cessation par lui de ses activités professionnelles vers le 10 mai 2004 constituent des circonstances exceptionnelles qui ont retardé la chirurgie de façon importante, le tout ayant eu pour effet d'obérer injustement l'employeur. Ces faits se démarquent des contraintes habituelles des quotas opératoires et le manque de personnel auquel font face tous les hôpitaux. Cette situation factuelle diffère de celle à laquelle tous les travailleurs et employeurs doivent généralement faire face. D'ailleurs, la jurisprudence a déjà reconnu que l'employeur était obéré injustement lorsque des coûts additionnels sont encourus par un tel retard, tel qu'il appert des affaires Viandes du Breton inc. (retard d'une chirurgie causée par la condition personnelle d'un travailleur), General Motors du Canada ltée (l'incurie et le délai déraisonnable du médecin traitant à produire un rapport d'évaluation médicale conforme à la Loi), Services de gestion Quantum ltée (le dossier a pris quatre mois à se rendre de l'indemnisation à la réadaptation), Cheminées Sécurité ltée (retard d'une opération en raison de l'incarcération d'un travailleur), et Transport S.A.S. Drummond inc. (opération retardée d'environ deux ans en raison du manque d'équipement dans un hôpital et de l'absence de référence dans un autre hôpital). En l'espèce, le retard de la chirurgie est également imputable à une cause complètement externe à la lésion professionnelle, à savoir l'annulation des interventions chirurgicales du chirurgien pour cause de maladie et la cessation de ses activités professionnelles. Par ailleurs, si le chirurgien n'avait pas pris sa retraite au mois de mai 2004, il n'est pas prouvé que le travailleur aurait subi l'intervention chirurgicale à ce moment. Il y a plutôt lieu de déterminer le partage des coûts comme il en a été disposé dans l'affaire Transport S.S.A. Drummond inc. Ainsi, comme le travailleur a été inscrit sur une liste d'attente chirurgicale de l'hôpital où pratique le confrère du chirurgien retraité, le 11 juin 2003, il aurait donc été raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit opéré le ou vers le 11 juillet 2004 alors qu'il ne l'a été que le 31 octobre 2005. Les coûts imputés au dossier de l'employeur entre le 11 juillet 2004 et le 31 octobre 2005 doivent donc être imputés aux employeurs de toutes les unités, ces coûts obérant injustement l'employeur.
St-Georges, Hébert inc. syndic (Maçonnerie Global ltée), partie requérante, SOQUIJ AZ-50396319
Lésion psychologique : l'exigence de la preuve quant à la présence d'incidents dépassant le cadre normal du travail ne constitue pas un écart jurisprudentiel, mais découle directement de la qualification exigée par la Loi quant à la nature de l'événement décrit à l'article 2 LATMP; lorsqu'une personne se présente sur le marché du travail, elle doit s'attendre à ce que l'employeur exerce ses droits de direction, qui comprennent des exigences d'efficacité, de rendement, de discipline et d'encadrement.
Depuis 1995, le travailleur s'absente du travail à plusieurs reprises pour différentes raisons, dépressions majeures, maladie personnelle, lésion professionnelle et autres. Le 3 mai 2001, son médecin de famille le met en arrêt de travail pour dépression majeure jusqu'au 13 mars 2002. Le travailleur prétend que l'employeur a utilisé tous les moyens pour retarder le retour au travail, entre autres en lui demandant de transmettre des documents médicaux à son médecin désigné avant d'autoriser un retour au travail progressif. Pendant cette période, il subit une intervention chirurgicale le 28 mai avec une autorisation de retour au travail le 2 juillet. L'employeur lui demande également des pièces justificatives concernant cet arrêt de travail. Le 12 septembre, lors d'une rencontre chez l'employeur afin de préparer son retour au travail, le travailleur apprend officiellement qu'il est changé de poste. Il reprend le travail le 7 octobre, mais affirme qu'il se sent mal accueilli, isolé, laissé à lui-même pour comprendre ses nouvelles tâches. D'octobre 2002 à septembre 2003, le travailleur s'absente de son nouveau travail à diverses reprises. Il témoigne avoir eu de nombreuses discussions avec l'employeur sur ses absences répétées, affirmant que les représentants de l'employeur le font se sentir coupable d'être ainsi malade à répétition. Comme il est encore en arrêt de travail en janvier 2003, il est convoqué à une rencontre le 24 février afin de faire le point sur sa présence au travail depuis le 7 octobre 2002. Le 1er août 2003, il reçoit une lettre de son employeur qu'il ressent comme une atteinte personnelle à son intégrité; il se sent dénigré à sa lecture et y voit encore une fois une forme déguisée de harcèlement à son endroit. Cette lettre l'avise notamment que les absences en raison de son état de santé devront être motivées par un certificat médical journalier. Le 2 septembre, le travailleur répond à cette lettre en précisant que ses absences sont justifiées pour une seule raison, soit des crises de goutte, pour lesquelles il ne peut fournir de certificat médical étant donné la souffrance qu'il ressent et l'inutilité de consulter un médecin à chaque fois, et en accusant l'employeur de manquer d'humanité à son égard. Le 9 septembre, il soumet une réclamation à la CSST pour une dépression majeure. L'instance de révision maintient la décision de la CSST qui rejette cette réclamation. Le travailleur allègue que la dépression majeure diagnostiquée en septembre 2003 découle directement d'une série de faits, gestes et écrits provenant de divers intervenants de l'employeur et dont l'ensemble doit être considéré comme du harcèlement psychologique.
DÉCISION : En matière de lésion de nature psychologique comme en tout autre cas de lésion professionnelle, il faut démontrer la survenance d'un événement imprévu et soudain, au sens de la définition de l'accident du travail. Cette preuve doit comprendre celle de la juxtaposition de faits qui, quoique banals lorsque considérés isolément, peuvent devenir traumatisants et constituer un événement imprévu et soudain, lorsqu'ils sont considérés dans leur ensemble. Toutefois, cette preuve doit démontrer que les gestes ou la conduite de l'employeur débordent du cadre habituel ou normal du travail. Cette exigence ne constitue aucunement un écart jurisprudentiel, mais découle directement de la qualification exigée par la Loi quant à la nature de l'événement identifié à l'article 2 LATMP, qui doit présenter des caractéristiques d'imprévisibilité et de soudaineté. Pour être imprévu et soudain, un incident doit se démarquer de ce qui est prévisible et normal dans le cadre du travail et c'est pour ce motif tout à fait légitime que la jurisprudence a établi comme critère de référence celui du cadre « normal » du travail. Prétendre qu'exiger cette preuve ajoute aux critères prévus à la Loi ignore manifestement le fait que le législateur n'a pas fait des lésions psychologiques un type distinct de toutes les autres formes de lésions professionnelles. Une fois cette série d'événements imprévus et soudains démontrée, la partie requérante doit faire la preuve qu'ils sont la cause de la lésion diagnostiquée. À cet égard, le niveau de la preuve de la relation causale demeure aussi exigeant que celui en matière de lésion physique. Le seul témoignage du travailleur est donc insuffisant et il faut une preuve médicale dont la nature ne peut s'accommoder d'affirmations floues et générales. La preuve médicale doit ainsi revêtir un caractère de rigueur intellectuelle et scientifique et l'expertise psychiatrique présenter un tableau complet et analytique de la condition du travailleur afin de permettre au tribunal de disposer d'un éclairage adéquat et objectif. C'est dans ce contexte que la CLP a exigé et permis le dépôt de tous les documents médicaux pertinents au passé psychiatrique du travailleur. Cet éclairage rétrospectif est impératif en matière de lésion psychologique, car il permet d'évaluer avec justesse ce qui a changé avec l'événement rapporté comme étant la cause de la dépression majeure. C'est pourquoi la CLP compte en premier lieu dégager des antécédents psychiatriques du travailleur certaines conclusions, qui n'anéantissent en rien la théorie du crâne fragile, dans la mesure où la survenance d'événements imprévus et soudains est prouvée.
Quant à sa condition personnelle de nature psychiatrique, les notes de 1996 d'un département de psychiatrie indiquent que le travailleur n'identifie pas un déclencheur précis. Il commence à prendre un médicament qu'il prendra de manière plus ou moins continue par la suite, sans que cette prise médicamenteuse n'empêche la survenance d'autres épisodes dépressifs. Les notes de son médecin de famille indiquent que son état psychologique demeure fragile jusqu'en 2000, ce qui l'amène à recommander une augmentation de la dose de médicament. Le 9 décembre 1999, une psychologue note plusieurs problèmes personnels avec lesquels le patient a de la difficulté à vivre. En 2001, il est mis en arrêt de travail pour dépression majeure et il laisse entendre que celui-ci découle d'une surcharge de travail chez l'employeur. Si tel avait été le cas, le travailleur pouvait soumettre une réclamation à la CSST, démarche qu'il n'a pas faite, et la conclusion juridique qui s'ensuit est que cet arrêt de travail était consécutif à une maladie personnelle, d'origine psychologique. La tentative de récupérer cet épisode pour lui donner indirectement un caractère professionnel est donc irrecevable et une telle interprétation des faits doit être écartée. Par ailleurs, le rapport d'une firme préparé en 2000 à la demande de l'employeur afin de suggérer un plan d'interventions interdisciplinaires intégrées visant le retour durable au travail habituel dans le cadre d'une rechute pour problèmes lombaires met en relief certains traits de personnalité du travailleur et permet à la CLP de prendre avec grande réserve les diverses interprétations de la réalité faites au fil des événements par le travailleur. Lors des diverses audiences, l'attitude du travailleur amène à relativiser beaucoup de ses affirmations ou interprétations de la réalité, non que celles-ci procèdent d'une mauvaise foi, mais parce que ce travailleur est très souvent porté à donner une interprétation des faits qui lui soit favorable et qui ne correspond pas toujours à la réalité objective. La CLP retient donc que le travailleur présente, depuis au moins l'année 1996, des signes récurrents de dépression majeure, qui n'ont été que sporadiquement évacués de son quotidien personnel.
Concernant la preuve de l'événement imprévu et soudain, le travailleur prétend que l'attitude et le comportement des représentants de l'employeur, avant et après son retour au travail du 7 octobre 2002, constituent autant de situations de harcèlement, donc d'événements imprévus et soudains, expliquant la dépression majeure diagnostiquée le 8 septembre 2003. Or, ce retour au travail s'inscrit dans le cadre du dossier d'absentéisme particulier du travailleur depuis 1995. Il n'appartient pas à la CLP de savoir si toutes ces absences étaient fondées ou pas. À cet égard, l'affaire Syndicat canadien de la fonction publique (CHP) et Cité de la santé de Laval (T.A., 1998-09-09), SOQUIJ AZ-98145234, A.A.S. 98A-233, situe bien le cadre « normal » dans lequel s'exerce à ce sujet le droit de gérance d'un employeur. Il est donc normal qu'un employeur s'interroge et pense même à encadrer un employé qui ne fournit pas une prestation de travail « normale »; lorsque le taux d'absentéisme s'élève à 60 %, peu importe la cause, un travailleur peut s'attendre à un encadrement plus strict de ses absences et à une supervision qui, bien que jamais souhaitée ni souhaitable, demeure dans la logique de l'exercice cohérent du droit de gérance. Qu'un employeur veuille mettre toutes les chances de son côté pour que le retour au travail d'un employé perdure dans le temps constitue une démarche normale dans le cas à l'étude. La CLP ne décèle donc pas, dans le processus mis en place du retour au travail, de harcèlement de la part de l'employeur. Quant aux méthodes utilisées pour assurer ce retour au travail, il est de gestion courante au sein de l'entreprise que le processus de retour au travail fasse l'objet d'une analyse interne afin qu'un employeur puisse soumettre à ses propres médecins le dossier d'un travailleur pour juger par eux-mêmes de sa capacité de travail. Dès le 6 mars 2002, le médecin de l'employeur requiert un accès à certains dossiers médicaux du travailleur. Pendant que cette procédure d'accès aux dossiers se poursuit, le travailleur est opéré le 26 mai et ne peut reprendre son travail avant juillet. Entre mars et juillet 2002, la CLP ne retrouve aucune méthode harcelante en provenance des personnes chargées de gérer le dossier de retour au travail. La preuve démontre plutôt que ce processus a suivi un cours normal, qui a été entravé par une maladie personnelle du travailleur, qui en a retardé la finalisation. Quant à la séquence des événements entourant le retour au travail, si c'est à l'occasion de la rencontre du 12 septembre 2002 que le travailleur apprend sa nouvelle affectation, il savait déjà depuis août 2001 que l'employeur cherchait à le placer dans un autre service, où son absentéisme chronique risquait moins de déstabiliser la gestion quotidienne et où le niveau de stress était moins élevé. Cette rencontre n'a rien d'imprévu et soudain au sens du critère de l'anormalité. Les autres événements concernent la gestion des absences par la nouvelle superviseure du travailleur, ainsi que la manière dont elle aurait intégré le travailleur dans ses nouvelles fonctions. Bien que l'employeur ait tenté de mieux gérer les absences du travailleur, après avoir fait preuve jusque-là d'un taux d'accommodement hors du commun, on ne peut parler de harcèlement lorsqu'un employeur décide, après de nombreuses tentatives infructueuses, de « serrer la vis », dans le respect du travailleur, comme l'a fait la supérieure du travailleur. L'approche du travailleur, qui considérait qu'un congé pour maladie n'était pas une absence, est venue manifestement en conflit avec l'exercice par l'employeur de son droit de gérance sur son dossier d'absentéisme et a abouti à la situation où tout contrôle de la part de l'employeur a été perçu par le travailleur comme une intrusion inappropriée dans sa sphère de décision personnelle. La CLP ne retrace donc pas avant et après le retour au travail une série d'événements imprévus et soudains. Aucun de ces événements ne s'écarte d'une procédure normale de réintégration au travail d'un employé présentant des problèmes d'absentéisme récurrents. Ils ne peuvent aucunement être assimilés à une situation inhabituelle, hors de l'ordinaire, à de l'acharnement contre le travailleur, la preuve offerte reposant exclusivement sur la perception des faits donnée par ce travailleur, perception que la CLP juge non conforme à la réalité objectivement démontrée par l'employeur.
Ayant conclu à l'absence d'événements imprévus et soudains, la CLP peut conclure immédiatement à l'absence de lésion professionnelle. Il paraît néanmoins important de donner brièvement une appréciation de la qualité de la preuve médicale offerte par les parties. Le psychiatre ayant témoigné pour le travailleur n'a pas produit d'expertise médicale détaillée et a simplement témoigné à partir de ses notes cliniques, qui sont peu élaborées. De plus, son opinion n'a jamais remis en cause la validité des renseignements donnés par son patient sur les attitudes de son employeur à son égard. Cet expert en psychiatrie n'a aucunement élaboré à l'audience sur la nature traumatisante des faits rapportés par son patient, tenant pour acquise leur réalité objective, sans autrement les analyser. En contre-interrogatoire, il finit cependant par admettre que le travailleur présente un tableau de dépression chronique. Par contre, la preuve de l'employeur apporte le meilleur éclairage scientifique parce qu'elle situe la troisième dépression de ce travailleur en huit ans dans un continuum qui permet de bien comprendre que nul n'est besoin de facteurs déclencheurs pour que survienne un nouvel épisode. Comme l'a fait valoir l'expert de l'employeur, dès l'instant où apparaissent les premiers symptômes d'une rechute de dépression, l'individu qui en est affecté a une perception personnelle des faits qui déforme souvent la réalité. Ce médecin a aussi témoigné que le rôle des événements stressants semblait prépondérant dans le premier épisode, alors que ce rôle est moins évident dans les épisodes ultérieurs. La CLP privilégie cette explication au niveau de la prépondérance de preuve.
SYLVAIN HALLÉE, partie requérante, et RRSSS MONTÉRÉGIE, partie intéressée, et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, partie intervenante, SOQUIJ AZ-50385008
Plainte pour harcèlement psychologique : interprétation de chacun des éléments constitutifs de la définition contenue à l'article 81.18 L.N.T.
Pendant 18 mois, le plaignant a occupé un poste de secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats. Il travaillait pour l'un des associés. Soutenant avoir été congédié illégalement, il a déposé deux plaintes en vertu de l'article 122 L.N.T. Dans une troisième plainte, il allègue que, par ses agissements et ses propos, son patron a exercé du harcèlement psychologique à son endroit.
DÉCISION : Le plaignant ayant été congédié le 29 octobre 2004, la plainte par laquelle il prétend avoir perdu son emploi le 13 septembre est déclarée sans objet. Dans sa seconde plainte, il reproche à l'employeur de l'avoir congédié dans le but d'éluder l'application de l'article 124 L.N.T. ainsi qu'à cause du dépôt de sa plainte pour harcèlement psychologique. Or, il n'y a pas de preuve en ce qui concerne le premier motif. Le fait que le plaignant ait été avisé de son congédiement sept mois avant d'atteindre deux années de service continu n'est pas suffisant pour conclure que l'employeur a tenté de contourner la Loi. Quant au second motif, la présomption est établie en faveur du plaignant, et ce, même si l'employeur affirme ne pas avoir reçu copie de la plainte de harcèlement. Il a toutefois réussi à démontrer l'existence d'une autre cause de congédiement, soit les problèmes de comportement et de compétence du plaignant : pertes de temps, non-respect des directives et absences sans motif de son poste de travail.
L'article 81.18 L.N.T. impose la présence de tous les éléments qui y sont prévus pour conclure à du « harcèlement psychologique ». Une conduite vexatoire est la manifestation de gestes, de paroles, de comportements ou d'attitudes qui humilient ou blessent quelqu'un dans son amour-propre et qui lui causent des tourments. En règle générale, il faut que ces gestes, paroles ou comportements se répètent dans le temps. L'analyse de l'affaire doit se faire globalement afin d'y déceler le caractère harcelant ou non des comportements, paroles ou gestes. Ceux-ci doivent être hostiles ou non désirés. Le terme « hostile » fait référence à un sentiment d'inimitié, d'opposition, voire à un comportement d'ennemi. La notion de « comportement non désiré » renvoie à une manifestation qui n'a pas été souhaitée par la victime, et ce, que celle-ci ait exprimé ou non sa désapprobation avant l'événement. Cependant, dans certains cas, le silence de la victime pourra être un facteur important dans l'analyse du bien-fondé de la plainte. La conduite vexatoire doit nécessairement porter atteinte soit à la dignité, soit à l'intégrité physique ou psychologique du salarié. La preuve doit aussi démontrer que l'atteinte a laissé des marques ou des séquelles qui, sans être nécessairement permanentes, compromettent de façon plus que fugace l'équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime. Un milieu de travail est néfaste lorsqu'il est nuisible et dommageable et qu'il ne permet pas de réaliser de façon saine les objectifs liés au contrat de travail. Il serait périlleux de prendre comme unique point d'analyse d'une conduite la seule perception du plaignant, puisque cette dernière peut être celle d'une personne ayant des problèmes de victimisation ou souffrant de paranoïa. De plus, chaque individu, en raison de ses traits de personnalité, de son éducation, de sa religion et de son milieu de vie réagit différemment à une même situation, voire à une même conduite. C'est pourquoi la conduite vexatoire doit s'apprécier de façon objective en fonction de la personne raisonnable, normalement diligente et prudente, placée dans les mêmes circonstances.
En l'espèce, les affirmations générales de harcèlement formulées par le plaignant ne sont pas supportées par la preuve. Il n'a établi aucun fait précis, aucune séquelle, aucun élément répétitif temporel, et encore moins démontré que les conduites invoquées étaient vexatoires. Parmi les événements rapportés, certains ont trait à des paroles de son supérieur dans certaines situations. Or, le plaignant n'a jamais signifié son désaccord quant à la façon de ce dernier de s'exprimer ni quant au vocabulaire qu'il utilisait. Bien que certaines expressions puissent être qualifiées de grossières, elles sont le reflet de l'exaspération du supérieur face aux demandes répétitives du plaignant. En outre, que le supérieur ait, à une seule occasion, omis de saluer le plaignant ne constitue pas du harcèlement. Quant au fait que celui-ci lui aurait demandé d'effectuer son travail selon les directives, le lien de subordination entre un employeur et un salarié impose à ce dernier d'exécuter son travail selon les directives. Le plaignant a toutefois pris des libertés en modifiant les textes qu'on lui avait dictés; malgré plusieurs avertissements, il s'est entêté à y ajouter sa touche personnelle. Ce type de comportement peut entraîner des réponses plus sèches de la part du patron, mais elles ne constituent pas du harcèlement. Il s'agit plutôt de l'exercice normal des droits de la direction. De toute façon, de telles remarques isolées ne constituent pas en elles-mêmes du harcèlement psychologique.
Bangia et Nadler Danino, s.e.n.c., SOQUIJ AZ-50389860 (Requête en révision (C.R.T.), CM-2001-7500, CM-2001-7501, CM-2002-1681 et 234386)
La Cour d'appel a erré en concluant que le litige relatif à la mauvaise gestion du régime de retraite des employés de l'Université Concordia ne relevait pas de la compétence exclusive de l'arbitre de griefs.
En 1977, l'Université appelante crée un régime de retraite au bénéfice de ses employés. La grande majorité des participants au régime est syndiquée et se trouve liée par l'une ou l'autre des neuf conventions collectives conclues entre l'Université et les neuf syndicats accrédités au sein de l'institution. L'intimé B., un salarié syndiqué de l'université, demande à la Cour supérieure l'autorisation d'exercer un recours collectif contre l’Université pour contester un certain nombre de décisions concernant l'administration et l'utilisation de la caisse de retraite. Avant le dépôt de cette demande, un syndicat qui avait accepté, à la suite de négociations avec l'Université, les mesures que conteste maintenant B., tente de faire rejeter la requête en plaidant le défaut de compétence de la Cour supérieure. Les huit autres syndicats appuient et financent la tentative de recours collectif de B. La Cour supérieure accueille le moyen déclinatoire. Elle conclut que seul un arbitre de griefs a compétence pour entendre le litige étant donné que le régime de retraite constitue un avantage prévu par la convention collective et que le litige résulte donc de l'application de celle-ci. La Cour d'appel infirme cette décision. Elle estime, d'une part, que l'objet du présent litige n'a rien à voir avec la convention collective à laquelle est lié B., étant donné que le régime de retraite existe indépendamment de toute convention collective, et d'autre part, qu'un arbitre de griefs ne possède pas la compétence requise pour entendre l'ensemble des réclamations visées par le recours collectif, soit les réclamations des salariés liés par les huit autres conventions collectives et celles du personnel non syndiqué.
DÉCISION : M. le juge LeBel, à l'opinion duquel souscrivent les juges Deschamps, Abella et Charron : La Cour supérieure a eu raison d'accueillir le moyen déclinatoire en irrecevabilité pour défaut de compétence. La procédure de recours collectif ne saurait avoir pour effet de conférer à la Cour supérieure compétence sur un ensemble de litiges qui, autrement, relèveraient de la compétence ratione materiae d'un autre tribunal. Sauf dans la mesure prévue par la Loi, cette procédure ne modifie pas la compétence des tribunaux. Elle ne crée pas non plus de nouveaux droits substantiels. Dans les circonstances de la présente affaire, le recours collectif de B. est incompatible avec la compétence exclusive de l'arbitre de griefs et avec la fonction représentative des syndicats accrédités. La situation est certes complexe, mais elle ne justifie pas d'écarter les règles de fonctionnement fondamentales du droit des rapports collectifs du travail. [2] [22] [45]
En l'espèce, B. aurait dû utiliser la procédure de grief prévue dans sa convention collective pour régler le différend avec son employeur au sujet du régime de retraite. Pour tous les membres syndiqués du groupe visé par le recours collectif, ce sont les arbitres de griefs nommés en vertu des conventions collectives applicables qui ont compétence exclusive sur les litiges, la compétence personnelle de chaque arbitre étant limitée aux griefs présentés par les salariés visés par la convention collective en cause. Quant à l'aspect matériel du litige, chacune des conventions collectives en vigueur au moment de la requête renvoie expressément au régime de retraite. En vertu de ces dispositions, l'Université s'est engagée auprès des syndicats à offrir aux salariés visés le régime de retraite selon les conditions de celui-ci. Les syndicats ont ainsi obtenu certaines assurances quant au maintien du régime et à l'admissibilité des salariés qu'ils représentent. En somme, les parties ont décidé d'inclure les conditions d'application du régime de retraite dans la convention collective. Dans ce contexte, l'employeur semblait conserver le contrôle effectif de l'administration du régime de retraite, tout en s'engageant, au moins implicitement, à respecter divers droits et obligations prévus par ce régime ou découlant des lois qui s'y appliquent. De ce fait, il reconnaissait aussi la compétence personnelle et matérielle de l'arbitre de griefs. Il ne s'agit pas d'un cas justifiant l'exercice par la Cour supérieure d'une compétence résiduelle exceptionnelle. [47-55]
Par ailleurs, le fait d'attribuer le statut de représentant à B., s'il était fait droit à sa requête en autorisation de recours collectif, serait incompatible avec les mandats légaux de représentation que le Code du travail accorde aux neuf syndicats accrédités représentant les salariés de l'Université. Ayant été négocié et incorporé à la convention collective, le régime de retraite est devenu une condition de travail sur laquelle B. a perdu son droit d'agir sur une base individuelle. B. est donc privé du pouvoir de réclamer l'application de ce régime en s'adressant aux tribunaux de droit commun. [56]
La solution en l'espèce n'est pas exempte de toute difficulté procédurale, notamment en raison de la multiplicité des recours possibles et des conflits potentiels entre des sentences arbitrales distinctes dans chaque unité de négociation. Cependant, la confirmation de la compétence des arbitres de griefs n'entraînerait pas automatiquement une multitude de recours arbitraux. La procédure civile offre différents moyens de résoudre les problèmes causés par la multiplicité des recours. Rien ne porte à croire que la procédure arbitrale pourrait donner lieu à des abus de droit de la part des différents syndicats concernés qui utiliseraient de façon excessive la procédure à leur disposition. [58-61]
Enfin, la question de la recevabilité d'un recours collectif limité au personnel non syndiqué n'a pas été soulevée devant notre Cour. La Cour s'abstient donc de se prononcer à ce sujet. [63]
M. le juge Bastarache, dissident, à l'opinion duquel souscrivent la juge en chef McLachlin et le juge Binnie : L'arbitre de griefs a compétence exclusive sur les litiges qui, dans leur essence, relèvent de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de l'inexécution d'une convention collective, mais là s'arrête cette compétence. Étant donné qu'en l'espèce le régime de retraite transcende chacune des conventions collectives, le seul tribunal compétent pour entendre la demande faisant l'objet du présent pourvoi est la Cour supérieure. [67] [75] [99]
La caisse de retraite constituée pour le régime de retraite est une entité en soi. Il s'agit d'un patrimoine dont ont le droit de profiter les employés visés par neuf conventions collectives et des centaines de contrats de travail. En raison de la multiplicité des conventions collectives, les questions que soulève la demande de B. existent indépendamment de la convention collective et sont directement liées à la caisse de retraite indivisible. Elles ne découlent pas, ni ne pourraient découler des négociations bilatérales qui ont conduit à la signature de la convention collective, étant donné qu'elles intéressent au même titre des employés visés par de multiples contrats de travail et conventions collectives. En conséquence, la présence d'une seule caisse de retraite, comparativement à la présence de multiples conventions collectives et contrats d'emploi conclus bien après sa création, permet de conclure que, dans son essence, la demande de B. découle du régime de retraite. Du fait que la caisse de retraite est indivisible et que plusieurs conventions collectives visent à régir l'accès à la caisse de retraite préexistante, aucune convention collective ne saurait à elle seule prétendre y apporter des modifications ou y porter atteinte. Permettre cela reviendrait à laisser les parties à cette convention collective déterminer pour tous les autres bénéficiaires le contenu de la caisse de retraite. [74] [77-80]
Le risque de décisions contradictoires est inévitable à la fois en théorie et en pratique si on considère que l'essence du litige découle de la convention collective liant B. à l'Université. Il en est ainsi parce qu'il faut également reconnaître que la même question découle, dans son essence, de chacun des autres contrats de travail et conventions collectives liant les bénéficiaires de la caisse de retraite à l'Université. Il s'ensuit que la même demande — qui intéresse tous les bénéficiaires de la caisse de retraite, mais ne peut être résolue que d'une façon — pourrait être tranchée différemment par plusieurs arbitres agissant chacun dans sa sphère de compétence. Il est impossible de concilier des ordonnances contradictoires de cette nature. La seule façon d'éviter une multiplicité de recours et des résultats contradictoires est de saisir la Cour supérieure de la demande de B. En définitive, il n'y a également, sur le plan des principes comme sur le plan pratique, aucune autre façon de trancher la demande de B. [91-93] [96]
NDLR : © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2006. Reproduit avec la permission du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
Bisaillon c. Université Concordia, SOQUIJ AZ-50374052
Retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite : lorsque le retrait s'échelonne sur deux années scolaires, la CSST doit modifier la base salariale pour tenir compte des augmentations de salaire applicables pour la nouvelle année scolaire.
Les dix travailleuses occupent à plein temps des emplois permanents d'enseignantes. Leur convention collective prévoit qu'à chaque début d'année scolaire une enseignante acquiert automatiquement une augmentation de salaire en raison de sa progression dans l'échelle salariale. Les dix travailleuses deviennent enceintes au cours de l'année scolaire 2004-2005 et elles accouchent au cours de l'année scolaire 2005-2006. La CSST leur reconnaît le droit au retrait préventif et leur verse une IRR à partir du début de leur retrait préventif jusqu'au 24 juin 2005, puis du 30 août 2005 jusqu'à la date de leur accouchement. Pour l'une d'elles cependant, le droit à l'IRR ne commence que le 30 août 2005. À la fin d'août, les dix travailleuses se présentent au travail pour des journées pédagogiques et le salaire qu'elles reçoivent tient compte de l'augmentation salariale prévue par la convention collective. Le 30 août, à la suite de la rentrée scolaire des élèves, la CSST recommence à verser l'IRR aux neuf travailleuses qui la recevaient au cours de l'année scolaire précédente, sans qu'elles aient à présenter un nouveau certificat visant leur retrait préventif. L'autre travailleuse est rémunérée par son employeur pour les premiers jours de classe et, par la suite, la CSST lui verse l'IRR. Dans le calcul du montant de l'IRR, la CSST ne tient pas compte de l'augmentation salariale qu'elles ont reçue au début de l'année scolaire 2005-2006, mais elle l'établit à partir du salaire de l'année scolaire 2004-2005, lorsque le droit au retrait préventif leur a été reconnu. Par ailleurs, le 20 novembre 2005, certaines enseignantes reçoivent une nouvelle augmentation de salaire à titre d'ajustement salarial dans le contexte du programme de l'équité salariale. Les travailleuses demandent à la CSST de rendre une décision concernant l'ajustement de l'IRR pour tenir compte de l'augmentation de salaire. Dans deux cas, la CSST ne donne pas suite à cette demande et émet des avis de paiement qui ne tiennent pas compte de l'augmentation salariale. Dans les huit autres cas, la CSST refuse les demandes de réajustement salarial. L'instance de révision confirme ces décisions au motif que, pour établir le montant de l'IRR, il faut se référer au revenu brut déterminé au moment où naît le droit à cette IRR.
DÉCISION : D'abord, pour la travailleuse qui n'a reçu l'IRR qu'à compter du 30 août 2005, la CSST reconnaît que cette IRR doit être établie sur la base de son salaire pour l'année scolaire 2005-2006. Quant aux neuf autres travailleuses, la CSST allègue que leurs demandes doivent être rejetées parce qu'il s'agit de demandes de reconsidération qui ne respectent pas les conditions prévues par l'article 365 LATMP. Cet argument est rejeté puisque les demandes des travailleuses n'ont aucunement pour but de remettre en cause le bien-fondé des décisions initiales sur la base salariale qui a servi au calcul de l'IRR qu'elles ont reçue jusqu'au 24 juin 2005, mais visent plutôt à faire modifier la base salariale retenue par la CSST pour le calcul de l'IRR versée à partir du 30 août 2005, compte tenu de l'augmentation de leur salaire. Ces demandes appelaient une réponse de la CSST, qui y a répondu en refusant au motif que la seule revalorisation du revenu annuel retenu aux fins du calcul de l'IRR que permet la LATMP est celle prévue par l'article 117 LATMP. Quant au bien-fondé des demandes des travailleuses, l'article 67 LATMP ne permet pas à la CSST de modifier les bases de salaires retenues initialement pour tenir compte des augmentations de salaire octroyées au début de l'année scolaire 2005-2006 et le 20 novembre 2005. Selon la jurisprudence, à moins de circonstances particulières qui font l'objet de dispositions spécifiques de la LATMP, l'article 67 énonce que le revenu annuel qui doit être retenu aux fins du calcul de l'IRR est celui que gagne le travailleur en vertu de son contrat de travail, au moment de l'ouverture du droit à l'IRR, et les augmentations de salaire futures ne sont pas prises en compte lors de la détermination du revenu annuel ni ne donnent droit à un réajustement postérieur du revenu retenu après qu'elles ont été octroyées. Par ailleurs, l'article 75 LATMP ne s'applique pas puisque, au moment de l'ouverture du droit à l'IRR, les travailleuses n'exerçaient pas un travail d'une nature particulière et il n'existait pas de circonstances particulières comme c'était le cas dans les décisions Paquin et Commission scolaire des Affluents (C.L.P., 2002-02-25), SOQUIJ AZ-01307120, Rhéaume et Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Lachine (C.L.P., 2001-10-31), SOQUIJ AZ-01304464, et Picher et Centres du Chemin du Roy (C.L.P., 2001-03-01), SOQUIJ AZ-00306332. Dans ces décisions, la CLP se fonde sur le fait que, au moment de leur admissibilité au retrait préventif, la situation des travailleuses était temporaire et il était établi qu'elles devaient recommencer à travailler à plein temps quelques semaines plus tard. Il ne s'agissait donc pas d'un changement postérieur du contrat de travail. Quant à l'argument fondé sur l'article 43 LSST, voulant que les décisions de la CSST aient pour effet de priver les travailleuses d'un avantage lié à leur emploi au moment où elles ont cessé de travailler, cet article s'inscrit dans le contexte des relations du travail entre l'employeur et la travailleuse et il a pour but de protéger les conditions de travail de la travailleuse enceinte pendant la durée de son retrait préventif. En l'espèce, ces exigences ont été satisfaites. Cet article ne concerne pas la détermination de l'IRR à laquelle a droit une travailleuse enceinte en retrait préventif et, au surplus, la méthode de détermination du montant de l'IRR ne constitue pas un avantage lié à un emploi. Bien que ces arguments ne soient pas retenus, la CLP conclut néanmoins que la CSST devait tenir compte de l'augmentation de salaire que les travailleuses ont reçue au début de l'année scolaire 2005-2006 lorsqu'elle a repris le versement de l'IRR en septembre 2005. En effet, selon la jurisprudence et notamment la décision Dubois et Commission scolaire des navigateurs (C.L.P., 2002-11-25), SOQUIJ AZ-02304803, la CSST met fin au versement de l'IRR pendant les vacances scolaires estivales au motif que les dangers pour lesquels le droit au retrait préventif a été reconnu n'existent plus durant cette période. Or, même s'il est question d'une suspension du droit au retrait préventif jusqu'à la rentrée des classes dans cette décision ou d'une suspension du droit à l'IRR dans les décisions initiales de la CSST reconnaissant le droit au retrait préventif, il demeure que la reprise du versement de l'IRR au début de la nouvelle année scolaire n'est pas automatique. Différentes circonstances peuvent faire en sorte que l'enseignante n'ait pas droit au retrait préventif et à la reprise de l'IRR lors de la rentrée scolaire. Avant de reprendre le versement de l'IRR, la CSST doit donc vérifier si l'enseignante satisfait de nouveau aux conditions d'ouverture au retrait préventif et au droit à l'IRR. La reprise du versement de l'IRR au début de la nouvelle année scolaire ne peut donc pas être comparée à celle qui a lieu lorsque l'assignation temporaire d'un travailleur qui a subi une lésion professionnelle prend fin. Dans ce cas, la reprise du versement de l'IRR est automatique parce que l'assignation temporaire n'est pas une des circonstances qui mettent fin au droit à l'IRR selon l'article 57 LATMP. En fait, la CSST reconnaît à une enseignante enceinte le droit au retrait préventif et à l'IRR uniquement pour l'année scolaire en cours. Ainsi, elle doit tenir compte du revenu annuel de l'enseignante au début de la nouvelle année scolaire lorsque sa grossesse s'échelonne sur deux années scolaires. Bien que l'enseignante n'ait pas à présenter un nouveau certificat visant le retrait préventif, la reprise du versement de l'IRR comporte une décision implicite de la CSST sur son droit au retrait préventif et à l'IRR pour la nouvelle année scolaire. Selon l'article 67, c'est le revenu annuel prévu au contrat de travail au moment où la CSST rend cette décision qui doit être pris en compte parce que c'est à ce moment qu'il y a ouverture au droit à l'IRR pour la nouvelle année scolaire. Cette approche a l'avantage d'éliminer l'iniquité de la situation dans laquelle se trouvent les enseignantes en retrait préventif dont le droit à l'IRR s'échelonne sur deux années scolaires par rapport aux enseignantes dont le droit à l'IRR débute avec la nouvelle année scolaire. Évidemment, si la CSST n'avait pas mis fin au versement de l'IRR pendant la période estivale, il y aurait eu lieu d'appliquer la règle établie par la jurisprudence voulant qu'une augmentation de salaire postérieure à l'ouverture du droit à l'IRR n'affecte pas la détermination du revenu annuel servant au calcul de cette indemnité. C'est d'ailleurs pourquoi il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des cinq travailleuses concernant l'augmentation qui leur a été octroyée le 20 novembre 2005.
CAMILLE ROTT, JOSIANNE BOULAY, TAMARA GERECUM, CATHERINE SALOIS, TANIA WILSON, MARIE RENNIE, MARIE-CHRISTINE CORRIVEAU, CAROLINE MCDOUGALL, TARA TUMIN et AMALIA KYRIOPOULOS, parties requérantes, et COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE et COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B. PEARSON, parties intéressées, et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, partie intervenante, SOQUIJ AZ-50394927
COMMENT TROUVER LES DÉCISIONS MENTIONNÉES DANS CET ARTICLE?
- Accéder au site Internet Azimut de SOQUIJ.
- Sélectionner la banque Juris.doc.
- Entrer son code d'accès et son mot de passe.
COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE?
Chacune des décisions mentionnées dans cet article a une référence AZ (par exemple AZ-50287651). Pour retrouver cette décision, il faut :
- accéder à l’écran Choix de banque de Juris.doc;
- utiliser la case de recherche par référence AZ.
http://www.Azimut.Soquij.qc.ca
Pour toute question relative à l'utilisation d'AZIMUT, Documentation juridique, communiquez avec le Service d'aide aux utilisateurs au 514 842-AIDE ou, sans frais, au 1 800 356-AIDE, de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi.
Me Monique Desrosiers, coordonnatrice, Secteur droit du travail et droit social, Direction de l’information juridique à la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
Source : VigieRT, numéro 13, décembre 2006.