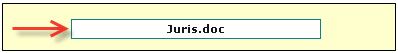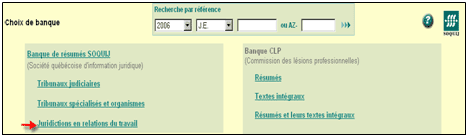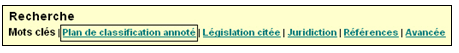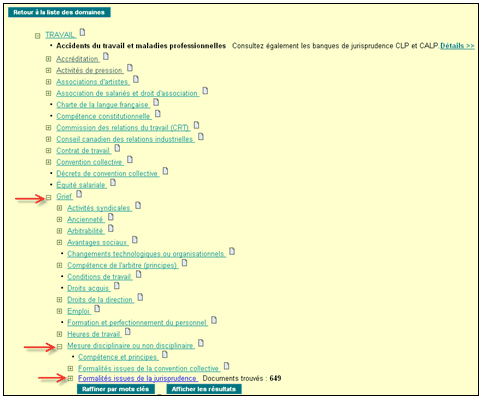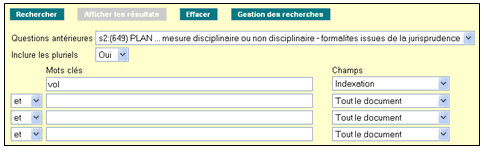Il appartient à l'employeur de gérer les ressources humaines de son entreprise. Cette prérogative lui donne le droit d'imposer des mesures disciplinaires ou non disciplinaires à ses employés. Il doit toutefois exercer ce droit dans le respect des règles édictées dans la convention collective et de celles qui sont établies par la jurisprudence.
En plus des diverses formalités prévues dans la convention collective pour l’imposition d'une mesure, les arbitres de griefs ont conçu des règles dont ils tiennent compte afin d’évaluer la justesse de la sanction imposée. Il s’agit de facteurs atténuants ou aggravants : ancienneté, aveux, attitude, politique de l’entreprise, dossier disciplinaire, exemplarité, préméditation ou caractère délibéré de l’acte, exemplarité de la sanction, avantage retiré, caractère isolé, valeur du bien volé, faute grave, importance du lien de confiance dans le poste occupé, regrets, refus de reconnaître ses torts, image de l’entreprise, etc.
Des moyens de défense sont aussi pris en compte, notamment l’alcoolisme, le jeu pathologique et la condition psychologique.
Enfin, l’utilisation de caméras de surveillance et l’écoute électronique doivent aussi répondre à certaines règles pour être admissibles en preuve.
Voici un bref aperçu en fonction des situations les plus fréquentes.
Le congédiement imposé au plaignant — un préposé à l'empilage comptant 23 ans d'ancienneté — pour avoir modifié son heure de départ est confirmé.
Au moment de son congédiement, le plaignant occupait depuis 23 ans un poste de préposé à l'empilage dans une entreprise de traitement et de distribution de produits laitiers. Le lieu de travail est vaste et, la plupart du temps, il travaillait sans grande surveillance. Au cours de l'année précédente, l'employeur avait installé un système de contrôle des allées et venues des employés. Plusieurs voies d'accès sont devenues protégées par des portes verrouillées ne pouvant être ouvertes que par la clé d'accès du système qui, en même temps, enregistre les entrées et sorties des employés. Le 21 mars 2003, alors que le plaignant travaillait durant le quart de travail de 17 h à 3 h, son superviseur l'a vu quitter son poste sans autorisation vers 23 h 30 en empruntant une porte de sortie non contrôlée, puis il l'a vu revenir plus de deux heures plus tard en faisant une manœuvre avec sa clé d'accès de façon à modifier son heure de départ. Convoqué par l'employeur dès le lendemain, le plaignant a commencé par nier les faits, pour finalement reconnaître avoir quitté les lieux sans autorisation. Au cours de l'enquête qui a suivi, l'employeur a découvert que le plaignant avait également quitté son travail sans autorisation une demi-heure avant la fin de son quart de travail le jour précédent. Le 31 mars suivant, le plaignant a été congédié.
DÉCISION : Selon la jurisprudence, falsifier son dossier de présence est considéré comme un vol dont la conséquence n'est toutefois pas nécessairement le congédiement. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération afin de déterminer si la relation de confiance est maintenue : la préméditation ou la spontanéité du geste, la fréquence ou non du geste, la valeur du bien détourné, la coopération de l'employé ou les circonstances atténuantes. En l'espèce, le plaignant n'a admis ses fautes que devant une preuve accablante et, même alors, il a adopté une attitude cavalière et n'a pas montré de véritable remords. Il ne reconnaît toujours pas le caractère malhonnête de son geste ni la raison d'être du système de contrôle mis en place par l'employeur, soit de s'assurer que les employés soient rémunérés uniquement pour les heures travaillées. Cette attitude ne se limite pas aux événements de mars 2003 puisque, l'année précédente, il avait déjà reçu un avertissement disciplinaire en raison de son refus répété de poinçonner au moment de quitter son lieu de travail. Une suspension de trois jours lui avait alors été imposée pour avoir placé des obstacles devant les caméras de surveillance. Or, malgré ces mesures, son inconduite s'est maintenue. Compte tenu de tout cela, et malgré le fait qu'il possède 23 ans d'ancienneté, il n'y a pas lieu d'intervenir.
Parmalat Canada et Teamsters Québec, section locale 973 (Mario Dubé), SOQUIJ AZ-50391678
La suspension de deux mois imposée à un technicien en entretien des bâtiments d'un hôtel pour avoir navigué sur Internet durant ses heures de travail (la nuit) est confirmée.
Le plaignant travaille dans un hôtel à titre de technicien en entretien de bâtiments durant le quart de nuit. Il conteste la suspension de deux mois qui lui a été imposée le 17 avril 2002. L'employeur lui reproche d'avoir utilisé son ordinateur portatif, qu'il a branché à Internet à 21 occasions, entre le 19 janvier et le 16 avril, pour un total de 3481 minutes pendant ses heures de travail au lieu de fournir une prestation de travail adéquate. Invoquant son dossier disciplinaire, qui fait mention des difficultés du plaignant à travailler durant tout son quart de travail, l'employeur l'a suspendu pour s'être rendu coupable de vol de temps. Le syndicat soutient que l'on ne peut opposer au plaignant des événements survenus en 1998. En ce qui a trait au vol de temps, la preuve ne démontre pas que le plaignant donnait priorité à Internet au détriment de son travail ni qu'il était négligent dans l'exécution de ses tâches. Le syndicat ajoute que la sanction imposée est trop sévère.
DÉCISION : Le technicien en entretien de bâtiments doit être disponible pendant toute la durée de son quart de travail pour répondre aux appels d'urgence qui peuvent survenir. Bien que les branchements à Internet effectués entre janvier et avril 2002 n'aient rien coûté à l'employeur, le plaignant a utilisé son ordinateur portable durant ses heures de travail pour envoyer et recevoir des courriels de même que pour télécharger différents logiciels. Or, l'employeur soutient que la liste des tâches à effectuer par le plaignant lorsqu'il travaille suffit à l'occuper pendant une période de huit heures. Le Tribunal peut toutefois concevoir que les tâches qui font partie de la description de son poste ne puissent pas être suffisantes pour remplir un quart de travail complet. Néanmoins, le plaignant doit rester disponible pour répondre aux appels d'urgence dans le but d'intervenir en cas de bris d'équipement ou de mauvais fonctionnement. L'employeur n'a adressé au plaignant aucun reproche selon lequel il n'exécutait pas de façon adéquate toutes les tâches qui lui étaient confiées au jour le jour. La qualité du travail fourni n'a donc pas été remise en question entre le mois de janvier et le moment où l'employeur a découvert qu'il naviguait sur Internet pendant son quart de travail. Pourtant, il faut conclure que le plaignant a utilisé à des fins personnelles des heures de travail pour lesquelles il était rémunéré. Par ailleurs, la convention collective prévoit que toute mesure disciplinaire sera retirée six mois après l'événement qui y a donné naissance, c'est-à-dire, en l'espèce, six mois après la sentence arbitrale du 18 mai 2001 ayant conclu que le plaignant n'accordait pas la priorité à son travail lorsqu'il était en service. Par conséquent, la clause d'amnistie s'applique, et les fautes antérieures ne peuvent être invoquées contre ce dernier. Cependant, en agissant comme il l'a fait, le plaignant ne se rendait pas aussi disponible qu'il aurait dû le faire pour répondre rapidement et efficacement aux appels, quelle que soit leur origine. Lorsqu'il utilisait son ordinateur portable pour se brancher à Internet, il n'offrait pas à l'employeur toute la disponibilité qui était requise de lui et, en cela, il commettait une faute et agissait de façon répréhensible; il était donc susceptible de se voir imposer une mesure disciplinaire pour l'inciter à prendre conscience de ce manquement et à corriger la situation. Le plaignant se serait branché à Internet pendant son quart de travail durant environ 60 heures sur une période de 3 mois. L'employeur avait raison de considérer ses agissements comme une faute grave. En effet, entre janvier et avril 2002, pendant qu'il était au travail, le plaignant a utilisé le temps rémunéré par l'employeur à des fins personnelles, et ce, sur une base régulière, sinon quotidienne. Il s'agit donc d'une faute lourde justifiant l'imposition d'une mesure disciplinaire sévère, d'autant plus que le plaignant travaille seul, presque sans surveillance, et qu'il se cachait dans l'atelier électrique pour ne pas être vu.
Fairmont Le Reine Élizabeth et Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Le Reine Élizabeth (C.S.N.), SOQUIJ AZ-50279670
La suspension de 20 jours imposée au plaignant — un technicien ambulancier — pour avoir réclamé le paiement d'heures non travaillées est confirmée.
Le plaignant, un technicien ambulancier depuis 15 ans, conteste la suspension qui lui a été imposée en raison de plusieurs manquements survenus au cours d'une période d'environ un mois et demi. L'employeur lui a reproché : 1) d'avoir pris une pause non autorisée de 40 minutes et fait une fausse déclaration sur l'emploi de son temps de manière à se faire payer comme si la prestation de travail avait été ininterrompue; 2) d'avoir dormi pendant 20 minutes dans son ambulance et de s'être fait payer au taux majoré pour cette période; 3) de s'être déclaré disponible à la fin de son quart alors qu'il ne l'était pas, prolongeant ainsi son retour au garage pour être rémunéré au taux majoré; 4) d'avoir fait un arrêt injustifié de 20 minutes alors qu'il était payé au taux majoré; et 5) d'avoir perdu 18 minutes pour des arrêts injustifiés alors qu'il devait revenir avec diligence au garage.
DÉCISION : L'employeur a fait la preuve des fautes commises et la sanction imposée n'est ni déraisonnable ni discriminatoire ou excessive. La somme des occasions pour lesquelles le plaignant a obtenu une rémunération indue n'est pas insignifiante : elle représente 73 minutes à taux normal et 55 minutes à taux majoré. De plus, il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'une situation récurrente ayant eu cours durant une période de un mois et demi. Par ailleurs, le plaignant n'a admis aucun fait ni aucune faute. Il n'a manifesté aucun remords ni l'intention de modifier sa conduite. Il s'est comporté de façon arrogante et agressive lorsque sa supérieure l'a rencontré pour discuter de ces incidents. Il jouissait d'une grande autonomie, à laquelle correspondent un degré de responsabilité accru ainsi qu'une obligation d'honnêteté et de loyauté. Sa relation avec l'employeur était fondée sur la confiance et il devait se comporter de manière à ne pas la compromettre par un comportement déloyal. Obtenir une rémunération qui ne correspond pas à la prestation de travail et faire une fausse déclaration sur sa feuille de route sont des fautes pour lesquelles la jurisprudence reconnaît l'imposition d'une sanction sévère. En l'espèce, le plaignant n'a pas d'antécédents, il compte 15 années d'ancienneté et les fautes qui lui sont reprochées ne touchent pas sa compétence professionnelle. La suspension de 20 jours est donc justifiée.
Corporation d'Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain et Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN), (Martin Cadieux), SOQUIJ AZ-50390130
Le congédiement du plaignant — un fonctionnaire municipal du service de la taxation comptant 30 ans d'ancienneté — pour vol de temps, fausses déclarations et utilisation d'un véhicule de la Ville à des fins personnelles est confirmé.
Le plaignant travaillait à titre d'agent de recettes à la Ville de Montréal et comptait 30 ans de service. Il conteste la décision de l'employeur de le suspendre aux fins d'une enquête et de le congédier. Celui-ci lui reproche d'avoir commis un vol de temps en utilisant la voiture de service à des fins personnelles et en déclarant des parcours qui ne correspondaient pas aux distances parcourues par d'autres agents ainsi que d'avoir remis des rapports d'activités incomplets, erronés ou lacunaires. Il soutient que le plaignant jouissait d'une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions et qu'il ne pouvait plus lui faire confiance, d'autant moins que celui-ci n'a fourni aucune explication au soutien des manquements reprochés. Le syndicat fait valoir que l'employeur n'a pas fourni le soutien nécessaire au plaignant afin de lui permettre de se corriger et que ce dernier n'a jamais été informé clairement de ses exigences.
DÉCISION : Le plaignant n'a pas expliqué les nombreux écarts entre les distances qu'il devait parcourir avec la voiture de service alors qu'il était en fonction et les distances réellement parcourues. Il est donc permis de conclure qu’il a utilisé la voiture de l'employeur à des fins personnelles, et ce, durant ses heures de travail. Le plaignant, qui comptait 30 ans de service, disposait de la formation et de l'information nécessaire pour accomplir adéquatement ses fonctions. L'employeur lui a d'ailleurs offert une formation supplémentaire afin de l'aider à corriger ses manquements, ce qu'il a refusé. Le Tribunal ne retient pas la thèse selon laquelle l'employeur se devait d'informer le plaignant qu'il ne pouvait disposer du temps de travail rémunéré pour effectuer des activités personnelles et qu'il ne pouvait utiliser la voiture de service à ses propres fins. De telles directives sont implicites et ne pouvaient être ignorées d'une personne comptant 30 ans de service. La preuve révèle de façon prépondérante les manquements allégués, notamment les fausses déclarations, l'usage de la voiture et le temps de travail utilisé pour des activités personnelles ou étrangères à la fonction d'agent de recettes. L'autonomie dont jouissait le plaignant dans l'exercice de ses fonctions, sa grande ancienneté et le fait que l'employeur l'avait déjà informé de la nécessité de s'amender constituent des facteurs aggravants qui plaident en faveur du maintien du congédiement.
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) et Montréal (Ville de), (Jacques Lalonde), SOQUIJ AZ-50371102
En l'absence de circonstances atténuantes, le congédiement d'un chauffeur-livreur pour falsification des feuilles de route et vol de temps est confirmé.
Le plaignant, un chauffeur-livreur, s'occupait de livraisons de denrées alimentaires aux divers magasins de l'employeur. Il travaillait 4 jours par semaine à raison de 10 heures par jour. Selon la convention collective, il avait droit à deux pauses rémunérées et à une pause repas à ses frais. Il pouvait décider de ne pas les prendre et terminer plus tôt sa journée tout en étant payé pour 10 heures. Chaque jour, le plaignant devait remplir une feuille de route indiquant ses allées et venues. Le 13 avril 2005, il a fait l'objet d'une filature commandée par l'employeur, qui doutait de son emploi du temps. Le rapport de filature faisant état de pauses non déclarées, l'employeur a rencontré le plaignant, qui a tout nié. Il a alors été suspendu aux fins d'une enquête et, le 25 avril suivant, il était congédié. Le syndicat soutient que les mesures imposées sont nulles parce que la procédure préalable à l'imposition d'une mesure disciplinaire prévue à la convention n'a pas été correctement suivie. Il allègue que l'avis de suspension aurait dû être remis au plaignant lors de la rencontre et que ce n'est pas le bon délégué syndical qui l'accompagnait à cette occasion. Au moment du congédiement, le plaignant comptait quatre ans de service.
DÉCISION : Les articles de la convention collective sur lesquels s'appuie le syndicat ne s'appliquent que dans les cas d'imposition d'une mesure disciplinaire. Or, une suspension aux fins d'une enquête est une mesure administrative et provisoire dont le bien-fondé dépend du résultat de la mesure définitive qui sera prise à la suite de l'enquête. Même si la clause relative à la suspension aux fins d'une enquête se trouve au chapitre des mesures disciplinaires, cela n'a pas pour effet d'en changer la nature. Ainsi, l'employeur n'est pas lié par les dispositions applicables à une mesure disciplinaire lorsqu'il procède à une suspension aux fins d'une enquête. D'autre part, la convention collective ne précise pas qu'il faille obligatoirement convoquer le délégué syndical du service en cause. Quant à la remise de l'avis de suspension, la convention ne prévoit pas de délai en soi. Qui plus est, il ne s'agit pas d'une procédure obligatoire. Par ailleurs, l'employeur était fondé à suspendre sans solde le plaignant à la suite des informations reçues par l'enquêteur, et ce, dans le but de compléter son enquête. Quant au congédiement, les faits étant contestés, il faut évaluer la crédibilité des témoins. Or, le plaignant a nié à plusieurs reprises s'être arrêté entre ses livraisons, alors que la bande vidéo démontre clairement le contraire. De plus, la comparaison entre les heures déclarées du plaignant, qui a un intérêt certain et immédiat dans l'affaire, et celles notées par l'enquêteur, qui n'y a aucun intérêt, amène plutôt à croire que le plaignant s'est bel et bien arrêté pendant près d'une heure dans un restaurant. Il y a lieu de conclure qu'il a effectivement falsifié sa feuille de route en ne déclarant pas ses pauses et en quittant le travail plus tôt cette journée-là, commettant ainsi un vol de temps. Or, en agissant de la sorte, il faisait un geste volontaire et prémédité. De plus, il avait déjà été l'objet d'une mesure disciplinaire pour une faute semblable peu de temps auparavant. Par ailleurs, compte tenu de la situation qui est celle d'un chauffeur-livreur, soit sa grande autonomie dans l'exécution de son travail, l'employeur est en droit d'exiger une plus grande intégrité et une probité professionnelle. Enfin, le plaignant a aggravé son cas en niant les gestes reprochés et en n'exprimant aucun regret. En l'absence de circonstances atténuantes, la mesure imposée est juste et raisonnable.
Provigo Distribution inc. (Centre de distribution de Boucherville) et Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 (TUAC), (Pierre Beaudry), SOQUIJ AZ-50344784
APPROPRIATION DE BIENS APPARTENANT À L’EMPLOYEUR
Le congédiement d'un opérateur pour s'être approprié 3 planches de bois est modifié en une suspension de 12 mois, notamment parce qu'il a fait office de bouc émissaire, l'employeur voulant « reprendre en main » son usine.
Le plaignant travaillait à titre d'opérateur de déligneuse dans une entreprise de fabrication de portes. Il conteste le congédiement qui lui a été imposé pour avoir volé des planches de bois. L'employeur affirme qu'il a surpris le plaignant alors qu'il plaçait dans sa voiture trois planches de bois de rebut appartenant à l'entreprise. Sa politique établit que les salariés doivent obtenir la permission d'un contremaître avant de s'approprier du bois de rebut. Il soutient que le plaignant connaissait cette politique et qu'il a commis un vol en la transgressant.
DÉCISION : Le plaignant a commis une faute en tentant de s'approprier trois planches de chêne sans autorisation. Bien qu'il ait cru qu'il s'agissait de rebut et qu'il ait été au courant de la politique à cet égard, on ne peut conclure qu'il avait l'intention ou encore l'impression de voler l'employeur. Il n'a pas tenté de camoufler son geste et n'a jamais nié les faits reprochés. Il s'agit plutôt d'une insubordination grave qui s'apparente à un vol. La gravité d'une telle insubordination est amplifiée par le fait que le plaignant travaillait dans une usine où il est facile de subtiliser des matériaux ou des outils. Dans ce contexte, il est indispensable que l'employeur puisse faire confiance à ses salariés dans l'usage qu'ils en font. D'autre part, les biens que le plaignant a tenté de s'approprier avaient une faible valeur, ce qui constitue une circonstance atténuante. En l'espèce, l'employeur n'a pas prouvé qu'il ne pouvait plus faire confiance au plaignant. Pour que la perte de confiance soit crédible, elle doit reposer sur des faits objectifs suffisants qui rendent impossible la poursuite de la relation du travail. Afin d'évaluer la sanction appropriée, plusieurs circonstances doivent être prises en considération. Aussi, la pratique selon laquelle les rebuts de bois faisaient habituellement l'objet de dons aux employés de l'usine atténue la gravité du geste reproché au plaignant. De plus, l'employeur a fait preuve d'un certain laxisme dans la gestion de sa politique et il a fait fi du principe de la progression des sanctions. Le plaignant a servi de bouc émissaire alors que l'employeur décidait de reprendre en main la situation du bois de rebut. Compte tenu de ces circonstances, de la gravité de la faute, de la faible ancienneté du plaignant et de son dossier disciplinaire peu chargé, il est approprié de remplacer le congédiement par une suspension d'une durée de un an.
Syndicat des travailleuses et travailleurs des Portes Cascades (CSN) et Portes Cascades inc. (Stéphane Girard), SOQUIJ AZ-50368819
APPROPRIATION DE FONDS OU DE SOMMES D’ARGENT
Le congédiement imposé à une serveuse de restaurant (hôtel) pour avoir volé 130 $ à l'employeur en procédant à du « flippage » de facture est confirmé.
La plaignante travaillait depuis six ans à titre de serveuse au restaurant d'un hôtel. Elle conteste le congédiement qui lui a été imposé pour vol. L'employeur explique que les serveurs utilisent un programme informatique qui permet d'entrer les commandes des clients, de préparer les additions et d'en enregistrer le paiement. Selon lui, la plaignante s'est approprié la somme de 130 $ en percevant l'argent comptant d'un client sans inscrire sa commande dans le programme informatique. Il souligne que la plaignante occupait un poste de confiance et qu'elle connaissait les règles concernant l'utilisation du programme informatique de facturation. Les gestes qui lui sont reprochés ont rompu le lien de confiance. Pour sa part, le syndicat fait valoir que la plaignante a peut-être commis une erreur de facturation, mais qu'elle n'avait aucune intention de voler.
DÉCISION : Le « flippage » de facture consiste à ne pas fermer immédiatement la facture qu'un client vient d'acquitter afin de la présenter à un autre client qui commandera la même chose et pour qui aucune facture ne sera ouverte. Le serveur fait ainsi payer chacune des deux commandes identiques, mais n'en rapporte qu'une seule dans le système de facturation. En l'espèce, la preuve révèle de façon prépondérante que la plaignante a procédé à l'inverse : elle n'a jamais entré la facture d'un client comportant quatre brunchs et elle lui a plutôt présenté l'addition qu'elle avait ouverte subséquemment pour un autre client. Ainsi, les quatre brunchs du premier client n'étaient pas entrés dans le système et il ne restait plus à la plaignante qu'à s'approprier l'argent comptant que celui-ci lui avait remis pour s'acquitter de la facture qu'elle lui avait présentée et qui, dans les faits, était celle du second client. En matière de congédiement pour fraude, un employeur n'est pas tenu, comme il le serait en matière criminelle, de présenter une preuve « hors de tout doute raisonnable ». Il doit plutôt démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que le salarié congédié a tenté de le frauder. Or, la plaignante a admis qu'elle connaissait les règles de facturation et la preuve révèle, de façon prépondérante, qu'elle a perçu une somme d'argent comptant pour une facture non inscrite dans le système informatique et qu'elle n'a pas remis cette somme à l'employeur. Elle n'a probablement pas prémédité le vol qui lui est reproché, mais elle a toutefois cédé à l'appât du gain, convaincue que l'on ne pouvait la prendre en défaut. L'employeur a donc prouvé que, en raison du poste qu'elle occupait, il ne pouvait dorénavant plus lui faire confiance. En l'absence de circonstances atténuantes, le Tribunal ne peut intervenir.
Fairmont Hôtel Reine Élizabeth et Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Reine Élizabeth (CSN), (Dyna Lavoie), SOQUIJ AZ-50365122
Le congédiement d'un serveur pour avoir consommé de l'alcool au travail est modifié en une suspension de 14 mois étant donné qu'il souffre d'un handicap — l'alcoolisme — et que l'employeur a omis de tenir compte de plusieurs facteurs atténuants, tels son ancienneté (36 ans), son âge (60 ans), son dossier vierge, ses aveux, sa demande d'aide et son engagement à suivre une thérapie à ses frais.
Le plaignant travaillait à titre de serveur de bar dans un hôtel. Il conteste le congédiement qui lui a été imposé le 22 avril 2003. L'employeur lui reproche d'avoir consommé de l'alcool alors qu'il était au travail, de ne pas avoir enregistré ni payé ces consommations, de s'être approprié sans droit des revenus appartenant à l'hôtel en ne poinçonnant pas certaines factures payées comptant par des clients et en servant des consommations sans facture de même que d'avoir versé en trop de l'alcool dans les verres de clients sans le porter à leur facture. Les manquements seraient survenus au mois de novembre 2002. Le syndicat soutient d'abord que le congédiement doit être annulé puisque l'employeur n'a pas rencontré le plaignant à l'intérieur du délai de neuf jours suivant la connaissance des faits qui lui sont reprochés, contrairement à la procédure prévue à la convention collective. Il affirme que l'on a rencontré le plaignant au mois d'avril 2003 relativement à des événements survenus en novembre 2002. Quant au fond, ce dernier admet qu'il a consommé de l'alcool au travail et qu'il n'a pas payé ses consommations. Le syndicat allègue toutefois que le plaignant souffrait d'alcoolisme et qu'il en a informé l'employeur lors de la rencontre précédant le congédiement. Il soutient que ce dernier avait l'obligation d'accommoder le plaignant, qui souffrait d'un handicap. Il ajoute que l'employeur n'a pas démontré que les manquements reprochés en ce qui concerne les transactions avec les clients constituaient des fautes intentionnelles et non pas des erreurs.
DÉCISION : Le moyen préliminaire du syndicat est rejeté. En effet, la preuve démontre que l'employeur a dû faire appel à un enquêteur et que ce n'est qu'au début du mois d'avril 2003 que ce dernier lui a remis son rapport. C'est donc à ce moment qu'il a pris connaissance des manquements reprochés au plaignant survenus en novembre 2002. Quant au fond, la convention collective exige que le salarié soit informé de tous les reproches qui lui sont adressés lors d'une rencontre préalable à l'imposition d'une mesure disciplinaire. En l'espèce, l'employeur n'a aucunement reproché au plaignant, lors de la rencontre, d'avoir versé en trop de l'alcool dans les verres des clients sans le porter à leur compte, et il était donc forclos d'invoquer un tel motif au soutien du congédiement. Quant au reproche concernant le fait qu'il avait volé de l'argent en ne poinçonnant pas certaines factures payées comptant et en servant des consommations sans facture, la preuve n'a pas révélé que les factures non enregistrées étaient celles correspondant à des clients du plaignant et elle n'a pas non plus dissipé le doute voulant que, si tel était le cas, le non-enregistrement de ces factures n'ait tout simplement été que le résultat d'une erreur et non celui d'une action intentionnelle. Le seul reproche pouvant donc être valablement invoqué au soutien du congédiement est le fait que le plaignant a consommé de l'alcool alors qu'il était au travail. Cependant, le plaignant souffrait d'alcoolisme. La jurisprudence reconnaît que l'alcoolisme constitue un handicap et l'employeur, par conséquent, avait une obligation d'accommodement à l'égard du plaignant. Il aurait dû tenir compte de nombreux facteurs atténuants tels que les 36 années de loyaux services de ce dernier, son âge (60 ans), ses aveux lors de la rencontre disciplinaire, son dossier disciplinaire vierge, sa demande d'aide et son engagement à suivre une cure à ses frais. Compte tenu de ces circonstances, le congédiement constituait une mesure trop sévère. Le plaignant a tout de même commis une faute grave, et l'alcoolisme ne pouvait l'exonérer complètement. Afin de sanctionner de façon exemplaire de tels gestes, une suspension de 14 mois est substituée au congédiement.
Société en commandite 9016-7586 Québec inc. et Syndicat des travailleuses et travailleurs du Marriott Château Champlain (CSN), (Joaquim De Sousa), SOQUIJ AZ-50355548
Le moyen de défense — le jeu pathologique — invoqué sous une accusation de vol est rejeté, notamment parce que l'employeur ignorait que le salarié était atteint d'un problème de jeu lorsqu'il l'a congédié.
Le plaignant travaillait à titre de préposé au service à la Ville de Montréal, qui l'employait depuis 1985. Il conteste le congédiement qui lui a été imposé aux motifs qu'il s'est approprié sans droit des pneus appartenant à l'employeur et qu'il a utilisé du temps de travail à des fins personnelles. Reconnaissant s'être approprié quatre pneus appartenant à l'employeur, il invoque en défense sa condition de joueur pathologique pour expliquer sa faute. L'employeur s'oppose à la recevabilité d'une preuve de faits postérieurs au congédiement que le syndicat cherche à introduire afin de prouver la condition de joueur pathologique du plaignant. Il invoque les principes élaborés par la Cour suprême du Canada dans Cie minière Québec Cartier c. Québec (Arbitre des griefs) (C.S. Can., 1995-07-20), SOQUIJ AZ-95111087, J.E. 95-1525, D.T.E. 95T-881, [1995] 2 R.C.S. 1095, relatifs aux conditions de recevabilité d'une preuve de faits postérieurs à un congédiement. Il affirme qu'il n'avait jamais été avisé de la condition pathologique du plaignant avant de lui imposer le congédiement. Le syndicat prétend que sa preuve de faits postérieurs est recevable dans la mesure où elle vise à démontrer la pathologie du plaignant. De plus, il s'oppose à ce que l'employeur produise le dossier disciplinaire du plaignant puisque l'avis de congédiement n'y fait pas référence. Sur le fond, l'employeur fait valoir que le geste reproché au plaignant était prémédité et qu'il constitue un vol, ce qui a ainsi rompu le lien de confiance, d'autant plus que le plaignant occupe un poste où il ne fait pas l'objet d'une supervision immédiate et où il jouit d'une grande latitude dans l'exécution de ses tâches.
DÉCISION : Le plaignant ne nie pas le geste qui lui est reproché et le rôle du Tribunal consiste donc à déterminer si le congédiement constitue une mesure juste et raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances. Selon les principes établis par la Cour suprême du Canada dans Québec Cartier, le rejet d'une preuve de faits postérieurs n'est pas automatique : elle peut être recevable si elle est pertinente. En effet, bien qu'un arbitre ne puisse réévaluer une décision de l'employeur à la lumière des faits survenus après que ce dernier eut pris sa décision, il peut toutefois tenir compte de faits postérieurs pertinents si une telle preuve aide à clarifier si le congédiement en question était raisonnable et approprié au moment où il a été ordonné. C'est donc le critère de la pertinence relativement à la question dont il est saisi qui doit guider le tribunal pour décider de la recevabilité d'une telle preuve. Dans Farber c. Cie Trust Royal (C.S. Can., 1997-03-27), SOQUIJ AZ-97111041, J.E. 97-774, D.T.E. 97T-411, [1997] 1 R.C.S. 846, la Cour suprême du Canada précise que la pertinence d'une preuve de faits postérieurs s'apprécie, d'une part, par rapport à ce qui est connu à un moment précis et, d'autre part, à ce qui était prévisible à ce moment pour une personne raisonnable se trouvant dans la même situation. En d'autres mots, ce qui est pertinent est ce que l'on savait ou ce que l'on aurait dû savoir au moment d'imposer la sanction. En l'espèce, l'employeur ne pouvait savoir que le plaignant était atteint de la maladie du jeu pathologique lorsqu'il l'a congédié, d'autant moins que ce dernier n'a aucunement mentionné ses problèmes liés au jeu lors de la rencontre précédant le congédiement. L'employeur a agi conformément à la pratique en s'informant auprès du programme d'aide aux employés pour savoir si le plaignant présentait un problème, et il n'avait pas de raison de vérifier autrement ni de douter de la réponse négative qu'il avait obtenue. Les représentants syndicaux n'ont pas davantage informé l'employeur d'un quelconque problème de jeu et le plaignant n'avait entrepris aucune démarche en ce sens. Puisque l'employeur n'avait aucune raison de soupçonner un problème de jeu pathologique chez le plaignant au moment de le congédier, la preuve de faits postérieurs visant à démontrer un tel état doit être jugée irrecevable.
Pour ce qui est de l'objection syndicale à la recevabilité en preuve du dossier disciplinaire du plaignant, il est vrai que celui-ci n'a pas été pris en considération par l'employeur lorsqu'il a décidé de congédier le plaignant, et il n'y a donc pas lieu qu'il le soit aux fins de la présente décision.
Quant au fond, en matière de vol, le congédiement est maintenu s'il y a rupture du lien de confiance entre l'employeur et le salarié. Selon les critères établis dans la jurisprudence arbitrale, le Tribunal peut considérer la nature du travail effectué, le degré de surveillance, la préméditation, le comportement du salarié lorsque l'employeur l'interroge ainsi que son regret devant le Tribunal. En l'espèce, la preuve révèle que le plaignant avait planifié son geste et que, de son propre aveu, il n'en était pas à ses premiers vols. Ce geste a été commis alors qu'il travaillait dans un environnement où il était peu surveillé, ce dont il était bien conscient. Le plaignant a d'ailleurs expliqué qu'il lui était très facile de voler des pneus. En présence d'une action planifiée, volontaire et consciente, et non d'un geste irréfléchi, il est raisonnable pour l'employeur de conclure à la rupture du lien de confiance.
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 et Montréal (Ville de), (Sylvain Harvey), SOQUIJ AZ-50329951
Le congédiement du plaignant — un livreur — pour avoir volé à l'employeur près de 20 000 $ sur une période de 15 mois est confirmé, l'arbitre rejetant le moyen de défense — jeu pathologique — invoqué par le syndicat.
Le plaignant occupait un poste de livreur chez l'employeur depuis 1977. Il conteste le congédiement qui lui a été imposé le 19 octobre 2001. L'employeur lui reproche de lui avoir volé de 18 000 $ à 20 000 $ entre les mois de juin 2000 et septembre 2001. Le plaignant admet avoir commis un tel vol. Il explique qu'il avait la responsabilité d'approvisionner en argent et en produits les machines distributrices de boissons gazeuses de l'employeur. Il indiquait à l'ordinateur une somme supérieure à ce qu'il plaçait réellement dans les machines distributrices et s'appropriait la différence, soit de 200 $ à 300 $ par semaine. Le syndicat soutient que, au moment de la commission des vols, le plaignant avait un problème de jeu pathologique. Il prétend que les vols ne peuvent lui être reprochés puisqu'ils sont dus à cette maladie.
DÉCISION : Selon la jurisprudence, à moins d'une exception, le congédiement constitue la sanction appropriée lorsqu'un salarié commet un vol alors que ses fonctions l'amènent à manipuler de l'argent et à travailler sans surveillance. L'employeur ne conteste pas le fait que, au moment où le plaignant volait, il était un joueur pathologique. Il faut cependant déterminer s'il y a un lien entre la pathologie décrite par ce dernier et la commission des vols. Or, il n'existe pas de conclusion automatique et nécessaire selon laquelle la présence de cette maladie excuse le vol. Il est possible d'être un joueur pathologique et de ne pas voler tout comme un joueur pathologique peut voler pour d'autres considérations que ses activités de jeu. Avant d'analyser la pathologie du plaignant, il faut préciser que ce dernier n'est pas un témoin crédible. En effet, il s'est contredit à plusieurs reprises et sur plusieurs sujets. L'on ne peut non plus retenir toutes les conclusions du témoin expert en ce qui concerne la maladie du plaignant puisque plusieurs d'entre elles sont fondées sur les déclarations peu crédibles de ce dernier. L'ensemble de la preuve permet de conclure que, s'il est vrai que le plaignant était un joueur pathologique pendant la période de la commission des vols, les sommes volées ne servaient pas uniquement à ses activités de jeu. Il jouait tout au plus deux ou trois fois par semaine aux loteries vidéo. Il pouvait passer des périodes allant jusqu'à deux semaines sans jouer et il ne s'adonnait pas au jeu durant ses vacances. Selon sa version la plus favorable, soit celle selon laquelle il jouait trois jours par semaine, il en résulte qu'il était sobre les quatre autres jours, période durant laquelle il profitait aussi de l'argent volé. Le témoin expert a reconnu que ce comportement du plaignant était atypique du joueur pathologique. Dans les faits, celui-ci volait peut-être pour jouer, mais aussi afin de satisfaire ses besoins personnels. Pour ce motif, il faut distinguer la présente affaire d'une sentence arbitrale soumise par le syndicat dans laquelle l'arbitre a ordonné la réintégration d'une salariée ayant commis un vol. Le plaignant a volé durant une longue période de temps et de façon systématique. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, son ancienneté de 24 ans et le jeu pathologique ne constituent pas des facteurs pouvant excuser le vol.
Union des routiers, brasseries et liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, section locale 1999 et Société du groupe d'embouteillage Pepsi (Canada), (François Rousseau), SOQUIJ AZ-50289489
La destitution d'un policier au motif de vol à l'étalage est modifiée en une suspension de six mois, notamment en raison de son état psychologique au moment de l'événement.
Le plaignant est policier à la Ville de Sainte-Foy. Le 6 octobre 2003, alors qu'il n'était pas en service, il a volé certains matériaux de construction dans une quincaillerie. Lorsqu'une agente de sécurité l'a approché, il a montré sa plaque de policier et a demandé qu'on n'appelle pas la police. Dès ce moment, l'employeur l'a suspendu avec solde. Le même jour, le plaignant a consulté son médecin traitant, qui a rédigé un certificat médical mentionnant un diagnostic de dépression majeure et une possibilité de trouble obsessionnel compulsif. Deux jours plus tard, il a consulté un psychiatre, qui a confirmé le diagnostic de dépression majeure au moment des actes reprochés. Le 14 octobre suivant, le plaignant a été convoqué devant un comité d'enquête interne. Le médecin désigné par l'employeur a émis l'opinion selon laquelle le médecin traitant du plaignant avait délivré un certificat de complaisance. Par une résolution du comité exécutif de la Ville de Québec, le 5 novembre, le plaignant a été suspendu sans solde jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise. Le 9 décembre, il a été examiné par le psychiatre mandaté par l'employeur. Le 14 janvier 2004, il a été convoqué devant un comité de discipline. Ce n'est que cinq mois plus tard, soit le 10 juin, qu'il a été destitué. Le syndicat demande la réintégration du plaignant rétroactivement au 7 octobre 2003. Il demande également que le nom du plaignant ne soit pas mentionné dans la présente décision, et ce, afin de préserver son anonymat.
DÉCISION : La demande de préservation de l'anonymat est rejetée. L'audition d'un grief porté en arbitrage possède un caractère public. Cette demande doit reposer sur des motifs sérieux, par exemple lorsque la divulgation de l'identité serait susceptible de mettre en péril la conduite d'une opération policière ou d'une enquête, ou encore de mettre en cause la sécurité des témoins, des plaignants ou de personnes étrangères à l'affaire. En l'espèce, l'issue du litige ne met en cause que l'état de santé du plaignant au moment des événements et quelques éléments de sa vie familiale. Par ailleurs, le grief par lequel le plaignant conteste sa suspension avec solde du 7 octobre au 5 novembre au motif qu'il était alors « en absence pour cause de maladie » est rejeté. En effet, au moment où l'employeur l'a relevé de ses fonctions avec solde, il n'était pas informé de la possibilité d'une maladie; il faisait face à des allégations criminelles qui pouvaient avoir un effet négatif sur l'image du service. De plus, le plaignant n'a subi aucun préjudice pécuniaire. Par ailleurs, le grief contestant la suspension sans solde du 5 novembre 2003 au 10 juin 2004 est accueilli. En effet, en transformant une suspension avec solde en suspension sans solde par une résolution du comité exécutif, sans avoir obtenu préalablement une recommandation de l'office du personnel et sans être parvenu à la fin du processus, l'employeur n'a pas respecté la convention collective; cela équivalait à imposer au plaignant une mesure disciplinaire. Or, la clause de la convention qui prévoit la suspension avec solde fait ressortir une double intention. D'une part, elle permet à l'employeur de rassembler tous les faits nécessaires afin de prendre une décision éclairée tout en évitant que le maintien du salarié en fonction soit préjudiciable à l'image du service de police. D'autre part, elle permet au salarié d'être entendu devant le comité de discipline avant qu'une recommandation soit acheminée au comité exécutif de la Ville. De plus, la durée limitée de 30 jours impose à l'employeur une obligation de diligence dans la conduite du dossier. Par ailleurs, selon le premier critère établi dans l'arrêt Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d'Assurance sur la Vie (C.S. Can., 2004-07-29), 2004 CSC 55, SOQUIJ AZ-50264378, J.E. 2004-1543, D.T.E. 2004T-775, [2004] 3 R.C.S. 195, la prolongation de la suspension pouvait être justifiée parce qu'elle était nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. En l'espèce, l'employeur avait besoin d'un délai supplémentaire afin d'obtenir une évaluation du psychiatre désigné. Cependant, pour reprendre les propos émis dans l'arrêt Québec (Ville de) et Syndicat professionnel de la police municipale de Québec (T.A., 1996-02-08), « maintenir la suspension pour motifs administratifs sans le maintien du traitement équivaudrait à sanctionner punitivement un salarié avant qu'il ait eu l'occasion de se faire entendre ». D'autre part, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de diligence en destituant le plaignant près de six mois après le dépôt du rapport de l'expert de la Ville et cinq mois après sa comparution devant le comité de discipline.
Quant à la destitution du plaignant, cette mesure devait tenir compte du fait que le vol à l'étalage constitue un geste grave, notamment parce que le policier incarne des valeurs de droiture, de probité et d'honnêteté. Ce geste doit être vivement réprouvé, à moins de circonstances atténuantes. En l'espèce, le plaignant a réussi à démontrer que son état de santé psychologique — sa dépression — constitue un facteur atténuant. En effet, l'assertion du médecin désigné par l'employeur selon laquelle le médecin traitant a délivré un certificat de complaisance est très grave et ne repose pas sur la preuve. De plus, la comparaison des deux expertises psychiatriques penche en faveur de celle du psychiatre traitant. Tandis que l'expertise du psychiatre du salarié est contemporaine du vol, celle du psychiatre de l'employeur a été effectuée deux mois plus tard. De plus, la première expertise analyse en profondeur la situation familiale et financière du plaignant durant la période précédant le vol. Les reproches de manque de rigueur et d'indépendance de cet expert sont injustifiés, et son rapport ainsi que son témoignage satisfont aux critères énoncés dans Boiler Inspection and Insurance of Canada c. St-Louis-de-France (Corp. municipale de la paroisse de), (C.S., 2002-02-20), SOQUIJ AZ-50113938, B.E. 2002BE-339. Par ailleurs, il n'y a pas eu préméditation. De plus, le plaignant n'a pas tenté d'intimider l'agente de sécurité en montrant sa plaque de policier : il a seulement commis un geste désespéré. En outre, les répercussions médiatiques ont été très limitées. Compte tenu de la gravité du geste, de la fonction occupée, de l'état de santé du plaignant, de sa responsabilité d'aller consulter un médecin et de la nécessité d'une sanction significative, la destitution constitue une mesure trop sévère. Une suspension sans solde d'une durée de six mois est ordonnée et le plaignant doit être réintégré dans ses fonctions.
Fraternité des policières et policiers de la Ville de Québec et Québec (Ville de), (Jean-François Guillemette), SOQUIJ AZ-50321448
La défense d'impulsion irrésistible n'est pas recevable à l'encontre d'une faute disciplinaire.
Le plaignant travaillait de nuit à titre de commis d'épicerie dans un marché d'alimentation. Le 20 juillet 2004, l'employeur l'a suspendu aux fins d'une enquête. Le 13 août suivant, il a décidé de procéder à son congédiement au motif que son enquête confirmait que, le 18 juillet, il avait volé et consommé un sac de croustilles sur les lieux du travail et délibérément brisé un contenant de mayonnaise. L'employeur affirme que la gravité des gestes reprochés justifiait l'imposition du congédiement. Il invoque une entente de retour au travail signée en 2003 dans laquelle le plaignant s'engageait à suivre une cure de désintoxication. Pour sa part, le syndicat prétend que, avant le début de l'audience, le plaignant a avoué avoir commis les fautes reprochées et a exprimé des regrets. Selon lui, cela justifie l'annulation du congédiement.
DÉCISION : Il n'est pas nécessaire d'aborder l'entente de retour au travail invoquée par l'employeur. Un système de vidéosurveillance confirme que le plaignant a consommé sans payer un sac de croustilles d'une valeur de 1 $ et a détruit volontairement un contenant de mayonnaise d'une valeur de 4 $. Le vol et le méfait constituent des fautes. Le caractère fautif de ces actes est d'autant plus évident que le plaignant connaissait la politique interdisant la consommation de marchandises sans payer et prévoyant l'imposition du congédiement en cas de contravention. Les aveux du plaignant quelques instants avant le début de l'audience sont tardifs. De plus, il ne ressort pas de son témoignage que le plaignant éprouve un regret authentique. Il est vrai que le vol n'entraîne pas automatiquement et nécessairement un congédiement. Toutefois, dans la plupart des cas de congédiement pour vol où des arbitres ont substitué une mesure moins sévère au congédiement, le salarié avait fait des aveux immédiats ou spontanés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le plaignant a soutenu qu'il est impulsif et que le méfait lui étant reproché avait été commis pour cette raison. Or, la défense d'impulsion irrésistible est irrecevable non seulement en droit pénal, mais tout autant en matière de faute civile. Pour tous ces motifs, il n'y pas lieu d'intervenir.
Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et Provigo Distribution inc. (Maxi Joliette), (Luc Plante), SOQUIJ AZ-50309876
Le congédiement imposé après avoir constaté – lors de la surveillance à des fins de formation – qu’une préposée utilisait le téléphone de l'entreprise afin d'effectuer des appels interurbains personnels durant ses heures de travail est confirmé.
La plaignante travaillait à titre de préposée au télémarketing. Le 18 février 2003, l'employeur lui a imposé une suspension de un jour aux motifs qu'elle avait été surprise en train de lire une revue à son poste de travail et qu'un enregistrement des communications téléphoniques révélait qu'elle avait manqué deux appels de clients. Le 21 février suivant, l'employeur a décidé de la congédier aux motifs qu'elle avait procédé sans autorisation à des appels interurbains personnels en modifiant des dossiers de clients et qu'elle avait déjà reçu plusieurs avertissements concernant son rendement et son comportement depuis son retour au travail, au mois de janvier précédent. La plaignante conteste ces mesures disciplinaires. Le syndicat soutient notamment que l'employeur ne pouvait recourir au système d'enregistrement des communications téléphoniques afin de constituer le dossier disciplinaire de la plaignante. En outre, il prétend que, à l'époque pertinente, cette dernière avait des problèmes de santé et que l'employeur n'a pas tenu compte de nombreuses circonstances atténuantes telles que l'âge avancé de la plaignante, son dossier disciplinaire vierge, l'absence de préjudice et le fait qu'elle ait avoué ses fautes.
DÉCISION : Le syndicat a insisté sur le fait que la plaignante s'était absentée du 22 octobre 2002 au 6 janvier 2003 en raison d'une dépression, soutenant que les faits reprochés à cette dernière étaient survenus alors qu'elle se remettait de cette maladie. Or, la preuve médicale révèle que les symptômes associés à la dépression n'étaient plus présents chez elle depuis son retour au travail. Aucun élément ne permet d'affirmer que la plaignante a commis les gestes qui lui sont reprochés en raison de son état de santé et il y a donc lieu de rejeter l'argument syndical à cet effet. Par ailleurs, il est vrai que, en vertu de la convention collective, les enregistrements doivent être faits uniquement dans le but de former les salariés. Or, c'est le cas en l'espèce. L'employeur a agi de plein droit et de bonne foi en procédant à ces enregistrements et c'est par hasard qu'il a découvert les manquements reprochés à la plaignante. Les enregistrements ont révélé que cette dernière avait manqué deux appels de clients alors qu'elle parlait avec une collègue. Elle a commis ces manquements alors que l'employeur l'avait avisée que son rendement était faible et que, si elle ne s'améliorait pas, des mesures disciplinaires lui seraient imposées. Pour ces motifs, l'employeur était fondé à lui imposer la suspension de un jour. Quant au grief contestant le congédiement, il est établi que la plaignante a fait des appels interurbains à des fins personnelles sans autorisation. La jurisprudence arbitrale reconnaît que de tels gestes peuvent être assimilés à de la fraude et à du vol pouvant justifier un congédiement. En l'espèce, l'imposition d'une telle mesure était fondée. Aucune circonstance atténuante ne permet de conclure que le congédiement constituait une mesure trop sévère. L'âge de la plaignante (61 ans) ne peut constituer une circonstance atténuante. Les actes reprochés ont été commis de façon préméditée et répétée, et cela constitue un facteur aggravant.
Syndicat des travailleuses et travailleurs de télémarketing Unimédia (C.S.N.) et Unimarketing inc., SOQUIJ AZ-50233881
La politique de prévention contre le vol adoptée par l'employeur impose des conditions de travail déraisonnables aux salariés en ce qui concerne la fouille de leurs effets personnels, mais pas en ce qui a trait aux caméras de surveillance.
L'employeur exploite cinq magasins de quincaillerie et de vente de matériaux de construction ainsi qu'un centre de distribution. À la suite d'un problème de vols internes impliquant deux salariés au printemps 2004, il a adopté une politique de prévention des pertes. Le syndicat a déposé deux griefs visant la cessation des fouilles du personnel dans deux établissements, alléguant que celles-ci étaient abusives. Le troisième grief exige le retrait des caméras de surveillance installées dans un troisième magasin, faisant valoir que l'employeur impose des conditions de travail déraisonnables.
DÉCISION : L'employeur pouvait adopter une politique de prévention des pertes. Il a satisfait aux exigences de la convention collective en informant le syndicat avant sa mise en application et en la diffusant aux salariés. Toutefois, la politique et son application doivent respecter les droits de ces derniers. Il s'agit donc de déterminer si l'employeur a prouvé que la solution adoptée est proportionnelle au problème décelé. Les fouilles se font de façon systématique et sont applicables à tout le personnel. Toutefois, l'employeur n'a pas prouvé que la vérification des sacs-repas des employés par la caissière ou le superviseur dans un endroit accessible à la clientèle était une solution proportionnelle. En effet, compte tenu de l'absence de reproches identifiables, la politique a une portée trop large et n'est pas une condition de travail raisonnable. Elle contrevient à l'article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne et à l'article 35 du Code civil du Québec. Par ailleurs, les caméras de surveillance installées dans différents endroits de l'un des magasins de l'employeur sont au nombre de 16, dont 2 avec vue sur les caisses et à la sortie extérieure de la cour. La preuve révèle que l'employeur a installé les caméras aux endroits stratégiques pour prévenir le vol et non pour surveiller les salariés. De nouveau, il importe de rechercher l'équilibre entre le droit de l'employeur de se protéger et de gérer adéquatement son entreprise et celui des salariés au respect de leurs droits fondamentaux. Or, le choix des moyens pour atteindre son objectif de dissuasion du vol appartient à l'employeur, à condition que l'atteinte aux droits et libertés des employés soit la plus petite possible. Dans ces circonstances, la demande du syndicat de retirer les caméras est mal fondée. Pour que l'atteinte aux droits et libertés des salariés soit la moindre possible, il y a toutefois lieu de réserver au syndicat le droit de contester l'usage des caméras si elles devaient servir à d'autres fins que la prévention et les enquêtes sur les vols.
Syndicat démocratique des employés de commerce Saguenay—Lac-St-Jean et Potvin & Bouchard inc. (grief syndical), SOQUIJ AZ-50347593
L'installation d'un système de caméras dans l'établissement de l'employeur — un lieu public où se trouvent des biens d'une valeur inestimable et où circulent un nombre considérable de visiteurs — est justifiée et ne constitue pas une condition de travail compromettant la dignité des employés.
Le syndicat allègue que la surveillance électronique effectuée dans les locaux de la basilique Notre-Dame va à l'encontre de l'article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne et de l'article 2087 du Code civil du Québec. Il demande que l'employeur cesse cette pratique illégale. L'employeur fait valoir que les installations de surveillance électronique ont pour but d'assurer la sécurité des lieux, des biens, des salariés et de la clientèle. Elles ne sont jamais utilisées pour contrôler l'exécution du travail des employés. Il ajoute qu'il évite de surveiller les aires de travail de façon continue. Il s'oppose à l'arbitrabilité du grief, prétendant que le syndicat connaissait l'emplacement des caméras de surveillance depuis le 6 juillet 2004, mais qu'il a attendu au 4 février 2005 pour déposer un grief. Il affirme que, puisque la convention collective prévoit qu'un grief doit être déposé dans les 20 jours suivant la connaissance de l'incident qui lui a donné naissance et que ce délai est de rigueur, le grief est prescrit.
DÉCISION : L'objection préliminaire est rejetée. Le fonctionnement des caméras ne constitue pas un événement passé et réalisé. Il s'agit d'une situation qui vise une pratique toujours en vigueur de l'employeur. Le grief est continu et ne peut être prescrit. Les dispositions de l'article 71 du Code du travail ne s'appliquent pas. Quant au fond, le grief est rejeté. L'établissement de l'employeur est un lieu public où circulent d'autres personnes que les employés. Les caméras ne sont pas utilisées pour surveiller ou évaluer la prestation de travail de ces derniers. L'employeur n'y a aucunement eu recours à des fins disciplinaires ou de harcèlement. La valeur inestimable des biens qui se trouvent dans l'établissement, la manipulation et le transport de sommes d'argent importantes ainsi que la multiplicité des endroits stratégiques où se retrouvent un nombre considérable de visiteurs tous les mois constituent des éléments établissant la nécessité d'une surveillance électronique. Même si l'employeur n'a pas été victime de vols de biens de valeur, les caméras sont nécessaires à titre de mesure de prévention. Le syndicat n'a pas démontré que le système de surveillance cause des préjudices aux employés et constitue une condition de travail compromettant leur dignité. Les employés se trouvent dans le champ d'une caméra et sont vus sur un écran comme tout visiteur. Ils ne sont pas épiés au cours de l'exercice de leurs tâches. L'employeur respecte les normes minimales d'utilisation des caméras de surveillance relatives à la vie privée établies par la Commission d'accès à l'information. Des solutions de rechange à l'utilisation de telles caméras ne peuvent être mises en place, compte tenu de l'étendue des lieux. L'employeur a agi de façon à sécuriser des biens d'une grande valeur et à être en mesure de faire enquête puis de remédier à la situation si un incident malencontreux se produisait.
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Fabrique Notre-Dame — CSN et Fabrique de la paroisse Notre-Dame (grief syndical), SOQUIJ AZ-50347342
L'employeur ne peut installer des caméras de surveillance qui sont constamment braquées sur des salariés et qui épient systématiquement leurs faits et gestes parce qu'il s'agit d'une forme de harcèlement et d'une condition de travail qui contrevient à l'article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne.
L'employeur a installé de façon permanente des caméras de surveillance qui captent essentiellement certains salariés à leur poste de travail. Il justifie cette surveillance par les motifs suivants : l'intrusion de citoyens dans les immeubles et garages, un conflit de personnalités entre deux salariés, l'exercice de moyens de pression par les cols bleus, le bris d'équipements, la demande expresse d'un salarié, le vol d'outils et de stocks, l'intimidation d'un entrepreneur, la sécurité des travailleurs et les discussions entre les salariés au travail, principalement avec les délégués syndicaux. L'employeur invoque ses droits de direction prévus à la convention collective afin de justifier cette surveillance.
DÉCISION : Les droits de direction de l'employeur sont subordonnés à la convention collective et aux lois, dont la Charte des droits et libertés de la personne. Or, la charte prévoit à l'article 46 que « [t]oute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables ». L'arbitre a donc le pouvoir et la responsabilité de faire respecter les droits et les obligations qui y sont contenus comme s'il s'agissait de parties intégrantes de la convention collective. En l'espèce, il y a eu violation, prima facie, de l'article 46 de la Charte. L'usage des caméras constitue une condition de travail injuste et déraisonnable parce que l'employeur n'a pas démontré de motifs suffisants justifiant la captation et l'enregistrement constant d'employés au travail, épiant systématiquement leurs faits et gestes. Il s'agit alors d'une forme de harcèlement. Cependant, il n'est pas interdit à la Ville d'installer des caméras de surveillance en permanence — à l'extérieur ou à l'intérieur de ses bâtiments — pour protéger les biens et les personnes, à titre préventif, s'il existe un problème important et continu et si l'utilisation de la caméra se fait de façon cohérente et raisonnable. Les arguments invoqués par l'employeur ne justifient pas l'orientation des caméras vers les salariés. En l'espèce, il n'y a pas de preuve d'intrusion de citoyens et il y a eu aveu que l'utilisation de ce moyen n'était pas approprié pour régler un conflit de personnalités. Pour ce qui est des faits relatifs aux moyens de pression des cols bleus qui ont été allégués sans être prouvés, l'arbitre n'en a pas une connaissance d'office. Les deux conditions requises pour permettre l'application de ce concept ne sont pas réunies. Puisque les mauvaises relations du travail sont invoquées comme motif justifiant l'installation de caméras, c'est-à-dire des faits générateurs de droits, elles doivent être prouvées. Pour ce qui est des bris d'équipements à l'occasion de la fête du Canada, il ne s'agit pas d'un problème actuel et continu, mais d'un événement circonstanciel, survenu un an plus tôt et dans un lieu autre que celui de l'installation des caméras. Qu'il s'agisse des bris d'équipements ou des vols d'outils, de la sécurité d'un salarié ou de la pose d'autocollants sur les véhicules, rien ne démontre l'existence d'un problème actuel et continu à l'endroit où sont installées les caméras. De plus, le problème des discussions entre les salariés ne fonde pas à pointer des caméras sur les délégués syndicaux au travail. Il s'agit d'un moyen disproportionné; une directive écrite et claire constitue une meilleure solution. Par ailleurs, la circulation injustifiée dans le magasin où se trouvent les stocks doit être contrôlée pour des raisons de sécurité. La caméra ne doit cependant pas être constamment dirigée vers le poste de magasinier. L'employeur devra donc déplacer les caméras stationnaires ou changer l'orientation de celles-ci afin de ne pas capter des postes de travail de façon constante et déplacer la caméra versatile soit à l'extérieur du magasin, soit à l'étage supérieur pour donner une vue de l'escalier sans capter le poste de travail du magasinier.
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 et Montréal (Ville de) (arrondissement Côte-St-Luc—Hampstead—Montréal-Ouest), (griefs syndicaux), SOQUIJ AZ-50315116
Les caméras de surveillance installées dans l'usine pour des motifs de sécurité doivent être débranchées, compte tenu des conditions de travail injustes qu'elles occasionnent.
En automne 2003, à la suite d'entrées par effraction et d'actes de vandalisme dans l'usine, l'employeur a installé 14 caméras de surveillance, exclusivement pointées en direction des machines servant à la production du papier. L'installation de ce système a engendré un climat de méfiance ainsi qu'une importante augmentation de stress chez les employés. Un grief a été déposé afin de faire cesser la surveillance. En l'espèce, le syndicat réclame une ordonnance de sauvegarde obligeant l'employeur à enlever le système de surveillance puisque celui-ci impose des conditions de travail qui sont manifestement déraisonnables et injustifiés et qui portent atteinte à la santé et à la sécurité des salariés.
DÉCISION : Le grief est sérieux et il repose sur une évidente violation de la convention collective et de l'article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne. Compte tenu de leur orientation, les caméras ne visent pas la sécurité des installations, mais plutôt le contrôle et la surveillance permanente et constante des employés. Cette pratique entraîne un préjudice sérieux compte tenu de l'augmentation du stress et de l'apparition de trois cas de dépression. La prépondérance des inconvénients favorise nettement les salariés, d'autant plus que le débranchement des caméras n'aurait aucun effet sur la sécurité des lieux. Les atteintes à la sécurité et à l'intégrité physique des salariés ne peuvent être réparées que par l’entremise d'une ordonnance interdisant ces pratiques de contrôle
Syndicat national des travailleurs du papier façonné de Windsor inc. et Atlantic, produits d'emballage ltée, Windsor, Québec, SOQUIJ AZ-50270445
COMMENT TROUVER LES DÉCISIONS MENTIONNÉES DANS CET ARTICLE?
- Accéder au site Internet Azimut de SOQUIJ.
- Sélectionner la banque Juris.doc.
- Entrer votre code d'accès et votre mot de passe.
COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE?
Deux façons s'offrent à vous.
- D’abord, chacune des décisions mentionnées dans cet article a une référence AZ (par exemple AZ-50233881). Pour retrouver cette décision, il faut :
- accéder à l’écran Choix de banque de Juris.doc;
- utiliser la case de recherche par référence AZ;
- accéder à l’écran Choix de banque de Juris.doc;
- cliquer sur les flèches.
- Ensuite, pour effectuer une recherche portant sur le vol en milieu de travail, il faut :
- accéder à l’écran de recherche par Mots clés de la banque Juridictions en relations du travail;
- effectuer votre recherche à l’aide du Plan de classification annoté;
- éclater la rubrique Travail;
- ensuite, vous devez également éclater les sous-rubriques Grief et Mesure disciplinaire ou non disciplinaire;
- lancez la recherche en cliquant sur la sous-rubrique suivante Formalités issues de la jurisprudence.
- Pour compléter votre recherche, vous pouvez raffiner celle-ci à l’écran Mots clés en cliquant sur le bouton RAFFINER PAR MOTS CLÉS.
- Exécuter la recherche à l’aide du bouton RECHERCHER.
http://www.Azimut.Soquij.qc.ca
Pour toute question relative à l'utilisation d'AZIMUT, Documentation juridique, communiquez avec le Service d'aide aux utilisateurs au 514 842-AIDE ou, sans frais, au 1 800 356-AIDE, de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi.
Me Monique Desrosiers, coordonnatrice, Secteur droit du travail et droit social, Direction de l’information juridique à la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
Source : VigieRT, numéro 12, novembre 2006.